Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)
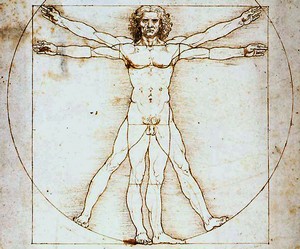
Ce projet de Génome Canada, codirigé par Dr Mark Samuels, chercheur au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine et professeur agrégé au département de médecine à l'Université de Montréal, est réalisé dans le cadre de l'Atlantic Medical Genetics and Genomics Initiative (AMGGI).
L'équipe de chercheurs cliniciens a identifié trois familles des provinces maritimes canadiennes, chacune ayant un enfant atteint de cette maladie. Même si ces familles n'étaient pas apparentées officiellement, il semblait fort probable que l'on pouvait établir un lien généalogique qui les unissait depuis des générations et qu'elles présentaient ce que l'on appelle un effet fondateur.
Grâce aux nouvelles technologies développées par le Projet du Génome Humain, l'équipe d'analyse moléculaire de l'AMGGI a réussi à délimiter une région génomique susceptible de contenir le gène responsable de l'anémie sidéroblastique congénitale chez ces familles.
Le reséquençage direct de cette région a permis d'identifier une mutation causale dans un gène auquel aucun rôle physiologique n'avait pu être attribué. Ultérieurement, en collaboration avec des chercheurs des États-Unis, l'équipe a identifié dix mutations causales additionnelles au niveau de ce gène dans d'autres cas d'anémie sidéroblastique congénitale inexpliqués.
En collaboration avec le laboratoire du Dr Louis Saint-Amant du département de pathologie de l'Université de Montréal, l'équipe de recherche a démontré un rôle direct du gène dans la synthèse de l'hémoglobine chez les poissons zèbres.
Le gène ainsi identifié fait partie d'une famille de gènes impliqués dans le transport de nutriments vers et depuis la mitochondrie, la centrale électrique des cellules. Certaines mutations d'autres membres de cette famille de gènes provoquent des maladies génétiques distinctes chez les humains, mais il s'agit de la première maladie de ce type associée au gène SLC25A38.
L'identification du gène causal peut maintenant offrir aux patients et aux membres de leur famille une confirmation moléculaire directe de leur condition leur permettant de savoir s'ils sont atteints ou porteurs asymptomatiques de la maladie. De manière plus générale, cette découverte démontre que même les processus scientifiques bien connus, comme la biosynthèse d'hémoglobine, réservent encore des surprises.