⚛️ Paradoxe de la transparence: plus la science explique, moins elle est crue - pourquoi ?
Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)
Byron Hyde, chercheur à l'Université de Bangor, a étudié comment la transparence affecte la confiance dans la science. Son travail, publié dans Theory & Society, met en lumière un phénomène surprenant: la transparence peut à la fois renforcer et diminuer la confiance. Cela dépend largement du type d'information partagée.
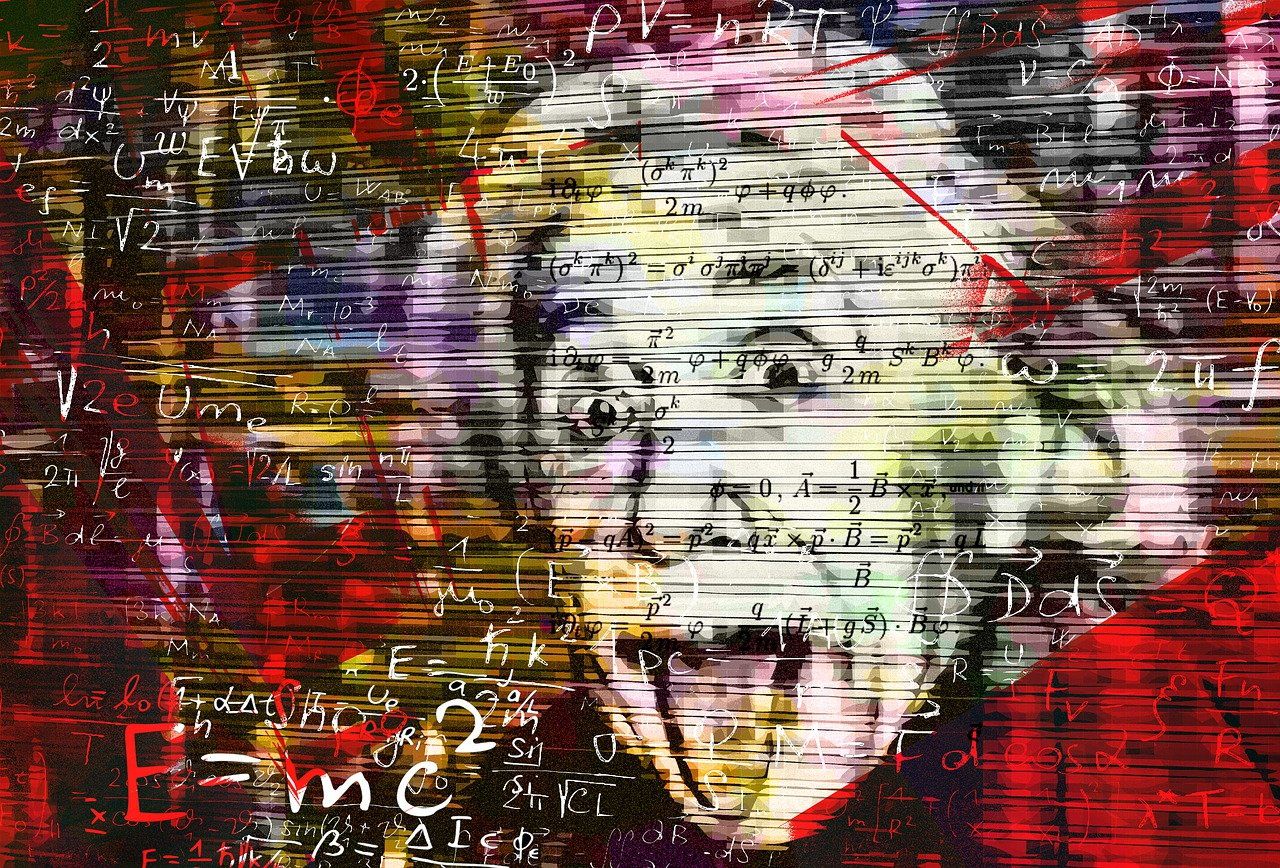
Image d'illustration Pixabay
Les résultats montrent que partager des bonnes nouvelles augmente la confiance, tandis que révéler des mauvaises nouvelles, comme des conflits d'intérêts, la réduit. Hyde souligne que cacher les mauvaises nouvelles pour maintenir la confiance est une solution éthiquement discutable et non viable à long terme.
Il propose plutôt de mieux éduquer le public sur les réalités de la science. Les scientifiques ne sont pas infaillibles et la science est un processus qui propose les meilleures explications plutôt que donner des vérités absolues. Une vision idéalisée crée des attentes irréalistes.
Hyde insiste sur l'importance d'enseigner non seulement les faits scientifiques, mais aussi comment la science fonctionne réellement. Comprendre les limites et les biais inhérents à la recherche scientifique pourrait aider à ajuster les attentes du public et à renforcer une confiance plus réaliste.
Enfin, il rappelle que la confiance dans la science est importante pour des décisions éclairées sur des enjeux comme la santé ou le climat. Une meilleure compréhension des processus scientifiques par le public est essentielle pour lutter contre la désinformation de notre époque.
Qu'est-ce que le paradoxe de la transparence ?
Le paradoxe de la transparence décrit une situation où la divulgation d'informations, censée augmenter la confiance, peut en réalité la diminuer. Cela se produit lorsque les attentes du public ne sont pas alignées avec la réalité des pratiques scientifiques.
Dans le contexte scientifique, ce paradoxe est particulièrement pertinent. Les institutions peuvent hésiter à partager des échecs ou des conflits d'intérêts, craignant une perte de confiance. Pourtant, ces informations sont cruciales pour une compréhension honnête de la science.
En fin de compte, le paradoxe de la transparence souligne l'importance d'une communication scientifique nuancée et honnête. C'est un équilibre délicat entre transparence et éducation pour maintenir une confiance publique saine.
Pourquoi l'idéalisation de la science est-elle problématique ?
L'idéalisation de la science crée une image déformée où les scientifiques sont perçus comme infaillibles et les résultats comme absolus. Cette perception peut conduire à des attentes irréalistes et à une méfiance accrue lorsque la réalité ne correspond pas à l'idéal.
Cette vision ignore les limites inhérentes à la méthode scientifique. La science est un processus de tâtonnement, où les erreurs et les révisions font partie intégrante de la progression vers une meilleure compréhension.
Lorsque le public découvre que les scientifiques sont sujets à des biais ou que des études peuvent être contredites, la confiance peut s'éroder. Pourtant, ces aspects sont normaux et reflètent la nature humaine et collaborative de la recherche.