Le rôle des contributeurs occasionnels sur les sites collaboratifs
Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)
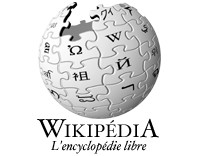
Ce que certains appelaient, non sans raison, le talon d'achille du web 2.0 (aspect collaboratif) ou encore la règle des 1% dit, peu ou prou, que les deux tiers des contenus produits proviennent de seulement 1% des utilisateurs actifs. Des tendances qu'avait confirmées cet été l'étude de Diggtrends, signalée par Richard McManus, qui montrait que quelques 30% des billets publiés en page d'accueil du site "Digg" ne provenaient que d'une poignée d'hyper-contributeurs.
Aaron Swartz, candidat au comité directeur de la fondation Wikimédia, vient de remettre en question cet a priori en publiant les résultats d'une courte étude sur son blog. Celle-ci mesure non pas le nombre d'interventions faites par chaque contributeur (qui forme la base des mesures les plus fréquentes), mais la quantité de texte produite par chacun. Et dans ce cas, la situation est très différente: un grand nombre de contributeurs occasionnels semblent en effet avoir écrit des textes longs (en un nombre réduit d'interventions), tandis que les “éditeurs” les plus actifs, qui forment le noyau des wikipédiens, nettoient, corrigent, mais sans apporter énormément de texte (ni d'information).
Une situation assez logique finalement: “dans le fonctionnement d'une encyclopédie, on a un grand nombre de rédacteurs qui possède chacun une connaissance pointue sur un sujet particulier ; et puis une équipe centrale d'éditeurs, qui ont des connaissances plus générales et reprennent les contributions de chacun pour les vérifier, les corriger, les préciser, les améliorer sur le plan de l'expression, etc.”