🧬 Conception d'un génome humain artificiel: le projet est lancé
Publié par Cédric,
Auteur de l'article: Cédric DEPOND
Source: University of Manchester
Autres langues: EN, DE, ES, PT
Auteur de l'article: Cédric DEPOND
Source: University of Manchester
Autres langues: EN, DE, ES, PT
Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)
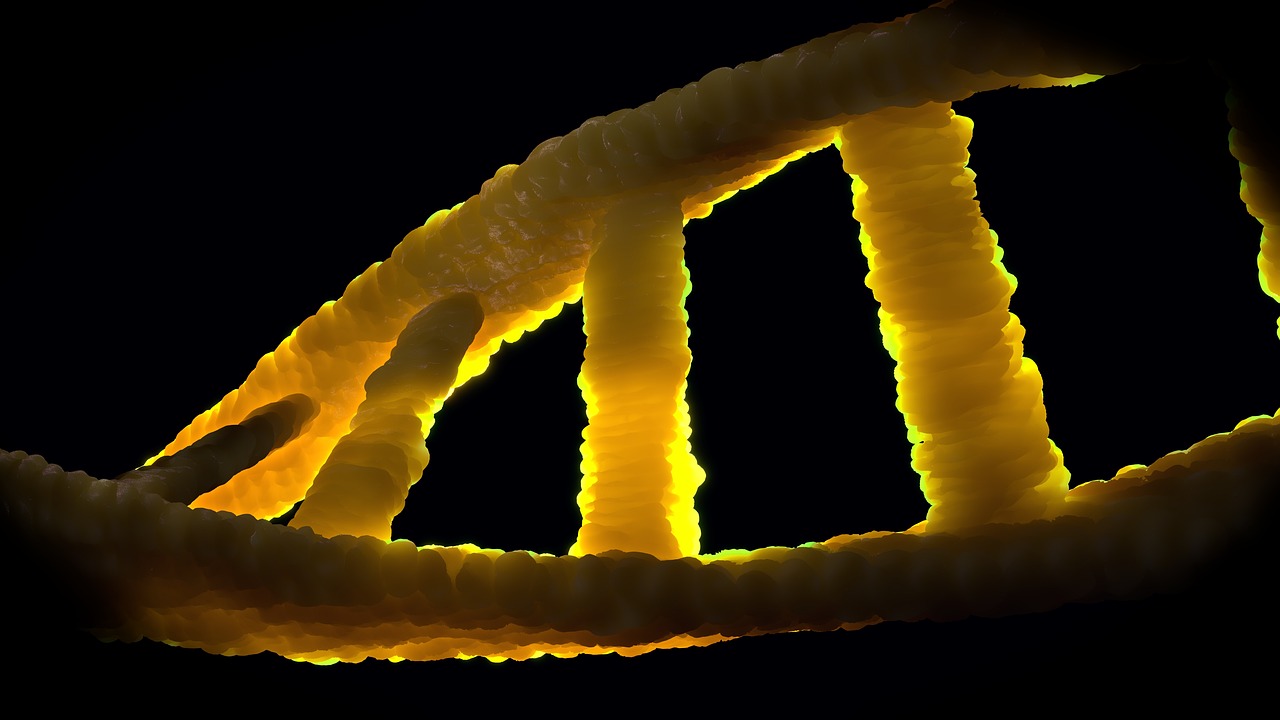
Image d'illustration Pixabay
Financé à hauteur de 10 millions de livres sterling par Wellcome, le projet SynHG rassemble des scientifiques des universités d'Oxford, Cambridge et Manchester. L'objectif ? Concevoir des chromosomes purement synthétiques pour mieux comprendre le fonctionnement de notre ADN et développer des thérapies innovantes.
Les promesses d'un génome synthétique
Contrairement à l'édition génétique (comme CRISPR), qui se "limite" à apporter des modifications à un génome, la synthèse permet de reconstruire intégralement des séquences d'ADN à partir de zéro. Cette approche pourrait mener à des cellules résistantes aux virus ou à des greffes d'organes plus sûres.
Les avancées récentes sur des génomes bactériens et de levure montrent que la technique est viable. Cependant, le génome humain, bien plus complexe, nécessitera des décennies de recherche.
Un chromosome synthétique, représentant 2 % du génome, sera testé dans un premier temps. Les résultats pourraient accélérer la lutte contre les maladies génétiques et le vieillissement.
Un projet aux enjeux éthiques majeurs
La manipulation du génome soulève des questions sociétales, notamment sur les risques de dérives eugénistes. Pour y répondre, le projet inclut un volet dirigé par Joy Zhang (Université du Kent), étudiant les implications éthiques et juridiques.
Des consultations publiques seront menées à l'échelle mondiale pour encadrer les applications futures. L'objectif est d'éviter les inégalités d'accès et les utilisations malveillantes.
Malgré ces précautions, certains scientifiques, comme Bill Earnshaw (Université d'Édimbourg), craignent une perte de contrôle. La synthèse d'ADN humain pourrait, à terme, bouleverser notre rapport à la vie.
Pour aller plus loin: Quels sont les risques des génomes synthétiques ?
La création d'ADN humain artificiel soulève d'importants enjeux de biosécurité. Contrairement aux modifications ponctuelles permises par CRISPR, la synthèse complète de génomes pourrait, en théorie, permettre la conception d'agents pathogènes sur mesure ou la résurrection de virus éradiqués. Des protocoles stricts de vérification des séquences synthétisées existent, mais le risque de détournement par des acteurs malveillants ou non-étatiques préoccupe les experts en sécurité biologique.
Sur le plan éthique, cette technologie pourrait accentuer les inégalités d'accès aux avancées médicales. Les thérapies basées sur des génomes synthétiques, potentiellement coûteuses, risquent de n'être disponibles que pour certaines populations, creusant les disparités en santé mondiale. Par ailleurs, la possibilité de modifier profondément le génome humain relance les craintes d'eugénisme, notamment avec le spectre des "bébés sur mesure" aux caractéristiques génétiques sélectionnées.
Enfin, les incertitudes scientifiques persistent. Même avec une séquence d'ADN parfaitement maîtrisée, les interactions entre gènes synthétiques et mécanismes cellulaires naturels restent mal comprises. Un génome artificiel pourrait provoquer des effets imprévus, comme des réponses immunitaires dangereuses ou des perturbations épigénétiques. Ces risques exigent non seulement des cadres réglementaires solides, mais aussi une transparence accrue dans la recherche et l'expérimentation.
Comment fonctionne la synthèse d'ADN ?
La synthèse d'ADN repose sur un processus chimique automatisé qui assemble séquentiellement des nucléotides (A, T, C, G) selon une séquence prédéfinie. Les machines modernes utilisent la méthode de synthèse par phosphoramidite, où chaque couche de nucléotides est ajoutée par étapes, avec des réactifs spécifiques pour lier les bases entre elles. Ce processus, bien que précis, reste limité à des fragments de quelques centaines de paires de bases, nécessitant ensuite des techniques d'assemblage enzymatique pour former des séquences plus longues.
Pour des génomes comme celui de l'humain, les scientifiques combinent biologie moléculaire et bio-informatique. Après la synthèse des fragments, ceux-ci sont assemblés dans des cellules modèles (comme des levures ou des bactéries), capables de "recoller" l'ADN grâce à des mécanismes de recombinaison naturels. Des algorithmes vérifient ensuite l'exactitude de la séquence, corrigeant les erreurs potentielles introduites lors de la synthèse ou de l'assemblage.
Les progrès récents en robotique et intelligence artificielle accélèrent considérablement cette démarche. Des plateformes automatisées peuvent désormais produire des milliers de fragments d'ADN en parallèle, tandis que l'IA optimise les séquences pour éviter les zones instables ou toxiques pour les cellules. Malgré ces avancées, la synthèse d'un chromosome humain entier reste une épreuve, en raison de sa taille et de la complexité de ses régions non codantes, dont le rôle exact est encore mal compris.