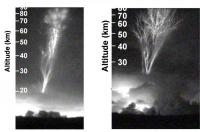Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)
On appelle événements lumineux transitoires (en anglais, TLE pour "transient luminous évents") les manifestations électriques de type sylphe, elfe, halo, jet... qui se produisent au-dessus des nuages d'orage. Les jets se présentent sous la forme de cônes de lumière bleutée sortant du sommet du nuage d'orage et sont classés en plusieurs catégories (jets bleus, blue starters et jets géants) selon le mécanisme physique qui en est à l'origine et l'altitude qu'ils atteignent.
La première découverte d'un jet bleu date de 1994 et s'est produite lors d'une campagne d'observation organisée par l'Université d'Alaska au centre des États-Unis. Celle d'un jet géant est encore plus récente: elle a été faite en 2001 par une équipe américaine lors d'une campagne à Puerto Rico. La même année, 5 jets géants étaient également observés au-dessus d'un orage dans le sud de l'île de Taiwan. Ce nouveau phénomène montrait pour la première fois la connexion électrique entre le nuage d'orage et l'ionosphère, partie relativement conductrice de l'atmosphère située approximativement à 90 km d'altitude durant la nuit.
Même s'ils suscitent une grande curiosité de la part des scientifiques spécialisés dans les phénomènes électriques produits par les orages, ces jets géants sont rarement observés. Depuis l'espace, l'instrument "ISUAL" sur le satellite taiwano-japonais Formosat en a détecté avec une haute résolution temporelle, ce qui a permis de mieux comprendre leur mécanisme de développement. Les jets géants sont ainsi les TLE qui durent le plus longtemps, de l'ordre de la demi-seconde. Ils n'ont cependant jamais été enregistrés de façon optique en couleur et les distances auxquelles ils ont été observés n'ont pas permis jusqu'alors de voir leur structure de façon très détaillée.
La théorie proposée pour le déclenchement de ces jets géants conduit à la conclusion que les conditions et la zone de leur déclenchement ne sont pas les mêmes que pour les jets classiques: alors qu'un jet classique se déclencherait au sommet du nuage, un jet géant démarrerait au coeur du nuage.
Le 7 mars 2010, alors qu'un orage approche la côte est de l'île de la Réunion, Patrice Huet, qui travaille à la maison du Volcan et photographie régulièrement les éclairs, installe comme il en a l'habitude son matériel photo à une altitude de 1600 m. En moins d'une heure, il obtient 5 vidéos de jets géants, à une distance exceptionnellement proche d'environ 50 km, et pour certains d'entre eux des clichés couleur absolument inédits.
Coordonnée au Laboratoire d'aérologie, l'étude de ces vidéos a ensuite été réalisée par plusieurs spécialistes de ces phénomènes lumineux et des aspects électriques des orages, en associant plusieurs types de données météorologiques et électriques et en appliquant différentes techniques d'analyse aux observations optiques.
Grâce aux images du satellite météosat7 et aux données d'éclair du réseau mondial WWLLN (World wide lightning location network), il a pu être établi que les jets géants ont démarré dans la zone convective de l'orage, qui est sa zone électriquement la plus active, et qu'ils ont été produits sur deux courtes périodes (3 jets pendant 4 minutes puis 2 jets pendant 3 minutes) caractérisées par des taux d'éclairs faibles.
Les vidéos montrent que chacun de ces 5 jets géants est précédé d'une activité lumineuse soutenue et pulsionnelle au coeur du nuage, ce qui valide la théorie proposée sur le lieu de déclenchement de ces décharges.
En associant les images vidéos aux signaux électromagnétiques de très basse fréquence détectés simultanément par une station de mesure appropriée en Hongrie (car ces signaux se déplacent sur de très longues distances), les chercheurs ont pu montrer que la charge transportée hors du nuage par ces décharges est dans tous les cas négative et qu'elle est considérable, de l'ordre de plusieurs centaines de Coulomb dans certains cas, ce qui en fait une composante majeure du circuit électrique global terrestre.
La valeur et l'évolution de la vitesse de propagation de la phase initiale, ou "leading jet", qui commence, comme c'est le cas dans l'éclair nuage-sol, par une première décharge peu lumineuse se déplaçant lentement, ont également pu être précisées: elles sont très variables d'un cas à l'autre, mais dans tous les cas la vitesse augmente fortement dans la partie supérieure du jet géant pour atteindre les 1000 km/s. La phase secondaire, ou "trailing jet", plus lumineuse et plus longue présente une forte analogie avec la composante continue de l'éclair nuage-sol: une durée de plusieurs centaines de millisecondes durant laquelle la luminosité diminue progressivement, simultanément dans le nuage et dans plusieurs zones du jet, avec in fine une possible ré-intensification. Les images couleur montrent que pendant la phase secondaire la zone de transition spatiale du jet géant (entre les altitudes de 40 à 65 km) correspond à une luminosité rouge due aux streamers (2) qui suivent les branches principales du leading jet.
Un des enjeux scientifiques majeurs est maintenant de comprendre pourquoi certains orages sont capables de produire ce géant des décharges électriques atmosphériques.
Notes:
(1) Laboratoire d'aérologie (LA/OMP, CNRS / UPS), Département d'ingénierie électrique de l'Université polytechnique de Catalogne, Laboratoire de l'atmosphère et des cyclones de la Réunion (LaCy/OSU-Réunion, CNRS, Université de la R éunion, Météo-France) et Institut de recherche en géophysique et géodésie de l'Académie des sciences de Hongrie
(2) Le streamer (en français "filament d'ionisation") est un type de décharge électrique "froide", c'est-à-dire qui se produit dans un gaz sous l'effet d'un champ électrique non uniforme et prend la forme d'une avalanche d'électrons.
Référence:
Soula, S., O. A. van der Velde, J. Montanya, P. Huet, C. Barthe, and J. Bór (2011), Gigantic Jets produced by an isolated tropical thunderstorm near Réunion Island, J. Geophys. Res., doi:10.1029/2010JD015581, in press.(http://www.agu.org/pubs/crossref/pip/2010JD015581.shtml)