Une étude révèle un lien intriguant entre la température corporelle et la dépression
Publié par Cédric,
Auteur de l'article: Cédric DEPOND
Source: Scientific Reports
Autres langues: EN, DE, ES, PT
Auteur de l'article: Cédric DEPOND
Source: Scientific Reports
Autres langues: EN, DE, ES, PT
Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)
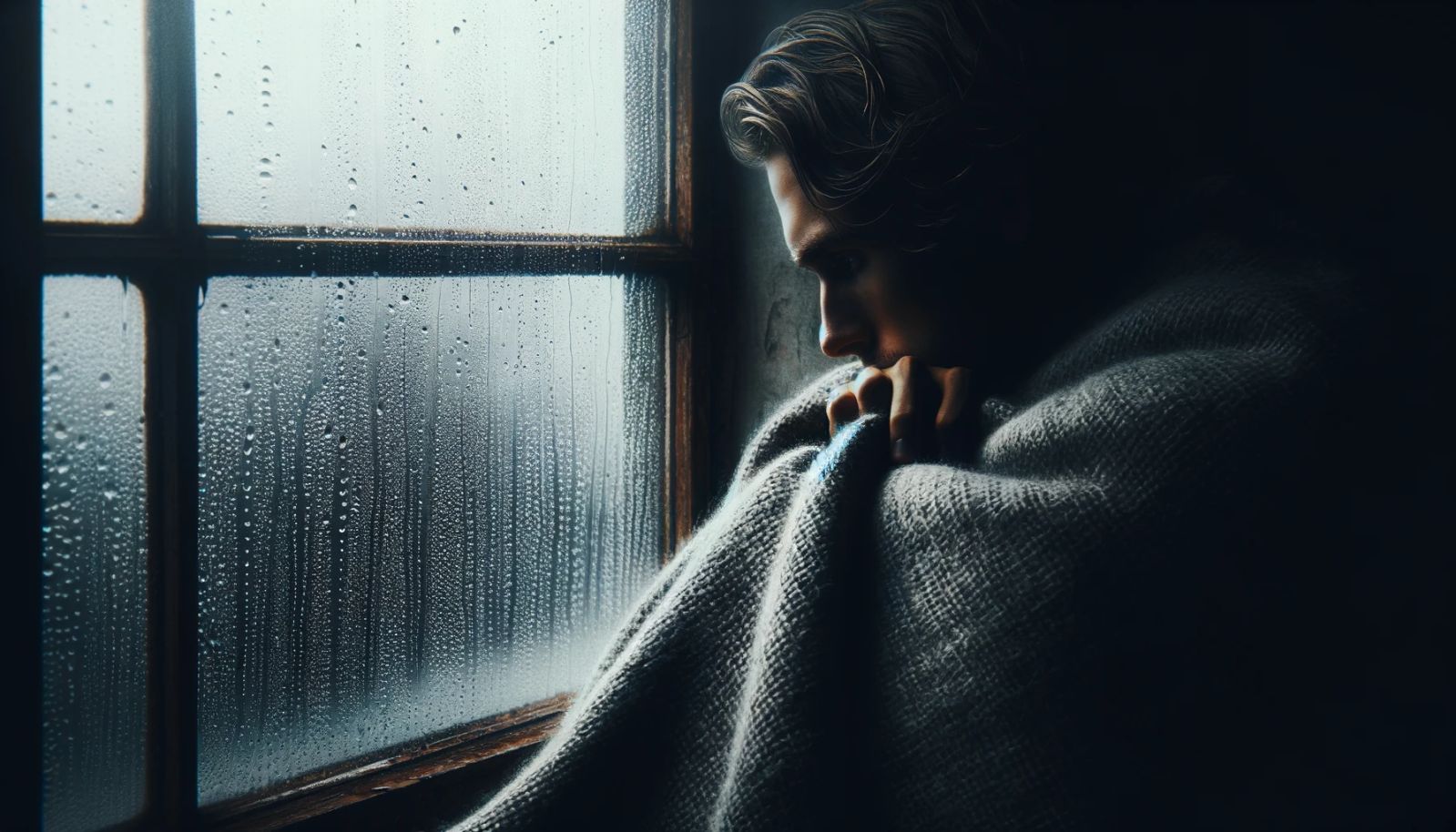
Pendant sept mois, les chercheurs ont analysé les données de plus de 20 000 participants issus de 106 pays différents. Ces participants ont été équipés de dispositifs portables mesurant leur température corporelle et ont également rapporté quotidiennement leurs symptômes de dépression. Les résultats sont saisissants: à mesure que la gravité des symptômes dépressifs augmentait, les participants présentaient des températures corporelles plus élevées.
L'étude ne permet pas de déterminer avec certitude si c'est la dépression qui élève la température corporelle, ou si c'est l'inverse. Les chercheurs supposent que cette corrélation pourrait être liée à une diminution de la capacité du corps à se refroidir lors d'une dépression, associée à une production accrue de chaleur par le métabolisme.
Les résultats de cette étude pourraient avoir un impact significatif sur le traitement de cette maladie psychique. Des recherches antérieures ont déjà montré que des méthodes de traitement basées sur la régulation de la température corporelle, telles que les bains à remous et les saunas, pouvaient atténuer les symptômes de la dépression. En effet, du fait de l'autorefroidissement provoqué par la transpiration, le corps a cela se surprenant de présenter la capacité de se refroidir plus efficacement lorsqu'il est soumis a une chaleur extérieur que lorsqu'il baigne dans de la glace.
Cette nouvelle découverte suggère que le suivi de la température corporelle des patients dépressifs pourrait permettre une personnalisation plus efficace des traitements à base de chaleur. Cependant, d'autres études seront nécessaires pour comprendre pleinement les mécanismes sous-jacents de cette corrélation et pour développer des interventions thérapeutiques plus ciblées.