Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)
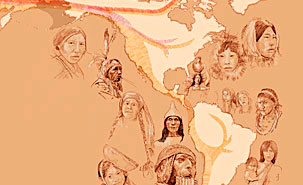
L'étude a permis de comparer le génome de 52 groupes autochtones des deux Amériques et de 17 groupes de Sibérie. (Illustration: Nature)
"Les différentes hypothèses linguistiques suscitaient la polémique, mais notre étude met les points sur les i", affirme Damian Labuda, professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et chercheur au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine. La recherche à laquelle il a participé a porté sur la comparaison du génome de 52 groupes autochtones des deux Amériques et de 17 groupes de la Sibérie. Lancés par son collègue Andrès Ruiz-Linares, de la University College London, ces travaux ont mis à contribution une soixantaine de chercheurs et ont été publiés dans la revue Nature du 16 aout dernier.
Trois vagues
"Les linguistes avaient déjà établi que les Paléoindiens, les Na-Dénés et les Inuits constituaient trois familles linguistiques différentes et qu'ils devaient donc être issus de trois vagues distinctes de peuplement", explique Damian Labuda.
Le terme "Paléoindiens" désigne les ancêtres de la très vaste majorité des peuples autochtones actuels, parvenus en Alaska il y a 15 000 ans par le détroit de Béring encore immergé. Selon le professeur, ces premiers arrivants étaient peu nombreux ou du moins possédaient une grande homogénéité génétique. Leurs descendants ont peuplé l'ensemble des Amériques.
La famille linguistique na-dénée est numériquement beaucoup plus restreinte et inclut notamment, parmi les peuples les plus connus, les Haïdas de Colombie-Britannique et les Navajos d'Arizona. Leurs ancêtres, originaires de Sibérie, auraient franchi la Béringie il y a de 6000 à 8000 ans.
Les Inuits, qui occupent les rives de l'Arctique, forment une autre famille linguistique. Ils auraient gagné les côtes de l'Alaska et du Nord canadien vers la même époque que les Na-Denés et sans doute par la banquise.
Selon les travaux de l'équipe internationale, les descendants des Na-Dénés partagent 90 % de leur génome avec les autres peuples autochtones malgré le fait que leur langue n'a aucune parenté avec celles des Paléoindiens. "Leurs ancêtres ont laissé peu de traces génétiques - soit seulement 10 % du génome - parce qu'ils se sont mêlés aux populations sur place. Mais ils ont néanmoins laissé leur culture et leur langue", souligne Damian Labuda.
Les Inuits ne partagent quant à eux que 57 % de leur génome avec les autres peuples autochtones.
D'autres études en génétique avaient été réalisées pour tenter d'élucider les origines de ces premiers habitants, mais elles étaient de portée limitée. "Les résultats divergeaient selon que le marqueur provenait de l'ADN mitochondrial, donc d'une lignée maternelle, ou du chromosome Y, indique le professeur Labuda. Notre étude a comparé des portions d'ADN de tous les chromosomes; elle se distingue par la qualité et le nombre de marqueurs et par le nombre de groupes ethniques étudiés."
Diversité linguistique
Selon les auteurs de cette recherche, les résultats confirment une hypothèse avancée au milieu des années 80 par le linguiste Joseph Greenberg, de l'Université Stanford en Californie, qui, à partir de comparaisons lexicales, concluait à des origines ethniques différentes pour les trois familles linguistiques en question. Ces travaux étaient appuyés par des données sur la morphologie dentaire et par une première étude en génétique.
Kevin Tuite, professeur d'ethnolinguistique au Département d'anthropologie de l'UdeM, est plutôt critique à l'endroit des travaux de Joseph Greenberg. "Il existe 1200 langues chez les autochtones des deux Amériques, mentionne-t-il. Greenberg laisse croire que les Paléoindiens avaient une langue commune, mais il est peu probable qu'une même langue ait donné autant de groupes linguistiques en 15 000 ans."
Sans remettre en question les résultats de l'étude de Nature, qui lui paraissent plausibles, il estime que le ou les groupes à l'origine des Paléoindiens parlaient déjà des langues différentes. "S'il y a eu trois vagues de peuplement, rien ne dit que les groupes de chacune de ces vagues parlaient une même langue. Des tribus nomades peuvent très bien être apparentées génétiquement, avoir des pratiques culturelles semblables, partager des méthodes de chasse similaires, mais parler des langues distinctes."
À son avis, la Sibérie d'il y a 15 000 ans pouvait être tout aussi diversifiée sur le plan linguistique que la Sibérie du 17e siècle, où l'on trouvait cinq ou six familles linguistiques malgré des pratiques culturelles communes. Pour expliquer la présence des 1200 langues autochtones aux structures très variées, il faut, selon le linguiste, soit une période de 20 000 à 30 000 ans si l'origine est commune, soit une diversité linguistique préexistante si le temps écoulé n'est que de 15 000 ans. Il opte pour la seconde hypothèse.
Par ailleurs, toujours selon Kevin Tuite, l'apparentement entre la famille linguistique na-dénée et des langues de Sibérie est maintenant bien étayé entre autres par des travaux sur la structure des verbes. Ce type de méthode, qui ne nous permet toutefois pas de remonter au-delà du Néolithique, a maintenant atteint ses limites et les linguistes doivent désormais compter sur les travaux en archéologie et en anthropologie physique pour continuer à remonter le temps.