Les pionniers font plus d'enfants
Publié par Isabelle,
Source: Daniel Baril - Université de MontréalAutres langues:
Source: Daniel Baril - Université de MontréalAutres langues:
2
Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)
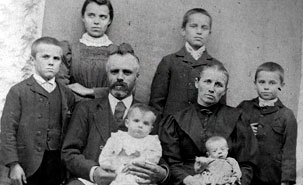
Le nombre d'enfants chez les femmes faisant partie d'une vague d'expansion est de 15% supérieur à celui des femmes des régions déjà colonisées.
"Les familles qui sont au premier rang d'une vague d'expansion sur un territoire ont plus d'enfants qui se rendent à l'âge du mariage que les familles demeurées à l'arrière, c'est-à-dire à l'endroit d'où la vague est partie", affirme Damian Labuda, professeur au Département de pédiatrie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et chercheur au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine.
Des travaux qu'il vient de publier avec cinq autres chercheurs dans le dernier numéro du magazine Science montrent que le taux de fécondité des femmes qui se trouvent au début de la vague est plus élevé que celui des femmes qui ne participent pas à l'expansion territoriale. L'observation découle de l'analyse de données démographiques des lignées descendantes de tous les couples mariés entre 1686 et 1960 dans les régions de Charlevoix et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, une généalogie comprenant près de 1,3 million de personnes et 88 157 mariages.
Mariages précoces
Le peuplement de la région de Charlevoix a débuté à Baie-Saint-Paul à la fin du 17e siècle pour s'étendre, à partir de 1838, le long du Saguenay et gagner ensuite le lac Saint-Jean, puis ses affluents dans la première moitié du 20e siècle. La fondation de chaque nouveau village (plus de 80 au total) constitue autant de fronts d'expansion permettant aux chercheurs de comparer le succès reproducteur des nouveaux colons avec celui des familles demeurées au coeur du centre de diffusion.
Dans l'ensemble, le nombre d'enfants chez les femmes faisant partie de la vague d'expansion est de 15 % supérieur à celui des femmes des régions déjà colonisées et la proportion de mariages chez ces enfants est de 20 % supérieure dans les familles du premier groupe. Le taux de mortalité infantile est quant à lui presque identique dans les deux groupes.

Damian Labuda
Selon les auteurs de l'étude, le mariage est plus précoce en contexte d'expansion parce qu'il y a moins de contraintes économiques à se marier tôt, les terres étant facilement disponibles pour les enfants et la compétition pour les ressources étant plus faible. "Si le taux de fécondité se transmet à la génération suivante, c'est sans doute parce que les enfants de ces pionniers vont à leur tour se retrouver dans d'autres fronts de peuplement, précise Laurent Excoffier, professeur à l'Université de Berne, en Suisse, et coauteur de l'étude. Les données démographiques montrent que 80 % des ancêtres des gens nés au Saguenay-Lac-Saint-Jean ont vécu directement au front ou tout près."
Effet de sélection
Ce plus grand succès reproducteur entraine une plus grande diffusion du patrimoine génétique des individus qui "montent au front". Les pionniers ont ainsi fourni de une à quatre fois plus de gènes aux populations actuelles de ces régions que ceux demeurés au centre de la zone d'expansion.
D'autres études, chez les microorganismes, ont déjà révélé que les premiers individus à coloniser un nouveau territoire connaissaient un succès reproducteur plus important. Le phénomène a même été observé au temps de la Nouvelle-France, les femmes de la colonie mettant au monde deux fois plus d'enfants que celles de la France.
"Les conditions propres à la colonisation d'un nouveau territoire sont donc propices à la sélection naturelle et cela a dû jouer un rôle notable dans l'évolution", ajoute le professeur Excoffier. Des mutations génétiques rares qui n'existaient que chez les pionniers peuvent ainsi devenir beaucoup plus fréquentes dans la population. Ce mécanisme de dérive génétique ou effet fondateur est d'ailleurs à la source de certaines maladies plus répandues dans la région, comme l'ataxie spastique de Charlevoix-Saguenay.
Évidemment, un tel effet ne concerne pas que les maladies mais tout phénotype reposant sur un profil génétique particulier. La colonisation de la planète par l'espèce humaine s'étant réalisée par une série successive de vagues d'expansion, les individus qui étaient au premier rang de ces vagues ont contribué plus que les autres à l'ensemble du patrimoine génétique de l'humanité, qu'ils ont ainsi façonnée. L'esprit explorateur et innovateur qui caractérise notre espèce pourrait y trouver sa source.
"Cette étude prouve toute l'utilité d'un fichier tel que BALSAC d'où nos données sont tirées", déclare Damian Labuda. BALSAC est une banque de données unique en son genre, hébergée à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), qui contient trois millions d'actes de mariage et de naissance se rapportant à près de cinq millions d'individus et couvrant près de quatre siècles d'histoire.
Les autres membres de l'équipe de recherche sont Claudia Moreau et Claude Bhérer, toutes deux du Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, ainsi que Hélène Vézina et Michèle Jomphe, de l'UQAC.