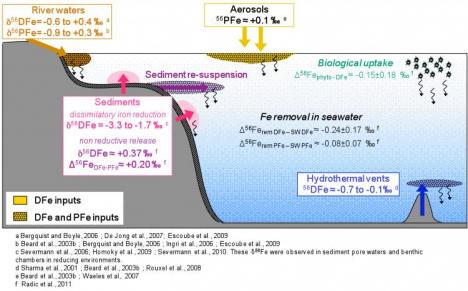Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)
Le fer est un élément micronutritif essentiel. Très abondant sur les continents, il est très peu concentré dans l'eau de mer car les composés qu'il y forme tendent à précipiter et à se déposer sur les fonds marins. On le sait, ce déficit en fer limite le développement du phytoplancton dans probablement la moitié de l'océan mondial. Le moindre changement dans sa concentration aura donc un impact sur la production biologique et les cycles biogéochimiques océaniques ce qui lui confère un rôle clé. Pourtant, un grand nombre de questions demeurent concernant son cycle océanique, lesquelles portent à la fois sur ses sources et sur ses transformations au sein de l'océan. À l'heure où certaines entreprises privées proposent de fertiliser l'océan avec du fer pour stimuler la croissance des algues et ainsi piéger du carbone et réduire l'effet de serre, il s'avère plus que jamais nécessaire de mieux connaitre ce cycle.

Profils verticaux des compositions isotopiques (?56Fe) et des concentrations en fer dissous dans les échantillons d'eau de mer collectés à deux stations du Pacifique équatorial, en fonction de la densité ?? de l'eau (les masses d'eau s'écoulent le long des lignes d'isodensité). La profondeur est également indiquée en chaque point. Les ?56Fe sont exprimés relativement au standard isotopique IRMM-14 qui sert de référence. La barre verticale grise indique la composition isotopique moyenne de la croûte terrestre. Les concentrations sont exprimées en nM, i.e. 10-9 moles par litre.
Ces données ont été obtenues sur des échantillons d'eau de mer prélevés en 2006 à deux stations de mesure du Pacifique équatorial, lors de la campagne EUCFe (navire de recherche Kilo Moana): une station côtière près de la Papouasie Nouvelle Guinée et une station localisée au centre du Pacifique équatorial (180°E, 0°N). Bien que distantes d'environ 4000 km, ces deux stations sont reliées entre elles, notamment par le sous-courant équatorial (EUC, situé entre 191 et 321 m de profondeur) qui transporte les eaux, et le fer qu'elles contiennent, d'ouest en est. Ces données ont permis de calculer le ?56Fe aux deux stations et à différentes profondeurs.
Des études antérieures suggèrent que le fer rencontré à la station côtière de Papouasie Nouvelle Guinée est principalement issu des sédiments de la marge continentale et il est généralement admis que la libération de fer depuis les sédiments s'effectue via des processus de réduction bactérienne. Si donc le fer à cette station a vraiment pour origine l'activité bactérienne dans les sédiments, son ?56Fe doit être franchement négatif car le fer réduit (Fe(II)) libéré par les bactéries a un ?56Fe compris entre -1,7 et -3,3 ‰ (fer léger). Or ce n'est pas le cas ! Les nouvelles mesures réalisées à cette station dans les eaux de l'EUC par ces chercheurs révèlent en effet un ?56Fe moyen de +0,37 ‰ (fer lourd) dans la fraction dissoute. Le fer dissous mesuré dans l'EUC ne proviendrait donc pas d'une réduction bactérienne, mais plutôt d'une libération non réductrice de fer à partir des sédiments, dont les processus sous-jacents restent à élucider (dissolution ? désorption ?).
Un second résultat important est que les compositions isotopiques contrastées du fer dissous dans le sous-courant équatorial (EUC) d'une part et dans les eaux intermédiaires (entre 400 et 800 m de profondeur) d'autre part ne varient quasiment pas au cours du trajet des eaux entre les deux stations, et ce malgré la grande distance (4000 km) parcourue par ces eaux et l'occurrence d'intenses soustractions de leur contenu en fer comme le montrent les diminutions des concentrations. Cela suggère que ces processus de soustraction ne modifient pas significativement la composition isotopique du fer dissous (fractionnements isotopiques associés faibles) et donc que ce nouveau traceur (?56Fe) devrait permettre, au moins en dehors de la surface, de contribuer à tracer l'origine du fer au sein de l'océan sur de longues distances.