Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)
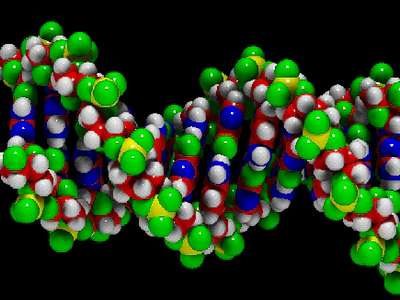
Représentation d'une section de la double hélice d'ADN
Les rayons ultra-violets, la fumée de tabac ou encore les benzopyrènes contenus dans la viande trop cuite provoquent des altérations au niveau de l'ADN de nos cellules qui peuvent conduire à l'apparition de cancers. Ces agents environnementaux détériorent la structure même de l'ADN, entraînant notamment des dégâts dits "encombrants" (comme la formation de ponts chimiques entre les bases de l'ADN). Pour identifier et réparer ce type de dégâts, la cellule dispose de plusieurs systèmes, comme la "réparation transcriptionellement-couplée" (ou TCR pour Transcription-coupled repair system) dont le mécanisme d'action complexe reste encore aujourd'hui peu connu. Des anomalies dans ce mécanisme TCR, qui permet une surveillance permanente du génome, sont à l'origine de certaines maladies héréditaires comme le Xeroderma pigmentosum qui touche les "enfants de la Lune", hypersensibles aux rayons ultra-violets du Soleil.
Pour la première fois, une équipe de l'Institut Jacques Monod (CNRS/Université Paris Diderot), en collaboration avec des chercheurs des universités de Bristol en Angleterre et Rockefeller aux Etats-Unis, a réussi à observer les étapes initiales du mécanisme de réparation TCR sur un modèle bactérien. Pour y parvenir, les chercheurs ont employé une technique inédite de nanomanipulation de molécule individuelle (1) qui leur a permis de détecter et suivre en temps réel les interactions entre les molécules en jeu sur une seule molécule d'ADN endommagée. Ils ont élucidé les interactions entre les différents acteurs dans les premières étapes de ce processus TCR. Une première protéine, l'ARN polymérase (2), parcourt normalement l'ADN sans encombre mais se trouve bloquée lorsqu'elle rencontre un dégât encombrant, (tel un train immobilisé sur les rails par une chute de pierres). Une deuxième protéine, Mfd, se fixe à l'ARN polymérase bloquée et la chasse du rail endommagé afin de pouvoir ensuite y diriger les autres protéines de réparation nécessaires à la réparation du dégât. Les mesures de vitesses de réaction ont permis de constater que Mfd agit particulièrement lentement sur l'ARN polymérase: elle fait bouger la polymérase en une vingtaine de secondes. De plus, Mfd déplace bien l'ARN polymérase bloquée mais reste elle-même ensuite associée à l'ADN pendant des temps longs (de l'ordre de cinq minutes), lui permettant de coordonner l'arrivée d'autres protéines de réparation au site lésé.
Si les chercheurs ont expliqué comment ce système parvient à une fiabilité de presque 100%, une meilleure compréhension de ces processus de réparation est par ailleurs essentielle pour savoir comment apparaissent les cancers et comment ils deviennent résistants aux chimiothérapies.
Notes:
(1) Dans ces expériences de nanomanipulation, l'ADN endommagé est greffé à une surface de verre d'un côté et une microbille magnétique de l'autre. La bille permet d'étendre l'ADN perpendiculairement à la surface et de mesurer son extension bout-à-bout par vidéomicroscopie. La fixation à l'ADN de diverses protéines, ainsi que leur action, est identifiable par la modification que la protéine génère dans la structure ou conformation de l'ADN. Cette technique permet une analyse structurelle et cinétique extrêmement fine de réactions biochimiques in vitro.
(2) L'ARN polymérase est responsable de la lecture de l'ADN d'un gène et sa réécriture sous forme d'ARN, processus connu sous le nom de "transcription".Il s'avère que l'ARN polymérase ne transcrit pas seulement les gènes, mais également l'ADN entre les gènes (jusqu'à récemment surnommé ADN "poubelle"), permettant par exemple à l'ARN polymérase d'effectuer son contrôle-qualité par TCR sur le génome entier d'un organisme.
Référence:
“Initiation of transcription-coupled repair characterized at single-molecule resolution”
Kevin Howan, Abigail J. Smith, Lars F. Westblade, Nicolas Joly, Wilfried Grange, Sylvain Zorman, Seth A. Darst, Nigel J. Savery et Terence R. Strick. Nature, en ligne le 9 septembre 2012