COVID-19: l'ozone pour désinfecter les chambres des patients ?
Publié par Adrien,
Source: Université LavalAutres langues:
Source: Université LavalAutres langues:
4
Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)
Pour faire cette démonstration, la professeure Caroline Duchaine et ses collaborateurs ont utilisé cinq espèces de virus inoffensifs pour les humains. Deux d'entre eux ont toutefois des similitudes avec les virus qui causent la grippe saisonnière et la gastroentérite.
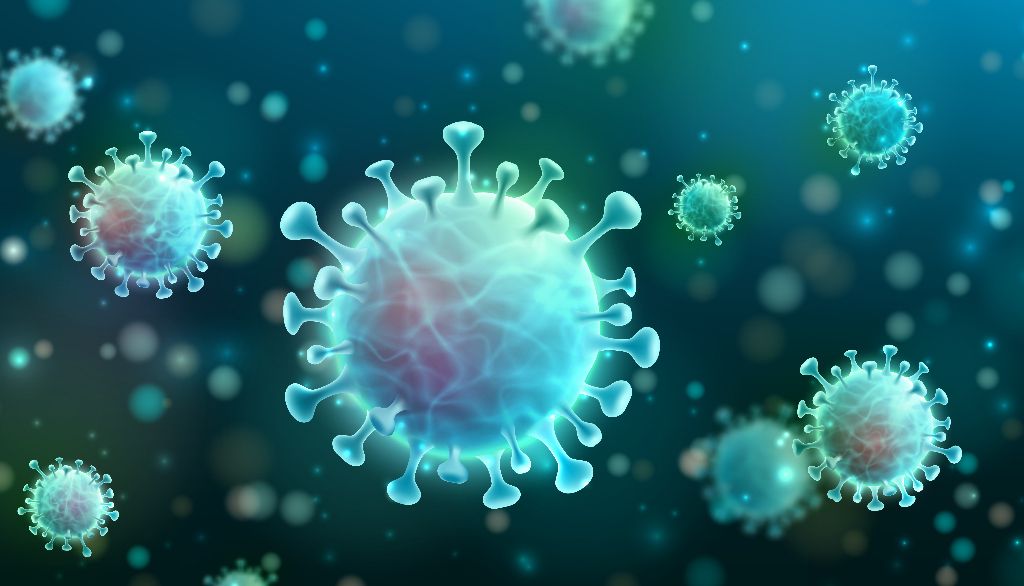
Illustration de coronavirus, similaires à ceux engendrant la maladie COVID-19
"Ces virus ont été mis en suspension, à l'aide d'un nébuliseur, dans une chambre expérimentale rotative de 55 litres, explique l'étudiante-chercheuse Marie-Eve Dubuis. Nous avons ensuite injecté de faibles concentrations d'ozone - environ 1 ppm - dans cette chambre et nous avons recueilli des échantillons d'air après des périodes d'exposition allant de 10 à 70 minutes."
Les résultats des tests indiquent que l'efficacité de l'ozone varie selon l'espèce virale et selon l'humidité relative dans la chambre expérimentale. "L'humidité est un facteur très important pour la survie des virus, signale l'étudiante-chercheuse. En général, ils détestent l'humidité."
Pour trois des virus testés, un traitement de 40 minutes à 85% d'humidité réduit de 99% leur abondance dans l'air. Pour les deux autres virus, un traitement de 10 minutes à 20% d'humidité produit le même effet. "Même à faible concentration, l'ozone est un puissant désinfectant contre les virus en aérosol lorsqu'il est combiné à un taux d'humidité adéquat", résume-t-elle.
Deux usages possibles
La professeure Duchaine entrevoit deux usages pour l'ozone en milieu hospitalier. D'une part, dans les hôpitaux où une partie de l'air est recyclée, on pourrait éliminer les virus en suspension en traitant l'air au moment de son passage dans les conduits de ventilation, suggère-t-elle. D'autre part, comme l'ozone est un gaz qui peut s'infiltrer dans les moindres recoins, on pourrait désinfecter à fond l'air et toutes les surfaces d'une chambre qui a été occupée par une personne infectée. "Dans les prochains mois, nous prévoyons étudier l'efficacité de l'ozone contre différents virus dans une enceinte étanche s'apparentant à une chambre d'hôpital."
Au moment où cette étude a débuté, en 2016, le coronavirus ne faisait évidemment pas partie des préoccupations de la chercheuse. "Nos travaux visaient surtout les norovirus qui causent la gastroentérite, rappelle-t-elle. Nous venions de publier un article qui démontrait que ces virus peuvent se propager sous forme d'aérosols dans l'air des chambres de patients infectés, dans les corridors et même dans les postes d'infirmières. Jusque-là, on pensait qu'ils se propageaient uniquement par contact direct."
Qu'en est-il du coronavirus ? "On sait que ce virus se propage principalement par l'entremise de gouttelettes émises par les personnes infectées, répond la chercheuse. Toutefois, une étude menée en laboratoire a démontré que les particules virales présentes dans les aérosols conservent leur potentiel infectieux pendant au moins trois heures. Dans les espaces clos ou mal aérés, les aérosols contenant des particules virales pourraient donc se retrouver à une distance considérable des patients infectés et poser un risque potentiel de contamination. Il s'agit toutefois d'une hypothèse qui n'a pas encore été validée."
Les signataires de l'étude parue dans Plos One sont Marie-Eve Dubuis, Nathan Leblond-Dumont, Camille Laliberté, Marc Veillette, Nathalie Turgeon et Caroline Duchaine, du Département de biochimie, de microbiologie et de bio-informatique et du Centre de recherche de l'Institut universitaire en cardiologie et en pneumologie de Québec. L'autre auteure est Julie Jean du Département des sciences des aliments.