Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)
Une année bissextile, telle que 2024, compte 366 jours au lieu de 365. Ce jour supplémentaire, inséré en février, corrige un déséquilibre entre notre calendrier et le temps réel que la Terre met pour effectuer une orbite autour du Soleil. En effet, une année solaire dure environ 365,24 jours. Sans les années bissextiles, ce décalage mineur s'accumulerait, décalant progressivement notre représentation des saisons.
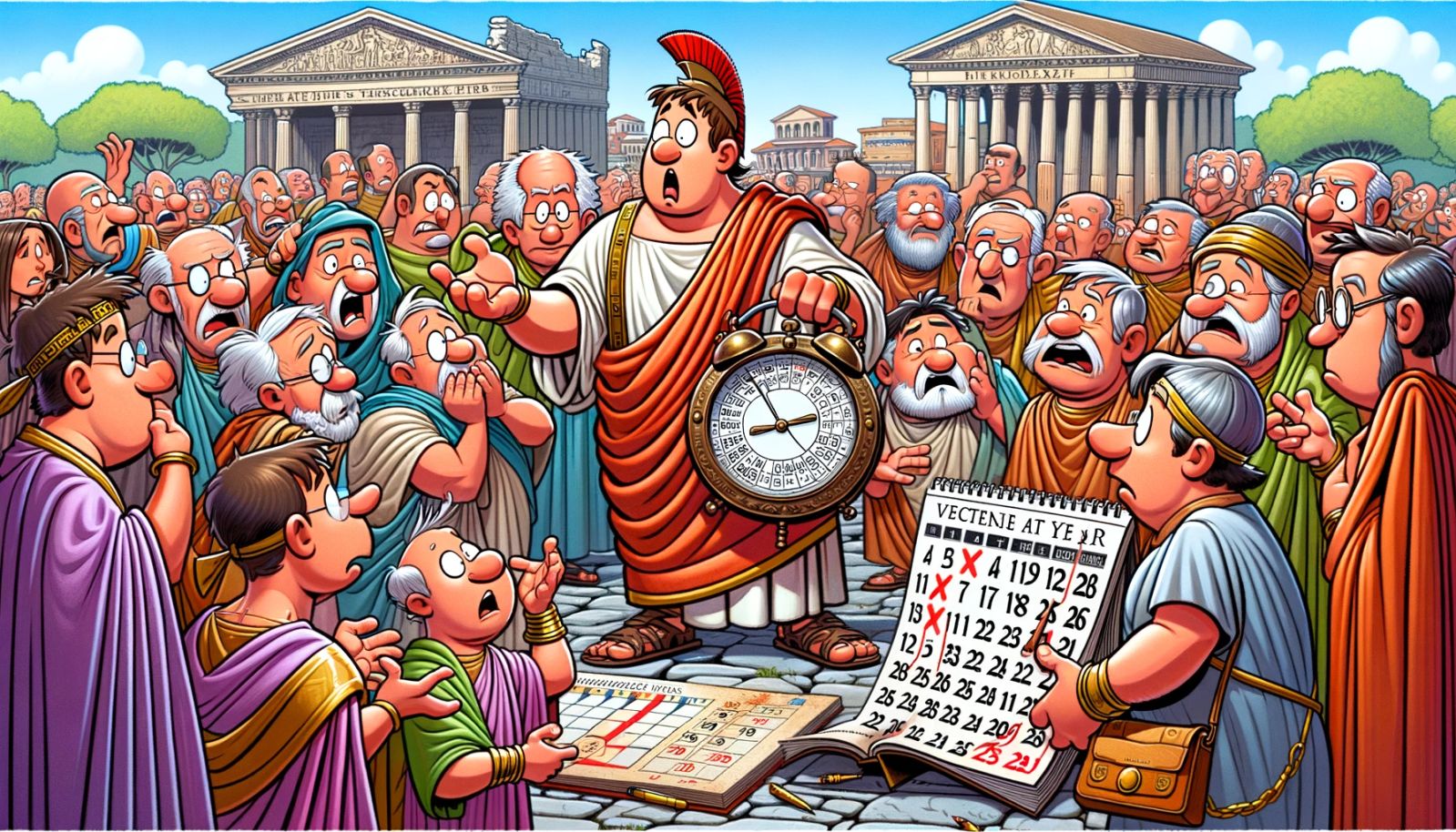
Le concept des années bissextiles remonte à Jules César en 45 av. J.-C., avec l'introduction du calendrier julien. Ce système, cependant, n'était pas tout à fait exact, menant au décalage des saisons et des célébrations importantes. Pour rectifier ces irrégularités, le pape Grégoire XIII a introduit le calendrier grégorien en 1582. Celui-ci, plus précis, exclut les années bissextiles pour les années finissant par 00, sauf celles divisibles par 400 comme l'an 2000.
Ce système, incluant des années bissextiles tous les quatre ans, sauf certaines exceptions, et même l'ajout occasionnel de secondes intercalaires, assure que nos calendriers restent alignés sur l'année solaire. Bien que les années bissextiles soient un concept commun dans le calendrier grégorien, d'autres calendriers, comme les calendriers hébraïque, islamique, chinois et éthiopien, ont leurs propres versions de l'année bissextile, mais avec des intervalles et des calculs différents.
La mise en place des années bissextiles est donc une solution ingénieuse à un problème astronomique, garantissant que nos calendriers restent au plus proche de la réalité.
Bissextile... Mais "bi" veut dire "deux", pas "quatre" ?
L'emploi du terme "bissextile" pour désigner les années comportant un jour supplémentaire peut sembler paradoxal, car "bi" signifie "deux" et non "quatre". Pourtant, l'explication réside dans l'histoire de la mesure du temps.
Dans l'ancien calendrier romain, avant l'introduction du calendrier julien par Jules César, les mois étaient organisés de manière à ce que chaque année compte 355 jours. Pour aligner le calendrier sur les saisons, les romains ajoutaient un mois intercalaire tous les deux ans. Cependant, ce système était imparfait et conduisait à des décalages significatifs.

César, avec l'aide de l'astronome Sosigène, a réformé ce calendrier en 45 av. J.-C., créant le calendrier julien. Dans ce nouveau système, au lieu d'ajouter un mois entier, on a choisi d'ajouter un jour supplémentaire tous les quatre ans au mois de février. Cette réforme a introduit la notion d'année bissextile telle que nous la connaissons aujourd'hui.
Le terme "bissextile" vient du latin "bis sextus dies ante calendas martii", signifiant littéralement "le sixième jour avant les calendes de mars répété deux fois". Dans l'ancien calendrier romain, les jours étaient souvent comptés à rebours à partir des "calendes", le premier jour du mois. Ainsi, le 24 février était traditionnellement appelé "le sixième jour avant les calendes de mars". Lors des années bissextiles, ce jour était compté deux fois pour réajuster le calendrier avec l'année solaire, d'où l'appellation "bissextile".
En résumé, "bissextile" ne se réfère pas au nombre quatre, mais à la répétition (bi) d'un jour spécifique (le sixième jour avant les calendes de mars) dans le calendrier julien. C'est cette répétition qui compense la différence entre l'année civile et l'année solaire.