Y-a-t-il un impact sur la rotation terrestre du séisme historique du Japon ?
Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)
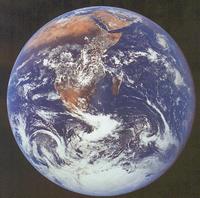
D'après des estimations fondées sur les paramètres sismiques (obtenus par l'US Geological Survey et l'Université de Havard), le séisme du Japon aurait fait basculer l'axe de figure de la Terre à la hauteur de 5 millisecondes de degré, soit 15 cm à sa surface dans la direction de 135° Est (l'axe de figure est l'axe principal d'inertie ayant le plus fort moment d'inertie, c'est en quelque sorte l'axe de symétrie de la Terre (issu de son centre de masse)). Cette estimation a été confirmée indépendamment par le JPL (Richard Gross, communication privée).
L'axe de figure, dont la direction n'est pas mesurable, ne doit pas être confondu avec l'axe de rotation. En théorie, au moment du séisme, l'axe de rotation ne "saute" pas comme l'axe de figure, mais son oscillation libre est rebroussée. Le mouvement du pôle de rotation par rapport à la croûte terrestre, la polhodie, découlant en grande partie des transports continuels de masse dans l'atmosphère et les océans, l'impact des séismes y est brouillé et pratiquement impossible à déceler.
Cependant la détermination astro-géodésique de la polhodie (par GPS, télémétrie laser sur satellite, et radio-interférométrie à très longue base), et la considération des transports de masse hydro-atmosphérique permet de reconstituer le chemin de l'axe de figure à la surface de la Terre et d'y isoler éventuellement le décalage induit par un méga-séisme. Jusqu'à présent cette quête n'a pas été fructueuse. Le séisme du Japon a provoqué un saut plus fort que ceux de Sumatra (2004) et du Chili (2010), et dans cette mesure l'analyse de ces prochains mois révélera peut-être un effet.
Finalement notons que l'effet théorique sur la vitesse de rotation ou la durée du jour, de l'ordre de 2 micro-secondes, est hors de portée des observations actuelles, et est sans commune mesure avec la variation journalière qui atteint 50-100 micro-secondes.