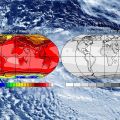Apoptose - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Fragmentation de l'ADN
Durant l’apoptose, l’ADN est digéré de façon très spécifique en fragments dont les tailles sont des multiples de 180 paires de bases, ce qui cause une distribution très caractéristique des fragments d’ADN en « échelle » lorsque qu'ils sont séparés par électrophorèse suivant leur taille. Cette taille est révélatrice de l'espacement entre deux nucléosomes consécutifs. Cette digestion est assurée par les protéines CAD (Caspase Activated DNase), existant en temps normal sous forme inactive en association avec une ICAD (Inhibitor of Caspase Activated DNase). Cette ICAD cache la séquence NLS de CAD et le clivage de cette association par une caspase va permettre à la protéine CAD de rentrer dans le noyau, qui jouera son rôle de DNase clivant l'ADN.
L'un des mécanismes de l'apoptose dans les cellules cardiaques post ischémiques semble consister en la nitration des protéines cellulaires par un excès de peroxynitrites [1]. Ces peroxynitrites induisent également l'apoptose des monocytes [2] et des lymphocytes T [3]
Par exemple quand les cellules ne reçoivent pas en permanence de leurs voisines des messages inhibant leur autodestruction, elles disparaissent spontanément.
Maladies ou affections induites par le blocage de l'apoptose
Les cellules cancéreuses sont généralement des cellules dans lesquelles ce mécanisme ne fonctionne plus. Elles survivent et se multiplient en dépit d'anomalies génétiques survenues au cours de la vie de la cellule, alors que normalement elles auraient dû être détruites par apoptose.
La réactivation du mécanisme d'apoptose a pu toutefois être obtenue chez des cellules cancéreuses de rat.
Certains pathogènes empêchent l'induction de l'apoptose, comme par exemple HHV8 (herpesvirus responsable du sarcome de Kaposi), qui code la protéine v-FLIP, empêchant l'apoptose induite par les récepteurs de mort.
Certaines maladies neurodégénératives comme les tauopathies, sont également des maladies où les mécanismes apoptotiques sont impliqués, conduisant à la survivance de protéine tau pathogène qui peut alors s'accumuler anormalement, jusqu'à la mort de la cellule nerveuse. C'est le cas de la paralysie supranucléaire progressive, de la maladie d'Alzheimer, etc.
Maladies ou affections causées par l’activation intempestive de l’apoptose
Des recherches récentes semblent montrer que le développement du sida en tant que maladie serait lié au déclenchement intempestif de l’apoptose des lymphocytes gérant la réponse immunitaire, ce qui permet le développement de maladies et infections opportunes. Cela ne remet pas en cause le rôle actif du virus VIH comme cause effective de cette maladie, bien que celui-ci soit bien détecté et tué par les lymphocytes.
Toutefois le blocage du virus par les anticorps produits par les lymphocytes conduirait le virus à produire avant sa destruction complète une réponse chimique de défense destinée à provoquer l’apoptose massive de tous les lymphocytes voisins, voire à faire fabriquer par les macrophages (qui absorberaient le virus neutralisé par les anticorps en même temps que le message chimique provoquant leur apoptose) cette réponse chimique qui provoquerait « à distance » le suicide de nombreux autres lymphocytes voisins alors même qu’ils n’ont jamais été directement en contact avec le VIH. En d’autres termes, le VIH provoquerait une réponse exacerbée du système immunitaire contre lui-même. C'est alors un effet « boule de neige », où un système morphologique est détourné de ses fonctions par une réponse non contrôlée, semblable à d’autres phénomènes auto-induits comme les allergies (elles aussi liées à un facteur déclenchant externe).
En provoquant cette réaction, une partie des copies du VIH parviendrait ainsi à échapper à l’action des lymphocytes T, dont un grand nombre se sont apoptosés après que quelques-uns d'entre eux seulement ont neutralisé de nombreux virus voisins. Cela expliquerait aussi pourquoi l'éradication totale du virus par le système immunitaire n’est pas possible sans une aide extérieure non sensible au phénomène de l’apoptose (une aide apportée par les médicaments anti-rétroviraux qui s'attaquent spécifiquement au VIH pour éviter que les lymphocytes s’en chargent en activant alors l'apoptose de leurs voisins par l'action ultérieure des macrophages éliminateurs).
La compréhension des mécanismes chimiques de l'apoptose pourrait ainsi pallier cette fragilité intrinsèque du système immunitaire, et permettre donc le développement d'un type de vaccin particulier, non destiné à activer la réponse immunitaire contre le VIH (puisque celle-ci a bien lieu naturellement et produit de nombreux anticorps) mais à bloquer le déclenchement intempestif de l'apoptose des lymphocytes T CD4 chargés de leur neutralisation (et de la neutralisation des autres sources d'infection). Dans le cas du sida, on ne sait pas exactement quel lymphocyte possède cette fragilité (dangereuse uniquement pour les autres types de cellules mais pas lui-même directement), mais on peut penser qu'elle se situe au niveau des macrophages chargés d'éliminer les virus neutralisés par les anticorps.
Ce comportement intempestif des mêmes macrophages (les poubelles de l’organisme qui peuvent générer par leur action des tas de produits toxiques et agents chimiques difficiles à éliminer isolément) est également impliqué dans d'autres types de réactions exacerbées de l’organisme comme certaines allergies (où cette réaction, très largement auto-entretenue, se fait à destination d'autres types de cellules que les lymphocytes immunitaires), et est soupçonné également dans d'autres types de maladies dégénératives (qui possèdent aussi un facteur déclenchant externe, pas nécessairement de nature infectieuse) ou certaines réactions exacerbées face à un stress (par exemple l'extension des brûlures).