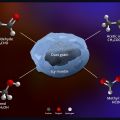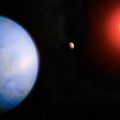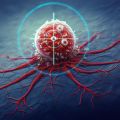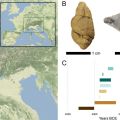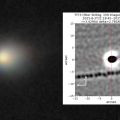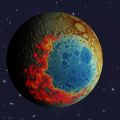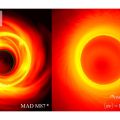Baillonella toxisperma - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Propagation
Le moabi se regénére mal car il n'est mature que vers 50 ans et ne produit des fruits qu'une fois tous les trois ans seulement. De plus, les plantules ont besoin d'être exposée à la lumière pour croître, ce qui n'est plus le cas dans des forêts denses fermées. L’exploitation forestière pratiquée sans discernement risque de conduire rapidement à une raréfaction de l'espèce. Dans certaines régions, la dynamique naturelle d'évolution des forêts a conduit à sa disparition, les conditions d'une régénération efficace n'étant plus réunies.
Tentatives de protection ou réimplantation
- Une campagne "Moabi, arbre de vie ou de profit?" a été lancée par les Amis de la Terre en 2004.
- Des moabis sont préservés dans quelques aires protégées du Cameroun (Forêt de Nki, Forêt de Boumba Bek et la réserve de Faune de Dja). Le Cameroun a replanté 389 hectares de B. toxisperma.
- Une expérimentation juridique existe au Cameroun : Sepuis 1994, le nouveau régime forestier reconnait le droit des populations locales à être associé à la gestion des forêts communautaires, et la loi impose que le contrat des compagnies forestières au Cameroun comprenne des conditions posées par les villageois avant que la compagnie ne commence ses activités. Un accord souvent conclu stipule que les moabis situés dans un rayon de 5 kilomètres du village ne peuvent être abattus sans l’accord du chef. Si ce dernier donne son accord, la population doit être dédommagée.
- Suite à la campagne de l'ONG les amis de la terre, certaines entreprises importatrices de bois tropicaux ont décidé de ne plus acheter de moabi pour ne pas menacer l'espèce (C'est le cas de Point P, filiale de Saint Gobain, dans le cadre de sa politique d'achat responsable (point P, avec ses 800 points de vente en France, était encore en 2005 l'un des premiers distributeurs de moabi en France). D'autres campagnes d'alerte et sensibilisation ont suivi, dont une campagne intitulée
- Le moabi est présent dans l'arboretum Sibang de Libreville au Gabon.
Menaces sur l'espèce
On considère que l'espèce a fortement régressé et a disparu sur une part significative de son aire de répartition récente ou potentielle. Elle est actuellement classée « vulnérable » sur la liste rouge des espèces menacées (UICN)
Comme souvent en forêt tropicale humide, les arbres adultes sont très éparpillés dans la forêt, loin les uns des autres (1 à 10 par hectare, et un grand arbre adulte pour 20 ha), et les plantules et jeunes arbres sont très rares, même sous la couronne des semenciers. Même là où l'espèce est encore présente, on suppose que sa variété génétique, qui était inconnue, mais qu'on peut supposer significative vu le mode de dissémination des graines, a été fortement réduite.
Un débat a lieu sur les menaces pesant localement sur l'espèce, notamment au Cameroun. Ces menaces seraient dues à l'exploitation à la fois des fruits par les populations locales et à l'exploitation commerciale du bois.
Dès le milieu des années 1980, des experts alertaient sur les menaces pesant sur l'espèce : Le moabi ne produit de fruits dans son habitat, que quand il a atteint environ 70 cm de diamètre (DMF), et s'il peut atteindre 280 cm de diamètre, on l’exploite généralement dès 100 cm (DME). Le temps écoulé entre le DME et le DMF est faible ; On admettait en 1985 qu'une exploitation au taux de 90% des troncs (compte tenu des tiges mal conformées et non prospectées) prélevait 75% des moabis fertiles, compromettant gravement la régénération de l'espèce à long terme. 30 ans après une coupe, seul un quart de l'effectif exploité est reconstitué, et il faudra 150 ans environ pour que la population retrouve une structure diamétrique stable (sans pour autant que la totalité des arbres coupés aient été renouvelés par la régénération naturelle).
Au Gabon, l'analyse de la structure des populations laisserait penser que l'espèce n'y est absolument pas menacée et qu'une exploitation durable de cette espèce serait encore possible.