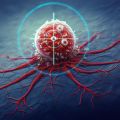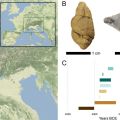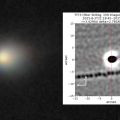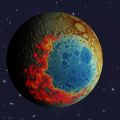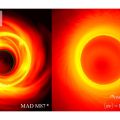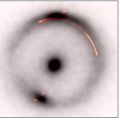Indicateur environnemental - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Ce qu'on cherche à mesurer
- - les impacts d’un produit, d’une activité ou du développement,
- - les dérives ou progrès par rapport à des valeurs précédemment enregistrées ou à des objectifs (amélioration ou dégradation par rapport à des valeurs-cibles qui peuvent éventuellement changer dans le temps ou l’espace),
- - les pressions exercées par l’ensemble ou une partie de la société sur l’environnement ou sur des groupes socio-économiques particuliers,
- - l’impact et la détermination de la responsabilité effective de groupes socio-économiques dans les divers phénomènes étudiés.
On cherche parfois à mesurer globalement et localement, dans l’espace et dans le temps, c’est-à-dire que l’on veut aussi apprécier des impacts différés dans l’espace, sur la biosphère et sur les générations futures.
Conditions minimales
Un indicateur (résumant éventuellement une somme d’indicateurs agrégés) doit :
- être durablement pertinent (ou remplacé par une série d’indicateurs utilisables successivement selon les époques et les contextes en fonction de la variabilité de sa sensibilité ou de sa pertinence dans le temps)... Par ex, les bioindicateurs d’utilisation plus complexes sont plus fiable pour mesurer l’état de l’environnement que les indicateurs classiques de teneurs en polluants qui ne tiennent pas compte des synergies ni ne mesurent tous les paramètres.
- être cohérent, précis, sensible et validé scientifiquement par l’ensemble des utilisateurs publics et privés (mais les problèmes de la validité de l’expertise, de l’interprétation des données et de la vérification de la saisie existent), et reproductible... Il faut donc que des valeurs de références reconnues existent.
- être accessible, dans un rapport Coût/bénéfice/temps acceptable
- être fiable, c’est-à-dire présenter une qualité régulière des mesures (afin de limiter les problèmes posés par les valeurs physiques ou monétaires différentes selon les époques et les lieux les mesures peuvent être alignées sur des valeurs “ universelles ”, telles les besoins vitaux, les équivalents habitants, équivalent toxique, le prix du pain, ou sur des grandeurs sans unité comme des pourcentages)
- éventuellement se prêter à l’agrégation avec d’autres données (problèmes d’échelles)
- tenir compte des différentes échelles de mesures ou d’appréciation (global/local )et des caractéristiques locales (ex zones urbaines)
- être suffisamment définis et souples pour s’adapter aux changements éventuels de méthodes d’analyse...
- être utilisable et compréhensible par le public (ex sous forme de cartographies évolutives, thématiques et de synthèse, graphes commentés, etc.)
la mesure
L’indicateur est un rapport (exprimé en %) de la donnée actuellement mesurée à sa valeur cible (ou guide). La somme des rapports des indicateurs thématiques à leurs valeurs-cibles correspondantes (en %) produit un indice de performance globale de la politique de développement et en l’occurrence de sa soutenabilité. Les objectifs sont : - scientifiques (connaissance et monitoring), politiques (planification, aide à la décision, prospective, état des lieux, gestion, organisation et contrôles locaux et globaux, évaluation des impacts et des performances des politiques, rétroactions) et pédagogiques (sensibilisation du public, des techniciens et des décideurs, écocitoyenneté). La question du choix des indicateurs implique une réflexion sur leurs limites, leur pertinence (sensibilité, représentativité, pertinence des valeurs-guides, des seuils, accessibilité aux données, indépendance à l’égard du champ de la conjoncture socio-économique), la manière dont on les utilisera, et la construction d’un modèle qui décrit la situation globale en fonction de ces indicateurs. Ce modèle est testé sur la base de situations passées et doit permettre de réaliser des prospectives. Il permet de définir et priorité les paramètres sur lesquels l’action politique doit porter et être mesurée. Le choix de l’indicateur est scientifique et politique. Il est recommandé de valider les indicateurs par des commissions thématiques de ce double point de vue.