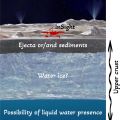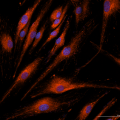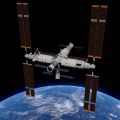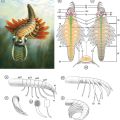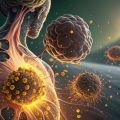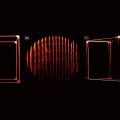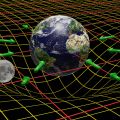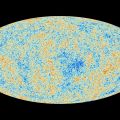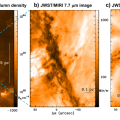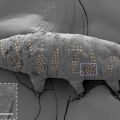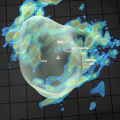Église paroissiale Notre-Dame-de-la-Basse-?uvre de Beauvais - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Introduction
| Église paroissiale Notre-Dame-de-la-Basse-Œuvre de Beauvais | |||
|---|---|---|---|

| |||
| | |||
| Latitude Longitude | |||
| Pays | France | ||
| Région | Picardie | ||
| Département | Département | ||
| Ville | Beauvais | ||
| Culte | Catholique | ||
| Type | Église paroissiale | ||
| Rattaché à | Diocèse de Beauvais | ||
| Fin des travaux | Seconde moitié du Xe siècle | ||
| Style(s) dominant(s) | Art préroman | ||
| Localisation | |||
| |||
| modifier | |||
L'Église paroissiale Notre-Dame-de-la-Basse-Œuvre de Beauvais (Oise) est une église située au pied de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais, date du Xe siècle.
La forme typique des basiliques romaines se caractérise encore à l'ère carolingienne, et particulièrement dans l'ancienne cathédrale de Beauvais, dite de la Basse-Œuvre, en comparaison avec le Nouvel-Œuvre, le chœur gothique.
La Basse-Œuvre, située timidement au pied de la masse de l'actuelle Cathédrale Saint-Pierre de Beauvais et face à l'Ancien Palais Episcopal de Beauvais (actuel Musée départemental de l'Oise), suscite l'intérêt de maints historiens de l'art.
Les vingt-et-une campagnes de fouilles d'Émile Chami ont mis en lumière ce monument.
Histoire
Notre-Dame de la Basse-Œuvre (ce nom lui appartient depuis le XIIIe siècle seulement) était primitivement dédiée à saint Pierre, à la Vierge et à saint Jean-Baptiste. L'édifice date de la seconde moitié du Xe siècle.
Rares sont les sources permettant une datation exacte de l'édifice. Un texte tiré d'un obituaire de la cathédrale datant de environ 1635, indiquerait comme maître d'œuvre l'évêque, mort en 998. En revanche, Emile Chami se fonde sur une autre source manuscrite anonyme du XVIIe siècle et propose comme datation l'époque de l'évêque Hugues, le prédécesseur de Hervé. Les fouilles et les relevés stratigraphiques confortent cette deuxième hypothèse.
Divers incendies au cours des siècles ont ravagé l'église, dont deux à la fin du XIe siècle, un à la fin du XIIe siècle, et un autre au début du XIIe siècle. Ces incendies provoquent le vieillissement prématuré du monument. Après l'incendie de 1225, la Basse-Œuvre se vit amputée de son extrémité orientale pour la construction monumentale du nouveau chœur, achevé en 1272. En 1510, elle fut une nouvelle fois amputée, lors de la construction du transept gothique, qui provoqua la destruction du reste de l'ancien transept carolingien, ainsi que de ses trois travées orientales. Enfin, vers la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle, ce sont encore trois travées qui sont sacrifiées pour la mise en place de deux contreforts qui étayent, du côté occidental, le transept de l'architecte Chambiges.
L'édifice a été restauré de 1864 à 1867, mais cette restauration est souvent jugée trop radicale du côté sud par les historiens de l'art. Le côté nord, lui, fut exempt de restauration, il donne sur le cloître de l'évêché dont l'aile occidentale date, elle aussi, du XIe siècle.
Le petit appareil, en remploi de pierre provenant de l'ancien rempart gaulois de la ville. Les claveaux des fenêtres du mur goutterot alternent avec des briques et des tuiles.
Les fouilles ont révélé une réédification de la façade de la Basse-Œuvre et des ajouts qui sont consécutifs aux incendies du XIe siècle. La façade actuelle n'est donc pas la façade originelle de l'édifice.