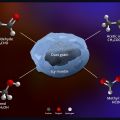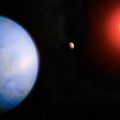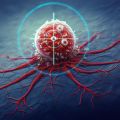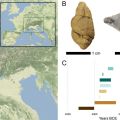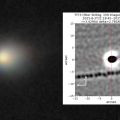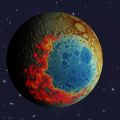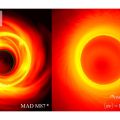Médicament générique - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Autres problèmes
Les impératifs de production à bas coût peuvent inciter certains fabricants de médicaments, génériqueurs ou fabricants de princeps, à contourner les normes de production coûteuses imposées par les autorités de santé.
Le génériqueur indien Ranbaxy a été en 2006 sous le coup d'une inculpation criminelle aux États-Unis pour avoir falsifié l'ensemble des données de bioéquivalence de ses produits génériques, mais l'administration américaine a reconnu par la suite avoir mal compris la documentation fournie par Ranbaxy. En parallèle, les autorités de santé américaines avaient interdit une trentaine de médicaments de ce laboratoire sur le sol américain et plusieurs traitements du SIDA à destination de l'Afrique financés par le gouvernement américain parce qu'ils étaient issus de centres de production indiens ne remplissant pas les critères d'innocuité imposés pour pouvoir être commercialisés et administrés sans danger.
Le 21 décembre 2009, Ohm laboratories, une filiale de Ranbaxy, a été rappelée à l'ordre par les autorités sanitaires américaines du fait des défaillances dans ses processus de fabrication. Furent concernés des génériques de médicaments antidiabétiques et des antidépresseurs.
Le 15 avril 2010, Ranbaxy rappelle deux lots de génériques d'antibiotiques car des patients ont découvert que ces copies changeaient anormalement de couleur au moment de leur reconstitution.
Le même jour, la FDA a rappelé à l'ordre le génériqueur Apotex, premier laboratoire pharmaceutique canadien, lui reprochant à nouveau des défaillances sérieuses dans les processus de fabrication de leurs médicaments génériques.
Le génériqueur islandais Actavis Totowa a dû procéder à un rappel de lots de digoxine susceptibles de contenir 2 fois la dose de substance active malgré une alerte des autorités de santé suite à l'inspection de leur site de production en 2006. Le 1 août 2008, le génériqueur a dû rappeler une soixantaine de médicaments génériques défectueux issus de son centre de production de Little Falls. Ce génériqueur détient plus de 50% du marché de la digoxine. Les médicaments incriminés auraient été commercialisés pendant près de 2 ans. Le nombre de décès imputables à ce défaut de qualité n'a pas été évalué.
Les laboratoires Ethex (qui produisent non seulement des génériques mais aussi des princeps) ont retiré volontairement du marché un lot de morphine susceptible de contenir 2 fois la dose en substance active.
Enfin le génériqueur suisse Sandoz (filiale du groupe Novartis, fabricant de médicaments princeps) a reçu des autorités de santé américaines une mise en garde concernant ses méthodes de production d'un médicament utilisé en cardiologie, le métoprolol ; cette même mise en garde a aussi été émise par l'Organisation mondiale de la santé qui a relevé 41 défaillances sérieuses par rapport aux Bonnes pratiques de fabrication.
Génériques des médicaments à faible marge thérapeutique : la controverse
Certains médicaments comme les médicaments antiépileptiques, les anticoagulants, les antidiabétiques, ou encore des médicaments utilisés en cardiologie possèdent une faible marge thérapeutique, c'est-à-dire qu'une très faible variation de la dose administrée suffit à rendre ces médicaments soit inefficaces, soit toxiques.
Le médicament générique contient la même quantité de substance active que le médicament de marque. Pour être bioéquivalent, on doit retrouver dans l'organisme qui reçoit le médicament générique une quantité de substance active similaire à celle retrouvée avec le médicament de marque, avec un intervalle d'acceptation de 80 à 125 %.
Suite à la publication d'un communiqué de presse de la Ligue Française Contre l’Épilepsie le 3 juillet 2007, prenant position contre la substitution générique des antiépileptiques, l'AFSSAPS a mené une enquête de pharmacovigilance et a interrogé les autres agences de santé européennes.
Au terme de cette enquête, il semble que la substitution princeps/générique soit un facteur associé à la survenue de recrudescence de crises chez les patients épileptiques, particulièrement pour l'acide valproïque et la lamotrigine. Dans le cas de la lamotrigine, on dénombre entre 20 et 40 notifications d'événements graves pour 100 000 patients-années sur la période, contre 191,1 pour le générique de Sandoz.
Les résultats de l'interrogation des agences européennes ont été présentés par l'Unité de Pharmacovigilance. Parmi les 18 pays ayant répondu aux infofax adressés par l'AFSSAPS en avril et octobre 2007, 8 pays ont pris des mesures concernant les médicaments génériques antiépileptiques. La Belgique et le Danemark ont ainsi décidé de resserrer les bornes de l'intervalle d'équivalence. Six pays ont interdit (Espagne, Finlande, Slovénie, Suède) ou encadré (Norvège, Slovaquie) la substitution de médicaments antiépileptiques par des génériques.
Malgré la demande de l'Unité, les raisons ayant conduit à ces différentes prises de position n'ont pas pu être obtenues. Les effets de l'application de ces différentes mesures ne sont pas connus non plus.
Les membres de la Commission Nationale ont souligné que le peu de données de l'enquête officielle de pharmacovigilance ne permettent pas d'affirmer que les cas rapportés sont liés à un défaut de bioéquivalence des génériques par rapport au princeps.
La Commission Nationale de Pharmacovigilance a donc proposé de ne pas restreindre la substitution pour cette classe de médicaments. En revanche, elle souhaite que soit rappelée au prescripteurs la possibilité d'exercer leur droit d'exclusion de la substitution en apposant sur leurs ordonnances, "non substituable" avant la dénomination de la spécialité antiépileptique prescrite (qu'il s'agisse d'un médicament princeps ou d'un médicament générique).
En juillet 2008, l'AFSSAPS, en l'absence de données complémentaires, a déclaré que l'excès d'événements indésirables chez les épileptiques ne semblait pas dû au statut du médicament (princeps ou générique) mais à l'effet anxiogène d'une substitution de traitement (effet nocebo) ; elle insiste donc sur le caractère bioéquivalent des médicaments génériques y compris anti-épileptiques mais recommande des pratiques de substitution douces et éclairées.