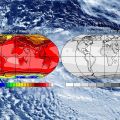Bougie - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Usage aujourd'hui
La bougie constitue toujours une source de lumière de dépannage, mais ses utilisations ordinaires ne sont plus de l'ordre de l'utilitaire.
Elle symbolise les années écoulées sur les gâteaux d'anniversaire ou sert de décoration des sapins de Noël (avec des risques importants d'incendie d'où son remplacement par des bougies électriques qui imitent les vraies).
Elle crée aussi l'intimité lors d'un dîner aux chandelles, au restaurant ou chez soi, à moins qu'elle ne se multiplie sur les lustres et les chandeliers dans des reconstitutions historiques parfois approximatives ou des réceptions.
Son emploi est toujours de mise dans les rituels religieux (on parle alors de cierge) comme le cierge pascal chrétien et participe à l'éclairage des cérémonies. La piété catholique est également toujours utilisatrice des bougies allumées en accompagnement d'une prière, tout particulièrement quand elle est adressée à la Vierge Marie ou à des saints : le geste de faire brûler un cierge en remerciement perdure très largement.
La bougie est aussi utilisée dans d'autres religions ou apparentés, telle la Wicca. Les bougies auraient plusieurs propriétés dites magiques selon leur couleur, leur odeur et leur forme.
La bougie peut être utilisée pour parfumer un lieu.
Autres usages : bougie auriculaire ou bougie d'oreille.
Fonctionnement
Le principe du fonctionnement de la bougie repose sur un phénomène d'auto-alimentation.
Une bougie est constituée d’un bloc de stéarine enrobé de paraffine dont le centre est traversé par une mèche, en fil de coton tressé imbibée d'acide borique.
Lorsque l’on allume la bougie, l’air surchauffé fait fondre la stéarine à proximité. La stéarine fondue monte le long de la mèche par capillarité où elle se vaporise et se décompose en un gaz combustible au contact de la flamme. Ce gaz combustible, en s'oxydant rapidement dans l'oxygène de l'air, entretient la flamme qui fait fondre la stéarine et la paraffine, entretenant ainsi le processus.
La paraffine, étant moins fusible que la stéarine, fond plus lentement, permettant la formation d'une coupelle au centre de laquelle se trouve la mèche. Ainsi, la bougie « coule » moins que les chandelles ou les cierges, ce qui permet une plus longue durée d'utilisation pour une quantité de matière donnée. Certains fabricants ménagent des cheminées dans le bloc de stéarine sur toute la longueur de la bougie, permettant ainsi à la stéarine fondue en excès de couler vers l'intérieur augmentant encore la durée d'utilisation.
La mèche d'une bougie est constituée d'une tresse de fils de coton qui se courbe vers le bas lors de sa combustion. L'extrémité de la mèche se trouve dès lors placée dans une partie extrêmement chaude de la flamme où elle est réduite en cendre. L'acide borique qui imbibe la tresse sert de fondant et la cendre de la mèche se liquéfie et tombe dans la stéarine fondue. Avec les mèches tressées et imbibées, l'éclairage à la bougie est devenu automatique, permettant plusieurs heures d'éclairage sans aucune manipulation.
En partant de la mèche, en allant vers le haut, la flamme d'une bougie comporte trois parties distinctes. Juste au-dessus de la mèche, se trouve une zone sombre qui correspond à l'échappement des gaz combustibles. Elle est suivie d'une zone bleue étroite dans laquelle les gaz combustibles entrent en contact avec l'oxygène de l'air et où se produit la combustion, la température de cette zone est d'environ 1 200 °C. Cette combustion est incomplète et laisse dans la troisième zone un résidu de particules de carbone qui sont chauffées à blanc (1 500 °C) par la combustion. C'est cette partie de la flamme qui est la partie éclairante d'une bougie. À mesure que les gaz et les particules s'élèvent vers le haut dans la flamme, leur température baisse et la couleur vire à l'orange et au rouge. Une bougie produit par principe des suies.
Une bougie s'éteint lorsque l'on souffle sur sa flamme, car on fait ainsi baisser la température au niveau de la mèche. La température est momentanément trop basse pour permettre la combustion des gaz combustibles s'échappant de la mèche et le processus d'auto-entretien de la flamme est interrompu. L'odeur de bougie que l'on perçoit à l'extinction d'une bougie est celle des gaz combustibles qui continuent de s'échapper de la mèche tant qu'elle reste suffisamment chaude pour fondre la stéarine.