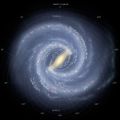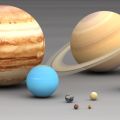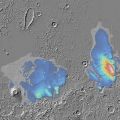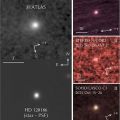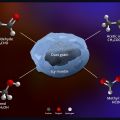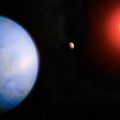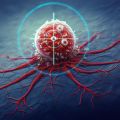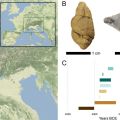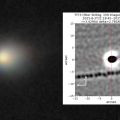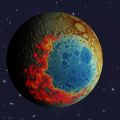Démocratisation de l'enseignement en France - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
La démocratisation ségrégative
Il existe des inégalités de recrutement social propres à des niveaux d’études donnés, par exemple au niveau des différentes séries des classes terminales (séries générales versus séries professionnelles), ou bien au niveau des différentes filières de l’enseignement supérieur : le recrutement social des université est nettement plus populaire que celui des Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (les débouchés sont également différents). Dans les périodes d’expansion de la scolarisation, comment ces inégalités inter-filières se transforment-elles ? De 1985 à 1995, période pendant laquelle le taux de bacheliers par génération est passé approximativement de 30% à plus de 60%, le recrutement social des différentes séries du baccalauréat s’est transformé d’une façon très singulière : ce sont les séries dont le recrutement est le plus populaire - les séries professionnelles - qui s’ouvrent socialement davantage. A contrario, la section scientifique conserve pratiquement le même recrutement social. Ce mouvement singulier est désigné par l’expression « démocratisation ségrégative » de l’accès au bac (Pierre Merle, 2002, 2009). Le premier terme de l’expression rend compte de l’élargissement social de l’accès au bac toutes séries confondues, le second de la divergence croissante du recrutement social entre les différentes séries du bac. Le même constat de démocratisation ségrégative vaut pour l’enseignement supérieur : l'accès s'est élargi sensiblement au cours du dernier quart de siècle du XXe siècle (1975 - 2000) mais de façon différenciée. Au début du XXIe siècle, l'université a un recrutement social plus diversifié alors que les classes préparatoires aux Grandes Écoles ont un recrutement social où les enfants des catégories aisées sont fortement sur-représentées.
Ressource
- http://www.democratisation-scolaire.fr, par le Groupe de Recherches sur la Démocratisation Scolaire (GRDS)
Bibliographie
- Merle, Pierre (2009), La démocratisation de l’enseignement, Paris, Repères, La Découverte.
- Xavier de Glowczewski, "les dispositifs de démocratisation de l'accès au supérieur", in B. Toulemonde (dir.), Le système éducatif en France, La documentation Française, Paris, 2009, p.229-233.