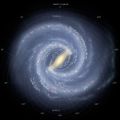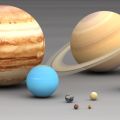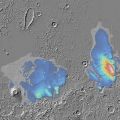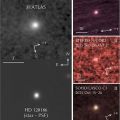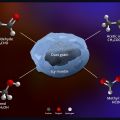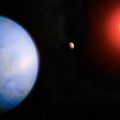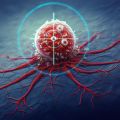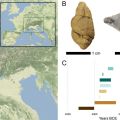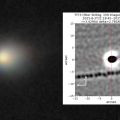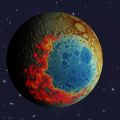Démocratisation de l'enseignement en France - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
La démocratisation « qualitative »
Pour Prost, la démocratisation « qualitative » constitue une autre préoccupation des réformes du XXe siècle : rendre le destin scolaire des élèves moins dépendant de leur origine sociale. Au début des années vingt, cette modalité de démocratisation a été favorisée par les Compagnons de l’Université nouvelle pour lesquels l’avènement d’un « enseignement démocratique » nécessite « l’école unique » et « la sélection par le mérite ». Cette sélection par le mérite s’oppose à la sélection via l’argent qui constitue le principe organisateur central de l’institution scolaire en 1920 (à l'époque, la scolarité est payante à l'entrée de la sixième).
Dans les années trente, la gratuité de l’enseignement secondaire a poursuivi un objectif d’égalisation des chances. Cette politique a eu pour objet « non d’augmenter le nombre de candidats au baccalauréat, mais simplement de faciliter l’accès de la culture secondaire aux enfants que leurs aptitudes y appellent, alors que la situation de la fortune de leur famille les en écarte. » (Circulaire de juillet 1928).
Le problème, évidemment essentiel, réside dans les modalités de mesure de cette égalisation sociale des trajectoires scolaires. En fonction des modes de mesure, certains chercheurs (Thélot et Vallet, 2000 [réf. incomplète]) considèrent que l'accès au baccalauréat toutes séries confondues a été marqué par une baisse des inégalités sociales au cours du XXe siècle. Cette conclusion est remise en cause lorsque la mesure porte sur certaines séries de baccalauréat, sur l'enseignement supérieur et notamment sur les grandes écoles. Dans les très grandes écoles (les « écoles de pouvoir », (ENS, HEC Paris, polytechnique, ENA), Albouy et Wanecq (2003 [réf. incomplète]) ont montré un accroissement de la proportion d'enfants d'origine aisée au cours des vingt dernières années. Dans ce cas, on assiste non pas à une démocratisation de ces écoles mais à un embourgeoisement de celles-ci.
Un objet de recherche toujours polémique
Le thème de la démocratisation de l'enseignement fait actuellement l'objet de trois interrogations essentielles.
Premièrement, comment expliquer le maintien des inégalités de cursus scolaires selon l'origine sociale ? Cette question fait l'objet de très nombreuses recherches. On se limitera à indiquer que les études internationales montrent que l'inégalité est plus grande dans des pays comme l'Allemagne où l'orientation scolaire est très précoce (à la fin de l'école primaire) alors qu'elle est plus faible dans les pays nordiques qui se caractérisent par un véritable collège unique.
Deuxièmement, alors que la diffusion considérable de l'accès à l'enseignement est incontestée, faut-il pour autant parler de démocratisation ? Le terme « massification » ne convient-il pas mieux si l'allongement des études n'a pas diminué les inégalités de cursus scolaires selon l'origine sociale ? L'inventaire détaillé de l'évolution des inégalités sociales de cursus selon les différentes filières de l'enseignement supérieur restent encore à mener.
Troisièmement, l’élargissement considérable de l'accès à l'enseignement supérieur est l’objet d'une opposition classique. D'un côté, cette évolution est analysée en termes d'inflation scolaire, source de désillusion pour les nouveaux diplômés (Marie Duru-Bellat, 2006 [réf. incomplète]) ; de l'autre (Eric Maurin, 2007 [réf. incomplète]), l'expansion scolaire doit se poursuivre. Elle serait profitable aux nouveaux diplômés et indispensable au développement économique. Les travaux récents de Louis Chauvel (2006 [réf. incomplète]) montrent toutefois la panne de l'ascenseur social et la déclassement professionnel que connaissent les nouveaux diplômés.