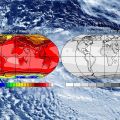Société zoologique de France - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Introduction
La Société zoologique de France est une société savante consacrée à la zoologie fondée en 1876. Elle édite un Bulletin et décerne le Prix Gadeau de Kerville de la Société zoologique de France.
Les origines
On considère parfois que l’apparition des sociétés savantes spécialisées durant le XIXe siècle est une réponse à la complexité croissante de la science à laquelle l’Académie des sciences ou la Royal Society ne pouvaient répondre, si ce facteur est exact, il n’est pas pour autant le seul. Les sociétés scientifiques créées au XIXe siècle sont, presque sans exception, fondées par un seul homme : Charles Adolphe Wurtz (1817-1884) pour la Société chimique de France et Paul Broca (1824-1880) pour la Société d'anthropologie de Paris c’est le cas également de la Société zoologique de France avec Aimé Bouvier (???-1919), marchand naturaliste et chasseur de fauves.
Pour promouvoir le lancement de la Société, une circulaire est publiée, signée par une quarantaine de personnes, des amateurs fortunés. Ce texte souhaite faire avancer la zoologie descriptive. Or celle-ci n’est pas à l’honneur auprès des zoologistes professionnels : un seul professeur du Muséum national d'histoire naturelle, Edmond Perrier (1844-1921), et un seul professeur d’université, Jacques-Amand Eudes-Deslongchamps (1794-1867), répondirent favorablement à cet appel. Cet inintérêt manifesté par les plus grands spécialistes n’incita pas les jeunes zoologistes, comme les aides naturalistes du Muséum, à adhérer à la Société, car elle ne permettait pas de fréquenter des personnalités influentes et la réputation de son bulletin était très modeste. La presque totalité des premiers membres étaient des notables : rentiers, juges, hommes politiques, médecins, commerçants, officiers, etc.. Cette composition n’était pas rare et correspondait à celle que l’on rencontrait alors dans d’autres sociétés comme la Société entomologique de France créée en 1832? ou la Société botanique de France créée en 1854.
La première réunion se tient dans l’appartement d’Aimé Bouvier le 8 juin 1876. Présidée par Jules Vian (1815-1904), elle réunit notamment Félix Pierre Jousseaume (1835-1921), Louis Bureau (1847-1936), Eugène Simon (1848-1924), Raphaël Blanchard (1857-1919) et Fernand Lataste (1847-1934). La vingtaine de présents vote les statuts, le bureau et se dota de Jules Vian comme président. Deux ans plus tard, la Société comptait plus de 160 membres dont un quart d’étrangers. Les séances de la Société attirèrent très tôt des visiteurs de marque comme l’empereur du Brésil, Pedro II, le 1er juin 1877.
La Société connut sa première crise en octobre 1878 avec la découverte d’un manque dans la trésorerie d’environ 5 000 Francs. On accusa Aimé Bouvier la responsabilité des différents problèmes que l’enquête révélat comme la disparition de certaines cotisations jamais versées à la caisse de la Société mais aussi la disparition de fascicules du Bulletin comme de volumes de la bibliothèque. Bouvier présente sa démission en 1880, elle est accompagnée de nombreuses autres dont cette d’Edmond Perrier. Les membres restant appellent alors et à nouveau Jules Vian à la présidence de la Société.
Du début du XXe siècle à la Seconde Guerre mondiale
La composition comme l’activité de la Société vont profondément se transformer au début du XXe siècle. Raphaël Blanchard devient professeur d’université et doit démissionner du poste de secrétaire général. C’est Jules Guiart qui lui succède. Le dernier président amateur, Paul Carié (1876-1931), est élu en 1923. En 1937, la présidence est détenu pour la première fois par une femme, Marie Phisalix (1861-1946). En 1938, le nombre de membres est de 390.
La France et l’Algérie comptaient moins de 30 chaires de zoologie au lendemain de la Première Guerre mondiale tandis que les effectifs ne dépassaient pas 150 personnes.
Cinq de ses membres se sont vu décerner le prix Nobel : Alphonse Laveran (1845-1922), André Lwoff (1902-1994), Elias Metschnikoff (1845-1916), Thomas Hunt Morgan (1866-1945) et Charles Robert Richet (1850-1935).