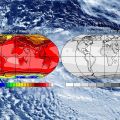Société zoologique de France - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
L’influence de Raphaël Blanchard
Ce sont Fernand Lataste et Raphaël Blanchard, deux jeunes chercheurs en histologie, qui vont donner un vrai essor à la Société. Lataste écrit en 1880 que ce ne sont plus seulement quelques branches mais la zoologie tout entière, sous toutes ses faces, descriptive et géographique, systématique et anatomique ou physiologique [qui]doit entrer dans nos attributions. La société ne pouvant demeurer dans l’appartement d’Aimé Bouvier s’installe dans les locaux de la Société géologique de France.
Celle-ci va se consacrer notamment aux travaux devant aboutir à l’adoption d’un code de règle de nomenclature zoologique. La Société présente ses propositions lors d’un congrès à Bologne en 1881 (parmi celles-ci, l’obligation d’ajouter des parenthèses au nom de l’auteur d’une espèce si celle-ci a changé de genre). Cette diversification de ses centres d’intérêt se manifeste dans les articles publiés au Bulletin : le premier article de zoophysiologie expérimentale paraît en 1886 et est signé par Raphaël Dubois, le premier grand travail d’histologie paraît en 1895 sous la plume de Hetch. Le Bulletin est aussi l’occasion de décrire les découvertes faites par les expéditions scientifiques du Travailleur et du Talisman. En 1888, sous l’impulsion de Raphaël Blanchard et Jules de Guerne (1855-1931), la Société se dote d’une nouvelle publication, ses Mémoires afin d’y publier les travaux les plus importants.
Le nombre d’adhérents augmenta et passa de 161 en 1878, 270 en 1889 et 367, un record, en 1897. L’essor de la Société porte un rude coup à d’autres sociétés savantes et notamment à la Société philomathique de Paris.
Alphonse Milne-Edwards (1835-1900) reçoit du gouvernement français les moyens d’organiser un grand congrès international de zoologie en 1889 au moment de l’Exposition universelle. Celui-ci se tourne vers la Société zoologique de France pour l’organisation de cette manifestation, Milne-Edwards en assurant la présidence. Le code de nomenclature zoologique n’est pas entériné par le congrès, du fait de l’opposition des zoologistes allemands, préférant leur propre système. Il en résultera vingt ans de conflits.
La société demeure, jusqu’à la fin du siècle, une société de bourgeois, masculine et parisienne