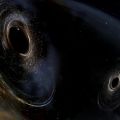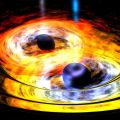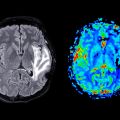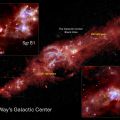Théorie de l'état de transition - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Limites de la théorie de l'état de transition et développements ultérieurs
Limites de la théorie de l'état de transition
De manière générale, la TST a fourni aux chercheurs un outil conceptuel pour comprendre le déroulement des réactions chimiques. Bien que la théorie soit largement reconnue, elle a ses limitations. Ainsi, la théorie postule qu'une fois que la structure de transition descend la surface d'énergie potentielle, elle donne un produit (ou un ensemble de produits). Cependant, dans certaines réactions, cet état de transition peut traverser la surface d'énergie potentielle d'une manière telle qu'il conduise à une sélectivité non produite par la TST. C'est le cas par exemple de la réaction de décomposition thermique des diazaobicyclopentanes proposées par E.V. Anslyn et D.A. Dougherty.
La TST est aussi basée sur le postulat du comportement classique des noyaux atomiques. De fait, on postule qu'à moins que les atomes ou les molécules se percutent avec assez d'énergie pour former les structures de transition, la réaction ne se produit pas. Cependant, selon la mécanique quantique, pour toute barrière d'énergie finie, il existe une possibilité que les particules puissent la traverser (effet tunnel). Si l'on considère les réactions, cela signifie qu'il existe une chance que les molécules puissent réagir même si elles ne se rencontrent pas avec assez d'énergie pour passer la barrière d'énergie. Bien que cet effet soit a priori négligeable pour des réactions avec des énergies d'activation importantes, il devient beaucoup plus important pour des réactions avec des barrières relativement basses, la probabilité de « tunneling » croissant lorsque la hauteur de la barrière décroît.
La théorie de l'état de transition échoue à décrire certaines réactions à hautes températures. La théorie postule que le système réactionnel passera par le point-selle de plus basse énergie, dont le point le plus énergétique est appelé état de transition, sur la surface d'énergie potentielle. Si cette description est cohérente avec les réactions se produisant à des températures relativement basses, dans les hautes températures, les objets chimiques occupent des modes d'énergies vibrationnelles plus élevés. Leurs mouvements deviennent plus complexes et les collisions peuvent conduire à des états de transition très éloignés de ceux prédits par l'énergie d'état de transition. Cet éloignement à la TST peut être observé même dans l'échange simple entre l'hydrogène diatomique et un radical hydrogène.
Étant données ces limitations, de nombreuses alternatives ont été développées.
Théories de l'état de transition généralisées
Toute modification de la TST pour laquelle l'état de transition n'est pas nécessairement localisé au point selle, telles que la TST variationnelle microcanonique, la TST variationnelle canonique ou la TST variationnelle canonique améliorée, est référencée comme une théorie de l'état de transition généralisée.
- TST variationnelle microcanonique
En anglais Microcanonical Variational TST. Un des développements de la TST dans lequel la surface divisante est modifiée de façon à minimiser la cinétique pour une énergie fixée. Les expressions cinétiques obtenues par un traitement microcanonique peuvent être intégrées sur l'énergie, en prenant en compte la distribution statistique sur les états d'énergie, donnant ainsi les cinétiques canoniques (ou thermiques).
- TST variationnelle canonique
En anglais Canonical Variational TST. Développement de la TST dans laquelle le position de la surface divisante est modifiée afin de minimiser la constante cinétique à température donnée.
- TST variationnelle canonique améliorée
En anglais Improved Canonical Variational TST. Modification de la TST variationnelle canonique dans laquelle, pour des énergies en dessous d'une énergie seuil, la position de la surface divisante est celle de l'énergie seuil microcanonique. Cela force les contributions aux constantes cinétiques à être nulles si elles sont en deçà de l'énergie seuil. Une surface divisante de « compromis » est ensuite choisie de façon à minimiser les contributions à la constante cinétique des réactifs ayant les énergies les plus élevées.