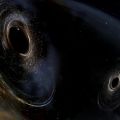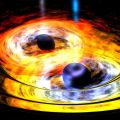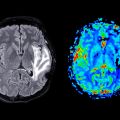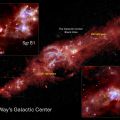Élisée Reclus - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Bannissement
Le 15 novembre 1871, le Conseil de guerre le condamne à la déportation simple (transportation) en Nouvelle-Calédonie. Une pétition internationale regroupant essentiellement des scientifiques anglais et américains et réunissant une centaine de noms (dont vraisemblablement Darwin), obtient que la peine soit commuée en dix années de bannissement. Pendant toute cette période d’emprisonnement, et malgré des conditions peu favorables, Élisée commence à rédiger certains de ses grands textes géographiques : Histoire d’une montagne, ainsi que les premiers éléments de sa Nouvelle Géographie universelle, dont la publication est poursuivie très régulièrement jusqu’en 1894.
À la suite de la décision de bannissement prononcée par le Conseil de guerre, Élisée et sa famille se rendent en Suisse, à Lugano puis à Vevey où ils resteront quelque temps. Il assiste au congrès de la Paix de Lugano (septembre 1872), et fonde une section internationaliste en 1876 à Vevey, avec son ami cartographe Charles Perron, qui dessina pour lui dans la Nouvelle Géographie Universelle. La section publie un journal, Le Travailleur, prônant notamment l'éducation populaire et libertaire.
En février 1874 sa compagne Fanny meurt en couches. Le 10 octobre 1875, il épouse Ermance Trigant-Beaumont et le couple se fixe à Clarens en Suisse romande, sur les bords du Léman, où il reste jusqu’en 1891. Pendant toute cette période il reçoit de nombreux révolutionnaires (dont Kropotkine). Il continue aussi à voyager (Algérie, États-Unis, Canada, puis Brésil, Uruguay, Argentine et Chili) ; en février 1886, il se rend à Naples et y rencontre le révolutionnaire hongrois Kossuth. Au début de 1891, Élisée et sa famille se fixent à Sèvres. En 1892, il reçoit la médaille d’or de la Société de géographie de Paris. Cette même année, à la suite de la condamnation de Ravachol, la situation devenant dangereuse pour lui, il décide d’accepter une proposition de l’Université libre de Bruxelles (ULB) qui lui offre une chaire de géographie comparée en lui décernant le titre d’agrégé. Ce cours est annulé au début de 1894, malgré des protestations d’une partie du corps enseignant au sein même de l’ULB et de la loge maçonnique « Les Amis Philantropes » qui avait été à l’origine de la fondation de l’ULB.
Il en résulta la fondation de l’Université nouvelle, inaugurée le 25 octobre 1894, qui lui permet de donner ses cours de géographie. Son frère Élie le rejoint pour y donner des cours de mythologie.
C'est en 1886 qu'Élisée Reclus va rencontrer à Bruxelles une jeune fille appelée à devenir célèbre par la suite : Alexandra David-Néel. Il a cinquante-six ans, elle en a dix-huit. Une forte amitié se noue entre eux, qui ne cesse qu'à la mort d'Élisée. Il eut sur sa jeune admiratrice une influence certaine : le premier ouvrage écrit par Alexandra David (Pour la vie) parut en 1898 avec une préface d'Élisée Reclus. Ils s'écrivirent à plusieurs reprises, notamment lors du séjour d'Alexandra à Hanoï, en 1895.
Après 1892, il occupa la chaire de géographie comparée de l'université de Bruxelles et fournit plusieurs mémoires importants aux journaux scientifiques français, allemands et anglais. En 1893 Élisée se rend à Florence pour témoigner dans un procès d’anarchistes italiens, qui sont relaxés. En 1898, il a la douleur de perdre sa fille cadette. Il fonde l’Institut géographique, qui dépend de l’Université nouvelle. Cette même année, il crée aussi une société d’édition de cartes géographiques qui fait faillite en 1904. C'est aussi au cours des années 1890 qu'il se lance dans un projet de construction d'un grand Globe, destiné à représenter fidèlement la Terre avec une maquette de plus de 127,5 mètres de diamètre, à l'échelle 1:100 000. Ce projet, qui devait être réalisé pour l'Exposition universelle de 1900, réunit Reclus, Charles Perron, l'urbaniste Patrick Geddes pour réaliser le relief de l'Écosse.
Durant les dernières années de sa vie, Élisée Reclus qui souffre d’angine de poitrine, voyage encore (France, Angleterre, Écosse, Berlin). Fin juin 1905, il apprend la révolte des marins du cuirassé Potemkine, ce qui constitue l’une de ses dernières joies. Il meurt le 4 juillet 1905 à Torhout, près de Bruges. Conformément à ses dernières volontés, aucune cérémonie n’eut lieu et il fut enterré au cimetière d’Ixelles, (commune faisant partie de l'agglomération de Bruxelles), dans la même tombe que son frère Élie mort l’année précédente.
Il est apparenté à Franz Schrader (1844-1924), géographe, alpiniste, cartographe et peintre paysager, fils de sa cousine germaine Marie-Louise Ducos, ainsi qu'à Élie Faure (1873-1937), critique d'art.