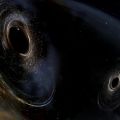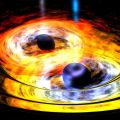Élisée Reclus - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Exil
Apprenant le coup d’État du 2 décembre 1851, les deux frères manifestent publiquement leur hostilité au nouveau cours des choses. Menacés d’être arrêtés, ils s’embarquent pour Londres où ils connaissent l’existence miséreuse des exilés.
Après avoir séjourné en Angleterre et en Irlande (où il est ouvrier agricole), Élisée quitte Liverpool pour les États-Unis à la fin de 1852 et débarque à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, début 1853. Il y exerce divers petits métiers (dont celui d’homme de peine), puis il est embauché comme précepteur des trois enfants d’une famille de planteurs d’origine française (les Fortier) de la région de la Nouvelle-Orléans. C’est au cours de cette période, où il observa de près le système esclavagiste qu’il a acquis sa haine de l’exploitation de l’homme par l’homme. Pendant ses vacances, il visite le Mississippi et va même jusqu’à Chicago. Bien que son employeur n’ait pas été parmi les plus féroces esclavagistes, Élisée ne supporte pas cet environnement et quitte la famille Fortier pour se rendre en Nouvelle-Grenade (actuellement la Colombie) afin d’y réaliser un projet d’exploitation agricole à Riohacha, dans la Sierra Nevada de Sainte Marthe. Malgré l’aide financière consentie par la famille Fortier pour son projet, des difficultés de toutes sortes (notamment la maladie), s’accumulent devant lui, l’empêchant de mener à bien son projet de créer une plantation de café.
Les idées d’Élisée Reclus
Le bannissement politique d’Élisée Reclus pour ses idées anarchistes a certainement été à l’origine de l’oubli relatif dans lequel il est aujourd’hui. Ce qui est cependant remarquable, c’est que, bien qu’Élisée Reclus ait toujours refusé d’être pris pour un « maître », on le présente souvent comme le fondateur de certains mouvements, ce qu’il n’aurait jamais accepté. Il a beaucoup écrit, notamment des articles, dans lesquels il développait ses idées ; à aucun moment il n’a imposé celles-ci. Minoritaire, il préférait se retirer du débat ; on peut ainsi citer au moins trois exemples de cette attitude. Tout d’abord en quittant la franc-maçonnerie où il ne se sentait pas à l’aise. Ensuite au congrès de la Ligue de la Paix à Berne en 1868. Enfin lorsque la maison Hachette lui imposa de mettre ses idées sociales en retrait lors de la rédaction de la Nouvelle Géographie universelle. En ce qui concerne les idées religieuses, il est remarquable de constater qu’Élisée Reclus, bien que formé dans sa jeunesse pour devenir pasteur, s’est complètement détaché de la religion et chacun des actes de sa vie en a été la démonstration la plus claire.
Il croyait fermement en la valeur du progrès qui seul, pensait-il, pouvait apporter une amélioration des conditions de vie et des relations entre les hommes.
Pour certains penseurs, dont Yves Lacoste, il serait le père de la réflexion géopolitique française (même si Reclus n'emploie jamais ce mot dans son œuvre).
L'un des aspects les plus marquants de la personnalité d'Élisée Reclus concerne, outre ses idées libertaires et anarchistes, sa faculté de penser et d'agir par lui-même. Autrement dit, sa libre pensée. En effet, avec ses frères, quelques amis et certains membres de sa famille, le géographe anarchiste adhère très tôt à la Fédération de la libre pensée créée en 1848, qui deviendra la Fédération nationale de la libre pensée (Paris).
L’anarchiste
Il s’agit sans doute de ce qui le définit en premier lieu. Élisée Reclus rédigea de très nombreux articles, prononça nombre de conférences sur le thème de l’anarchie. Il participa aussi à des congrès d’organisations ouvrières (AIT notamment, ligue de la Paix et de la Liberté) dans lesquels il se retrouva avec d’autres révolutionnaires libertaires (Bakounine, Kropotkine, Dumartheray, Jean Grave, James Guillaume, Max Nettlau). Il développa ses idées dans plusieurs brochures (le développement de la liberté dans le monde, Évolution et révolution, La peine de mort). De nos jours les mouvements anarchistes et libertaires se réclament encore de lui.
La franc-maçonnerie
Élisée Reclus et son frère Élie firent une brève incursion dans le monde de la franc-maçonnerie. Très rapidement ils s’en détachèrent (Élisée plus vite qu’Élie) et aucun ne remit les pieds dans une réunion, sauf lors de leur dernier exil à Bruxelles, mais pour y faire des conférences. La soif de liberté et d’indépendance de deux frères ne pouvait se satisfaire des rites présidant aux réunions des loges.
L’union libre
Élisée Reclus eut trois épouses, avec chacune desquelles le contrat social fut différent. Une constante fut cependant très marquée : il refusa toujours le mariage religieux.
- La première, Clarisse, qu’il épousa civilement à Orthez le 14 décembre 1858, et dont il eut deux filles, était d’origine Peul (sa mère était une Peul du Sénégal qui avait épousé un armateur bordelais). Élisée et Clarisse vécurent dix ans ensemble jusqu'à la mort de cette dernière en février 1869. Ce mariage avait une signification toute particulière pour l’antiesclavagiste de retour de Louisiane.
- Il s’unit avec la seconde, Fanny, en union libre (mariage « sous le soleil ») en mai 1870, à Vascœuil. Une très grande unité de vues entre les deux époux se manifesta tout au long de leur courte vie commune. Fanny mourut en mettant au monde un enfant qui ne vécut pas, en février 1874.
- C’est avec la dernière épouse (Ermance, qui lui survécut) qu’il passa les trente dernières années de sa vie. Ils se marièrent civilement à Zurich en octobre 1875. Ils n’eurent aucune descendance.
À l’occasion des unions libres de ses deux filles célébrées simultanément, il prononça une allocution dans laquelle étaient détaillées ses principales idées sur le mariage et l’éducation des enfants.
Le géographe
Il s’agit certainement de la définition d’Élisée Reclus la plus connue du grand public. Suivant des idées (le naturalisme) déjà développées par Carl Ritter (le géographe allemand du XIXe siècle), Élisée Reclus observa la nature et en déduisit de nombreux ouvrages de géographie (la Nouvelle Géographie universelle, en 19 tomes, et L'Homme et la Terre sont sans doute les plus connus) que l’on peut considérer comme une première tentative de faire de la géographie sociale : pour Reclus, il s’agissait d’inclure l’Homme dans le processus géographique. Il réfléchit aussi intensément à l’enseignement de la géographie et souhaitait mettre à la portée de chacun des outils originaux de compréhension (Projet de globe terrestre au 10 000e en collaboration avec l'architecte Louis Bonnier). Élisée Reclus se qualifiait volontiers de « géographe, mais anarchiste ».
L’espéranto
Dans la préface à l’ouvrage qui peut être considéré comme celui où il eut l’occasion de développer le plus complètement ses idées (L’Homme et la Terre), mais qui ne parut qu’après sa mort, Élisée Reclus évoque les langues internationales qui étaient en train de se développer, et il cite l’espéranto comme l’une des plus abouties. L’internationaliste convaincu qu’il était ne pouvait qu’applaudir à l’émergence d’outils devant faciliter les échanges entre humains.
Le naturisme
Élisée Reclus pensait que la nudité était l'un des moyens de développer la socialisation entre individus, il en vantait les bienfaits hygiéniques moralement comme physiologiquement, et il la mettait en perspective dans de vastes vues englobantes sur l'histoire et la géographie des cultures. Certains le considèrent comme le fondateur du naturisme.
Le végétarien
Très tôt rebuté par la viande, Élisée Reclus fut un « légumiste » convaincu, comme il aimait à le dire. Il partageait cette conception avec son frère Élie.