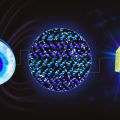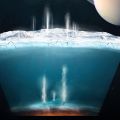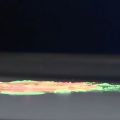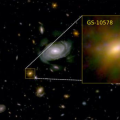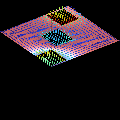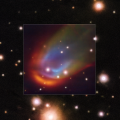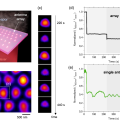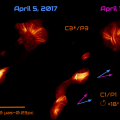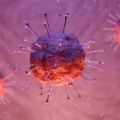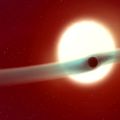Albert Mathiez - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Introduction
Albert Mathiez, né au lieu-dit de La Fouillie-des-Oreilles, sur la commune de La Bruyère, en Haute-Saône, le 10 janvier 1874 et mort à Paris le 26 février 1932, est un historien français, spécialiste de la Révolution française.
Biographie
Issu d'une famille de petits paysans propriétaires franc-comtois installés depuis plusieurs générations dans la région de Luxeuil, Albert Mathiez est le fils aîné de Constant-Aristide-Eugène Mathiez (1849-1909), un paysan franc-comtois devenu aubergiste en 1881, et de Delphine-Adélaïde Thiébaud, fille de cultivateur de deux ans sa cadette, mariés le 19 mars 1873. Né le 10 janvier 1874 à 17 heures, il est baptisé « Albert-Xavier-Émile ». Trois ans après la naissance d'un second enfant, une fille, en 1885, le couple divorce, et Delphine Thiébaud émigre aux États-Unis avec sa cadette. De son côté, Constant Mathiez s'installe dans le petit village de Saint-Germain, au nord de Lure, où il ouvre un cabaret et se remarie, avant de mourir à l'âge de 59 ans.
Au collège de Lure, Albert Mathiez remporte un grand nombre de prix durant trois ans (1887-1890), particulièrement en langues, en science et en histoire, avant de rejoindre le lycée de Vesoul à l'automne 1890. Remarqué par l'inspecteur général, il est envoyé à Paris l'année suivante et entre en 1891 au lycée Lakanal, à Sceaux, où il se lie d'amitié avec Albert Lévy, fils d'un rabbin alsacien, Louis-Victor Bourrilly et Charles Péguy. Là, il se prépare au concours d'entrée à l’École normale supérieure, dont il suit les cours après son service militaire de 1894 à 1897. Albert se distingue par ses opinions « avancées » et se proclame socialiste. Son caractère devient de plus en plus violent suite à un accident survenu en 1896 où il perd l’œil gauche. Il obtient l'agrégation d'histoire et géographie en 1897.
Professeur aux lycées de Montauban puis de Châteauroux, il se spécialise dans l’histoire révolutionnaire, rédigeant un mémoire sur les journées des 5 et 6 octobre 1789, et prépare une thèse d'histoire sous la direction d'Alphonse Aulard, qui le dirige vers l'histoire religieuse, domaine encore alors à défricher. Prolongeant l'étude pionnière d'Aulard sur le Culte de la Raison et de l'Être suprême (1892), il soutient en 1903 une thèse principale sur La Théophilantropie et le culte décadaire à la Faculté des lettres de l'Université de Paris. Puis, en 1904, il présente sa thèse secondaire portant sur Les Origines des cultes révolutionnaires (1789-1792), qui fait grand bruit, traitant à la suite d'Émile Durkheim le phénomène religieux comme un fait social et envisageant les manifestations de la foi révolutionnaire comme un ensemble cohérent perceptible dès les débuts de la Révolution.
Mais, en 1907, Mathiez se dirige vers Robespierre et fonde avec Charles Vellay (1876-1953), docteur ès lettres et éditeur des œuvres de Saint-Just, la Société des études robespierristes, dont il devient le président et qui regroupe des historiens et des hommes politiques. Cette société publie sous sa direction une revue, d'abord baptisée Les Annales révolutionnaires (1908-1923), avant de prendre le nom d’Annales historiques de la Révolution française; celle-ci entre en concurrence avec La Révolution française, que dirige Aulard. La brouille s’installe dès lors entre les deux hommes, le premier se montrant le défenseur de Danton, tandis que l’autre est le champion de Robespierre.
Après quelques années passées dans des lycées de province, Mathiez est professeur au lycée Voltaire, à Paris, quand le Ministère l'envoie comme chargé de cours à la faculté des lettres de Nancy en février 1908 puis à celle de Lille (octobre 1908-avril 1909), pour suppléer Philippe Sagnac. Devenu professeur à la faculté des lettres de Besançon en 1911, il est titulaire de la chaire d'Histoire moderne et contemporaine à Dijon de 1919 à 1926. En octobre 1926, il devient suppléant de Philippe Sagnac à la chaire d'histoire de la Révolution française de la Sorbonne.
Socialiste jusqu'en 1920, il s'enthousiasme pour la révolution d'Octobre et entre au Parti communiste français après le Congrès de Tours. Exclu en octobre 1922, il participe en décembre à la fondation de l'Union fédérative des travailleurs socialistes révolutionnaires, avant de s'associer, en 1923, à l'Union socialiste communiste, nouvelle formation politique constituée à Dijon. Puis il se rapproche de la SFIO et soutient le Cartel des gauches lors des élections législatives de 1924. En 1926-1927, il publie plusieurs articles dans la Nouvelle revue socialiste de Jean Longuet. De même, par réaction à la politique nationaliste du gouvernement Raymond Poincaré, il adhère au pacifisme dans les années 1920. En 1926, il signe un Appel aux consciences qui dénonce les clauses du traité de Versailles sur la responsabilité du déclenchement de la guerre et demande leur abrogation. Cinq ans plus tard, il adhère à la Ligue des combattants pour la paix, qu'il quitte cependant dès septembre 1931, au retour d'une tournée en Allemagne, jugeant que l'esprit de revanche qui règne dans ce pays hypothèque les chances de réconciliation.
Il s’intéresse de plus en plus à l’histoire économique et sociale de la Révolution. La Vie chère et le mouvement économique sous la Terreur fut publié seulement en 1927 mais qui marque une grande étape pour les recherches d’histoires révolutionnaires. C’est dans La Réaction thermidorienne publiée plus tard qu’il exprime le plus complètement ses idées.
En 1922, il se décide à présenter en une large synthèse ses vues d'ensemble sur la Révolution: ce sont les trois volumes de La Révolution française publiés dans la collection Armand Colin (et réedités en 1967 par Le Club Français du Livre), oeuvre inachevée car il n'eut pas le temps de dépasser le 9 thermidor.
Le 26 février 1932, il meurt en chaire en présence de ses étudiants, à l'amphithéâtre Michelet de la Sorbonne, d’une hémorragie cérébrale.