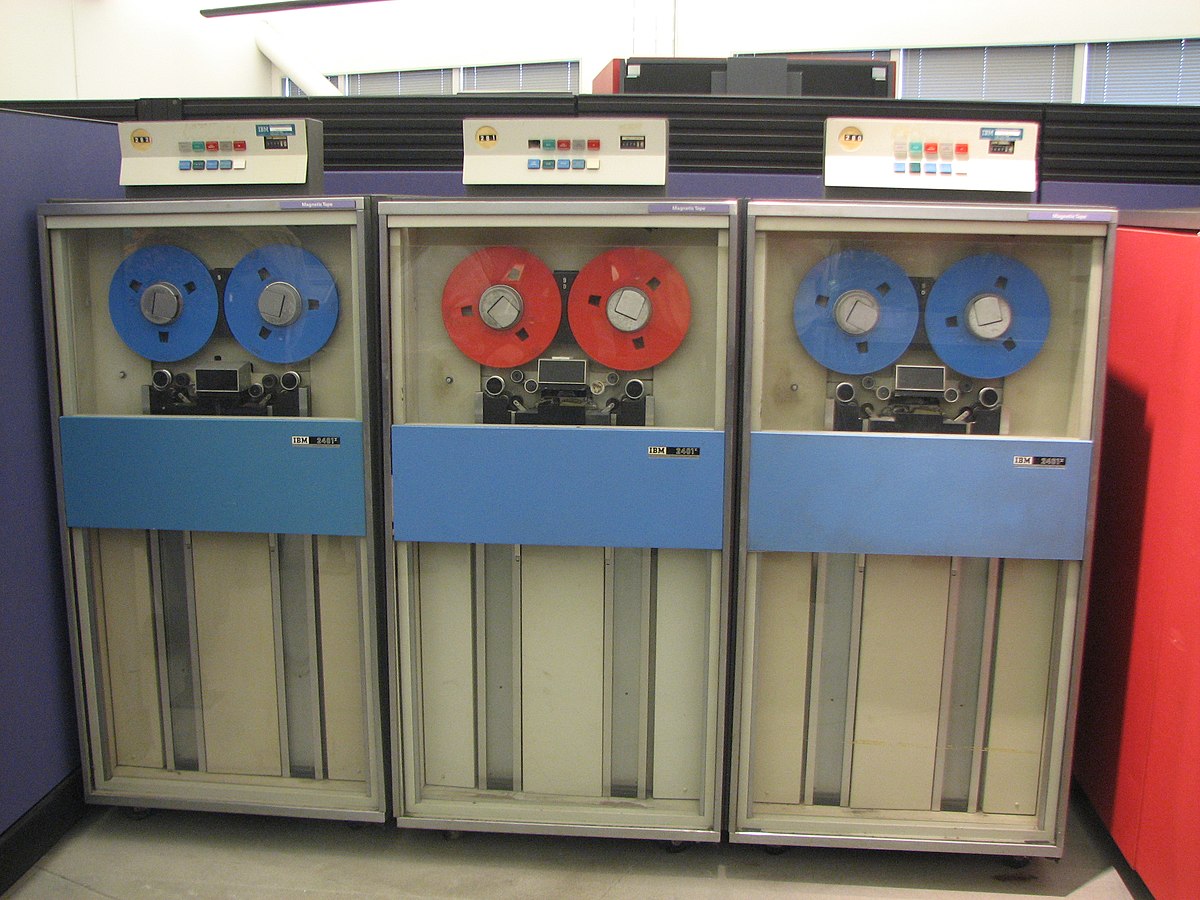IBM 360 et 370 - Définition
Source: Wikipédia sous licence CC-BY-SA 3.0.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Série IBM 360
Les 360 étaient munis de mémoires à tores de ferrite.
- 360/20 - Le plus petit des 360, pas totalement compatible avec le reste de la famille (deux fois moins de registres) et sans compatibilité binaire non plus. Il disposait en option d’un émulateur 1401. 4 à 16 Kio.
- 360/25 - Remplaçant plus tardif du 360/20, avec cette fois-ci une compatibilité complète. 4 à 32 Kio.
- 360/30 - La « 2CV » des 360, fonctionnant soit sous DOS, soit sous TOS (Tape Operating System). 8 à 64 Kio.
- 360/40 - La « R8 » de la gamme. A connu un très grand succès. Tournait sous DOS, OS/MFT ou même OS/MVT. 16 à 256 Kio.
- 360/44 - Le modèle « orienté scientifique ». Similaire au 40, mais avec un flottant câblé et non microprogrammé, ainsi qu’une mémoire plus rapide. Possibilité de travailler sur 4 à 8 octets de mantisse. Deux précisions de calcul flottant étaient sélectionnables par interrupteur de pupitre. Ne possédant que des instructions sur demi-mot (16 bits) et mot (32 bits), il n’était pas pénalisé par les questions d’alignements de double-mots. Possédait un système d’exploitation en propre, le PS/44. 32 à 256 Kio.
- 360/50 - Un modèle considéré comme puissant pour son époque, et réservé déjà aux grandes entreprises. 64 à 2048 Kio.
- 360/65 - Modèle de transition en attendant le 360/67.
- 360/67 - Premier et unique IBM 360 à mémoire virtuelle, et préfigurant donc le 370. Muni de registres associatifs, et pouvant être équipé en biprocesseur. Logiciel TSS largement développé à Grenoble, ainsi que son système CP/CMS. 256 à 2048 Kio.
- 360/75 - Le plus rapide des 360. Entièrement câblé, tandis que les modèles inférieurs étaient partiellement microcodés. Crédité pour son époque de la vitesse alors effarante d’un million d’instructions par seconde (MIPS). Ne fut cependant jamais l’ordinateur le plus rapide du monde, Control Data Corporation l’ayant devancé avec son modèle scientifique 6600.
- 360/85 (1968) - machine équipée d’un cache, alias antémémoire, afin de ne pas être ralenti par les accès à la mémoire à ferrite 12 fois plus lente lors de l’exécution de boucles en calcul scientifique. Disponibilité d’une précision flottante étendue, de 16 octets.
- 360/91 - Premier ordinateur comportant un mode pipeline. Entièrement câblé,sauf les instructions décimales (gestion), d’usage rare sur une machine scientifique et donc restant simulées par logiciel. Exécutant plusieurs instructions parallèlement, il introduit la notion d'« interruption imprécise », qui n’est plus signalée comme rencontrée à une adresse du programme, mais au voisinage de celle-ci, ce qui se révélera un cauchemar pour les programmeurs. Coût typique : 4 millions de marks (de 1970) pour celui du Max-Planck Institut de Garching, près de Munich (circa 1970).
- 360/95 - Un 91 équipé de mémoires bipolaires plus rapides au lieu de ferrites.
- 360/195 - Successeur plus rapide du 91, lui aussi entièrement câblé. Exista en version 360 puis en version 370, comportant les instructions du 370, mais pas la mémoire virtuelle de celui-ci.
Série IBM 390
Peu de nouveautés spectaculaires, hormis :
- 1995 : technologie CMOS plus économique ;
- 1999 :
- technologie de processeurs à substrat de cuivre (mieux refroidis et donc plus rapides),
- disponibilité et prise en charge officielle de Linux,
- capacity upgrade on demand (CUOD) ou possibilité de moduler dynamiquement le nombre de processeurs en fonction des besoins, pour écluser par exemple les pointes de charge venant d’Internet.
La notion de mainframe tend à s’effacer derrière celle de serveur, boîte noire dont l’architecture importe peu dès lors qu’elle répond dans les délais voulus aux transactions demandées.