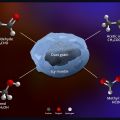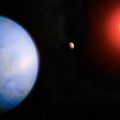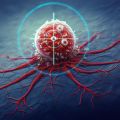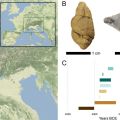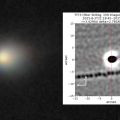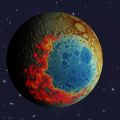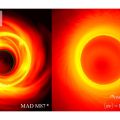Cancer pagurus - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Habitat, répartition
On le trouvait presque partout sur la façade atlantique de l'Europe, de la Norvège au sud-Maroc (voire plus au sud), et jusqu'en Mer Egée (Grèce) en méditerranée. Il est surtout abondant sur le littoral Nord Ouest de l'Europe et tout autour du Royaume-Uni
Relativement ubiquiste, cette espèce occupe une large niche écologique.
Elle était ou est encore localement trouvée par les pêcheurs à pied sur l'estran à marée basse, où ce crabe se cache alors sous les rochers ou dans leurs anfractuosité (de jeunes individus en général).
Il vit aussi plus loin des côtes sur des fonds rocheux, sableux ou sablo-vaseux, jusqu'a 200m profondeur, dans toutes les eaux marines fraiches bordant l'Europe, jusqu’à l’Afrique de l'Ouest. Il est présent, mais très rare en Méditerranée. En Bretagne sud, on le pêchait déjà à 200m dans les années 1980.
Pêche et filière agro-alimentaire
Suite à la régression d'autres espèces, le Dormeur est devenu (en terme de tonnage) l'un des crustacés les plus recherchés et pêchés en Europe.
- Il est pêché par des caseyeurs, au moyen de casiers appâtés (l'appât est appelé boette en Bretagne) et disposés en filières (en zone rocheuse ou à leurs abords). Le nombre de casiers par filière (10 à 40) varie selon les capacités du navire et de la stratégie de pêche retenue. Dès les années 1970, les plus gros caseyeurs pouvaient en Bretagne sud mouiller un total de 350 à 600 casiers, par filière de 40 à 60. Initialement artisanalement fait de bois et filet ils sont maintenant en plastique et nylon. A titre d'exemple, rien qu'en Bretagne-sud, les 6 Quartiers abritaient en 1980 : 373 caseyeurs, dont 335 de moins de 8 tonneaux, un seul faisant plus de 30 tonneaux. Ces navires disposaient de 10 650 casiers pour la flotte du Guilvinec, 13 000 pour Concarneau, 8 500 pour Lorient, 14 540 pour Auray, 7 500 pour Vannes et 5 000 à St-Nazaire, ce qui leur a permis de pêcher 3 B95 tonnes de dormeurs cette même année 1980.
En Bretagne nord, la flotte était surtout concentrée dans les « quartiers » de Paimpol, Brest et Morlaix avec respectivement 174, 160 et 128 caseyeurs - Le dormeur est aussi pêché par des chalutiers au moyen d'engins trainés (chalut de fond, qui endommagent les fonds.
- C'est aussi une prise accessoire des filets à soles ou d'autres engins (seules les pinces sont alors vendues)
Il peut être conservé un certain temps en vivier comme à Camaret-sur-mer. Cette pêche est surtout pratiquée en été et automne, d'avril à octobre en Bretagne-Sud.
Malgré une réglementation précisant une taille marchande minimale (donnée en largeur de carapace en France) une pêche annuelle quantitativement croissante jusque dans les années 1980 (milliers de tonnes de dormeurs capturés rien qu'en métropole), sauf certaines années en été lors des pics de production, la demande restait supérieure à l'offre (le marché Français importait à lui seul environ 6.000t de chair de crabe en 1986 selon la FAO). La règlementation française reprend une taille marchande proposée par les professionnels.
Depuis les années 1970, la pêche ciblée de cette espèce s'est substituée à celle du homard et des langoustes et des araignée de mer (Maia squinada), largement surexploités. Elle constitue un revenu important pour une pêche artisanale, dont en France pour divers ports de Manche et d'Atlantique.
Au début des années 1980, la Manche était la première zone de production, au bénéfice de flottilles bretonnes et anglaises assurant respectivement plus de 40 % du total européen des pêches devant la Norvège (10 %).
Le nombre d'individus prélevés est considérable. Selon la Marine Marchande, environ 10 000 tonnes de dormeurs avaient été débarquées et déclarées en 1980. Deux ans après, 8 700 tonnes auraient été pêchées, d'une valeur de 85 millions de francs, soit environ 40 % du total européen. Presque vingt an après (en 1999) le total des captures déclarées dans le monde selon la FAO s'élevait à 41 337 t (19 988 t pour le Royaume-Uni et 8 498 t pour la France, soit une diminution de tonnage pêché pour la France malgré des moyens techniques améliorés).
Bien que cette pêche soit récente (hors pêche à pied), des chutes de rendement sont observées depuis 20 à 30 ans dans certaines zones d'Europe. Cette régression de l'espèce a causé des reconversions ou au contraire une intensification de la pêche (plus profonde, plus instrumentalisée, et avec éloignement toujours plus au large des zones de pêche).
On cherche à mieux comprendre la croissance (modèle de von Bertalanffy...) et biologie de l'espèce (ex : étude des parasitoses, des zones de reproduction et corridors et vitesses de déplacements par marquage-recapture.
Pour preuve de sa fraicheur, cet animal généralement vendu vivant. Or ses pinces sont - comme celles du homard - très puissantes, suffisamment pour presque sectionner un doigt humain. Le tendon du muscle qui les ferme est donc généralement sectionné sur le bateau par le pêcheur lui-même, au niveau de l'articulation au moyen d'un outil tranchant. D'un point de vue bioéthique, c'est sans doute une source supplémentaire de souffrance pour l'animal, sans que l'on sache si elle est moindre que la pose de l'élastique sur les pinces du homards.