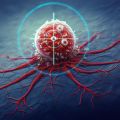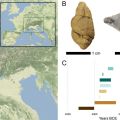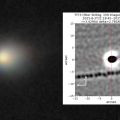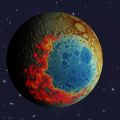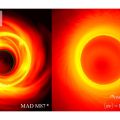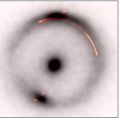Cancer pagurus - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Biologie
Bien que cette espèce soit commune dans toute l'Europe, sa biologie est encore pour partie mal connue.
Les donnée fournies par les crabes débarquées se limitent aux individus de taille commerciale (8 cm en France dans les années 1980) et ne sont précise que dans le cas de pêche localisée au casier. Des élevages expérimentaux de larves et juvéniles ont permis d'étudier leur croissance, et à partir de 50 mm, de jeunes crabes peuvent être marqués et suivis par des techniques de capture-recapture. Des expériences de marquage/captures-recapture ont été faites avec plusieurs milliers d'individus en Bretagne-sud et en Manche dès les années 1980. Les taux de recapture étaient de moins de 10 %.
Ces études permettent de mesurer la croissance des jeunes, mâles et femelles. On a ainsi montré que ce crabe ne gagne grandit pas nécessairement à chaque mue, et que la relation taille-poids diffère pour le mâle et la femelle, avec des différences observées selon les zones géographiques étudiées.
Elles montrent aussi que les femelles sont assez mobile, les mâles étant, dans les zones étudiées, plus sédentaires. La cartographie des points de capture-recapture ne laisse pas apparaitre des directions privilégiées de migration saisonnières ou annuelles comme c'est le cas avec les langoustes ou d'autres espèces.
Remarque : En milieu confiné (d'élevage en laboratoire ou in situ) le cannibalisme est fréquent au moment de la mue.
Alimentation
Contrairement à ce que pourraient laisser penser ses imposantes pinces, ce crabe n'est pas un grand prédateur des fonds marins du plateau continental. Sa larve se nourrit de plancton en suspension ou de matières organiques en décomposition filtrées dans l'eau.
Les tourteaux dormeurs adultes sont surtout détritivores ; nécrophages. Ce petit charognard marin. Ils jouent de ce point de vue un rôle important dans les écosystèmes marins qu'ils fréquentent, en éliminant les cadavres et les restes de proies qu'ils déchiquètent grâce à leurs pinces puissantes. Il est d'ailleurs appâté dans les casiers au moyen de cadavres frais de poissons sans valeur commerciale ou restes de raie et lotte, requins, congre, etc.
En complément, ils capturent aussi des proies fixées ou peu capables de fuite, appartenant à des espèces variées (crustacés et invertébrés/mollusques, dont vers marins sédentaires et gastéropodes).
Mues
La mue est un moment délicat pour tous les crustacés. 5 % des crabes captifs meurent durant la mue. C'est aussi (en captivité) un moment où les crabes font preuve de cannibalisme (c'est un des blocages à leur élevage). Chez les femelles, la mortalité lors des mues est bien moindre, car les mâles qui vont à ce moment se reproduire avec elles les protègent durant plusieurs jours (d'une vingtaine de jours avant la mue jusqu'à 10 jours après, selon les individus, et d'après les observations faites par Edwards (1971) sur 36 couples maintenus en captivités ; en moyenne cette durée de protection de la femelle par le mâle est de 8 jours en pré-mue et 5 jours en post-mue). Les mâles fécondants effectuent toujours leurs mues à un autre moment, ce qui leurs permettent toujours de protéger les femelles en mues.
La mue du crabe-dormeur se fait toujours sous l'eau, de nuit et loin de l'estran. Elle serait selon Aiken [1969] déclenchée par le système hormonal, activé par deux types de stimuli : température de l'eau et photopériode.
D'après les observations faites sur des animaux captifs, la mue dure de 30 minutes à 6 heures, durant lesquelles le crabe s'extraie de son ancien exosquelette ; c'est l'exuviation ; le bouclier dorsal se fend le long de lignes dites lignes exuviales. Il s'ouvre alors sous la pression du corps qui gonfle (voir pourquoi ci-dessous). L'abdomen puis les 8 péréiopodes en sortent et ces derniers poussent ensuite en avant l'exuvie pour en extraire le reste du corps en finissant par les pinces.
Dès le début de la mue et durant environ 24 h, l'animal gonfle en absorbant de l'eau (60 % du poids total du corps à ce moment). Dans les mois qui vont suivre (dits période d'"intermue"), cette eau sera peu à peu remplacée par les organes et la chair en croissance. Les crabes devenus mous sont vulnérables à leurs prédateurs durant 7 à 8 jours, mais il faudra 2 ou 3 mois pour que la chitine ait parfaitement consolidé la carapace. Le crabe en train de muer est vulnérable à ses prédateurs naturels, mais moins à l'homme, car cessant de s'alimenter pour quelques semaines, il n'est pas attiré par les appâts des casiers de pêche.
Les mues peuvent survenir toute l'année, mais sont nettement plus fréquentes au printemps et en été.
Une étude (en 1979) a montré en Bretagne-Sud 3 pics importants de mue ; en mai, juillet et octobre, mais ces pics étaient moins nets et décalés dans le temps l'année suivante (1980). Ces pics présentent une certaine corrélation avec les variations mensuelles de la température de l'eau ; les mues sont rares en dessous de 8°C et plus fréquentes au dessus de 10° C.
Croissance
Avant maturité sexuelle, l'accroissement de taille et poids à la mue sont comparables pour mâles et femelles, puis il diminuent à chaque mue, plus fortement chez les femelles. Des observations faites en Manche laissent penser que les mâles après qu'ils aient atteint une taille de 10 cm, muent 3 fois plus souvent que les femelles.
la croissance est moins rapide dans les eaux froides ; le jeune crabe atteint 80 mm de longueur (350 g) à 3 à 4 ans en Bretagne-Sud/Golfe de Gascogne, alors qu'il lui faut presque le double (5 à 6 ans) en Mer du nord. Des données anglaises, intermédiaires donnent un poids moyen de 450 g vers 5 ans, 1kg vers 7 ans et 1,5 kg vers 15 ans. on connait mal les cycles de mues à grande profondeur (vers 200 m)
Reproduction
Elle a commencé à être étudiée il y a plus d'un siècle à l'Est de la Grande- Bretagne (Ecosse, Northumberland) par WILLIAMSON (1904), PEARSON (1908), L.EBOUR (1927-1928) et plus tard par, EDWARDS et MEANEY (1968) dans les eaux du Norfolk du Yorkhshire et du sud-Irlande.
Le tourteau est une espèce gonochorique, c'est à dire à reproduction sexuelle obligatoire. Les glandes génitales mâle et femelles sont abritées dans le céphalothorax à la surface de l'hépatopancréas. Les femelles semblent mature quand leur carapace atteint 73 mm.
Les dates de fécondation et fécondité varient selon la température et le milieu. En Bretagne sud, un début de développement ovarien apparait en juillet. Il se poursuit jusqu'en mars de l'année suivante où de mars à juin la femelle est sexuellement non active. Le mâle semble sexuellement mâture plus tôt, dès 65 mm.
- Accouplement : La femelle ovigène ne se nourrit pas. Le mâle, attiré par une femelle mâture et prête à muer se tient sur elle, jusqu'à ce qu'elle mue. Après la mue, elle devient réceptive. C'est alors que la copulation se produit, souvent de nuit et pouvant durer plusieurs heures.
- Le sperme est stocké par la femelle dans une spermathèque où il est conservé vivant plusieurs mois, alors que des bouchons spermatiques apparaissent sur les orifices génitaux de la femelle (sous la languette abdominale). Elle n'est donc plus fécondable avant mue qui suivra la ponte qui ne se produira que plusieurs mois après, jusqu'à un an plus tard ; ceci explique que les jeunes femelles semblent pouvoir être fécondées avant leur maturité ovarienne. En captivité plusieurs pontes successives ont été observées après une seule fécondation, mais l'auteur ne précisait pas si les oeufs étaient fertilisés.
Williamson (1940) a supposé que le sperme contenu dans la spermataèque pouvait inhiber le déclenchement de la et donc la croissance de femelles. On a longtemps pensé que les bouchons empêchaient la fécondation par plusieurs mâles, mais des études génétiques de larves, montrent qu'au moins parfois, plusieurs mâles ont pu féconder une même femelle. Il pourrait aussi s'agir du sperme ancien d'un cycle de reproduction antérieur, conservé encore vivant dans la spermathèque, qui se serait mélangé avec celui du dernier mâle.
- Le frai (la ponte) survient en hiver, de novembre à février-mars en Bretagne-Sud. A l'émission des oeufs (collants), la femelle les récupère en les fixant sur les soies qui garnissent les pléopodes de ses pattes natatoires.
- La femelle est ensuite dite « ovigères » (qui signifie "porteuse d'oeuf) ou « grainée ». A ce stade elle ne se nourrit pas, et se cache probablement soigneusement, car elle est rarement pêchée ou observée. Elle porte jusqu'à 20 millions d'œufs fécondés. Le nombre d'oeufs varie fortement selon l'âge et la taille de la femelle ; par exemple en Bretagne sud, les femelles de 75 mm ne portaient que 257.103 oeufs, alors qu'elles en portaient 433.103 à 85 mm puis 683.103 oeufs à 85 mm, puis en moyenne 1046.103 à 105 mm. Plus tard, elles pourront produire plus de 2 millions d'oeufs.
- L'éclosion se produit au printemps, dès avril avec un maximum vers mai, et moindrement jusqu'en septembre-octobre en Bretagne-Sud.. Cette période semble plus courte sur les côtes du Yorkshire et du sud-ouest de l'Irlande EDWARDS (1979) (mai à septembre),
- Au stade suivant, les œufs ont éclos (« dégrainage ») et ces femelles qui portent encore quelques capsules vides collées sur les soies des pléopodes des pattes natatoires semblent alors s'activer pour se nourrir. C'est le moment où elles sont capturées en grand nombre.
- Après la naissance, les larves sont planctonniques jusqu'au 30e jour ; Ce sont d'abord des larves zoé typiques, puis des mégalopes à grands yeux. La très grande majorité des larves meurent à ce stade, mangées par un grand nombre de "prédateurs".
Migrations
En 1914, on s'intéresse déjà aux migrations des crabes. De nombreux indices laissaient penser que comme d'autres espèces de grands crustacés, les dormeurs pouvaient effectuer d'importantes migrations (dépassant 260 km pour de femelles observées en Atlantique nord). Le premier de ces indices était que les dormeurs les plus gros sont toujours trouvés au large, et que ceux qui sont pêchés près du trait de côte sont plus petits. Il semblait donc que les individus migraient au fur et à mesure de leur vie vers le large et les zones plus profondes. Les études ont montré que dans la plupart des cas, la migration se fait effectivement dans des directions privilégiées (à partir des points de lâcher) Edwards (1965, 1967, voir bibliographie en bas de page), Hallback en Suède (1969), Benett & Brown dans le Channel (de 1968 à 1976),. Il existe cependant des exceptions (a priori dans des zones de golfes à faibles courant et courants giratoires). Ailleurs, les déplacements se font nettement dans le sens opposée à la dérive résiduelle des courants marins. Une explication plausible étant que la femelle doit « compenser, en l'anticipant, la dérive que subissent les larves au cours de leur vie pélagique ».
Ces migrations jouent aussi indirectement un rôle important pour le brassage génétique et la large répartition biogéographique de l'espèce.
De premières expériences de marquage de l'exosquelette ou de pinces (claw-tag) de crabes vivants et ensuite relachés ont été faites il y a plus d'un siècle, dans les eaux écossaises avant 1900 puis à l'Est de l'Angleterre par MEEK (1914), TOSK (1906), DONNISON (1912).
D'autres expériences de suivi ont été faite à la fin des années 1930 et des années 1950 par Williamson (1940) et Mistakidis (1960). Chaque marque étai perdue avec la mue, et les données restaient donc très partielles. On a pu mieux suivre les déplacements pluriannuels grâce à de nouvelles techniques de marquage : « toggle-tag » et « suture-tag » qui ne sont pas perdues par le crabe lors des mues.
En Bretagne sud, on a constaté que, comme ailleurs, les femelles sont beaucoup plus nombreuses à être capturées par les pêcheurs que les mâles ; probablement parce qu'elles se déplacent et s'exposent beaucoup plus : 39 % des dormeurs recapturés s'étaient déplacés à plus de 5 milles, parmi ce lot, 91 % étaient des femelles. 87 % des mâles recapturés avaient effectués moins de 5 milles (soit 43 % de la population recapturée sur le site de marquage).