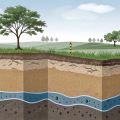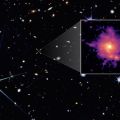Église Saint-Louis-en-l'Île - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Première église
En 1614, le roi Louis XIII confie à Christophe Marie, entrepreneur général des ponts de France le soin de viabiliser l'île en y construisant un pont, des quais et en lotissant les terres, jusqu'alors principalement des marais et des pâturages, pour la rendre habitable.
En 1623, sur demande des premiers habitants de l'île aux Vaches, le chapitre de la cathédrale, propriétaire des lieux, fait construire une chapelle et en juillet de la même année, érige une paroisse indépendante. Cette église, appelée dans un premier temps Notre-Dame-en-l'Île sera rebaptisée Saint-Louis en 1634. Cette première église avait son chœur orienté vers le sud, et sa façade donnait sur la rue centrale de l'île. Elle était entourée d'un cimetière et d'un marché.
Période contemporaine
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la ville de Paris ainsi que de nombreux particuliers font don d'œuvres d'art à l'église (vitraux et peintures). Louis-Auguste Napoléon Bossuet, petit-neveu de Bossuet, évêque de Meaux est curé de la paroisse de 1864 à 1888. Il dévoue une grande partie de sa fortune à la décoration de l'église et à l'achat de nombreuses œuvres d'art.
En 2005, la ville de Paris y fait installer un nouveau grand orgue de Bernard Aubertin, conçu sur le modèle des orgues d'Allemagne du Nord de l'époque baroque.
L'église, en plus de sa fonction religieuse, sert tout au long de l'année pour de nombreux concerts de musique religieuse classique.
L'église a été classée monument historique le 20 mai 1915.
Période révolutionnaire et napoléonienne
Durant la période révolutionnaire, le mobilier est pillé et les statues des Saints brisées. La statue de Sainte Geneviève et la statue de la Vierge Marie, toutes deux œuvres du sculpteur François Ladatte, situées dans les transepts, survécurent en étant transformées en statue de la liberté et en statue de l'égalité. Corentin Coroller, curé de la paroisse depuis 1785, prête le serment constitutionnel, ce qui n'empêche pas la fermeture de l'église en 1791.
L'église sert tout d'abord de dépôt littéraire, les métaux récupérables sont envoyés à l'Hôtel des Monnaies, et le 31 juillet 1798, l'église est vendue à un certain Fontaine pour la somme de 60.000 francs. Celui-ci décide de laisser l'église à la disposition du curé Coroller qui peut ainsi continuer à assurer le culte. S'étant rétracté de son serment constitutionnel en 1795, il devient curé concordataire en 1802 et lors de la venue du pape Pie VII à Paris pour le sacre de Napoléon, ce dernier célèbrera une messe le 10 mars 1805, dans une église dont les murs sont pour l'occasion, et afin de cacher les dégâts dus à la révolution, recouverts de tapisseries des Gobelins.
Le 15 décembre 1817, la ville de Paris, rachète l'église à Fontaine. Coroller reste curé de la paroisse jusqu'en mai 1821.
Peintures et œuvres d'art

Dans la chapelle des fonts baptismaux, se trouvent huit petits tableaux sur bois, représentant huit scènes de la vie du Christ. Initialement attribués à l'école flamande de la fin du XVIe siècle, ils ont été restaurés par les services de la ville de Paris en 200-2001, et réattribués à l'école rhénane du début du XVIe siècle.
L'icône de Notre-Dame du perpétuel Secours est une image "miraculeuse" du XVIe siècle, en provenance d'Orient, et amenée à Rome. Sa vénération à la fin du XIXe siècle a été propagée par les Rédemptoristes. L'icône montre le Christ dans les bras de sa mère, la Vierge Marie, et regardant les archanges Gabriel et Michel qui tiennent les instruments de la Passion.