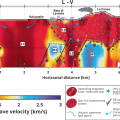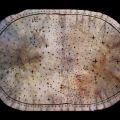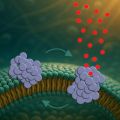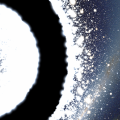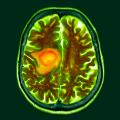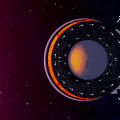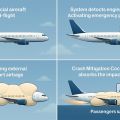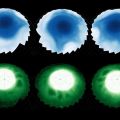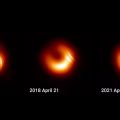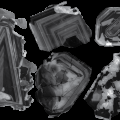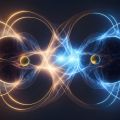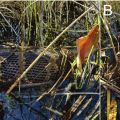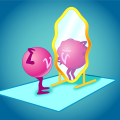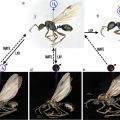Église Sainte-Aurélie de Strasbourg - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Histoire
Les découvertes et les interventions archéologiques menées dans le faubourg dès le XVIIe siècle concernent principalement des vestiges funéraires datant de l'Antiquité, ainsi que de la période mérovingienne.
La date de fondation de l'église reste incertaine. Selon le chroniqueur Koenigshoven cité par l'historien Jean-Daniel Schoepflin, sceptique, son origine remonterait à sainte Aurélie, l'une des onze mille vierges, morte à Strasbourg. D'autres sources suggèrent une fondation de l'église primitive au VIIIe siècle, sur une crypte qui aurait renfermé le tombeau de sainte Aurélie.
De fait elle est citée pour la première fois en 801, sous le vocable de Saint-Maurice, alors que celui de Sainte-Aurélie n'apparaît qu'en 1324.
D'après Schoepflin, l'église est concédée au chapitre de Saint-Thomas par l'évêque Henri II en 1219, une concession confirmée par une bulle du pape Honorius III.
En 1471 elle est incorporée au chapitre Saint-Thomas. Elle passe à la Réforme en 1523, en même temps que le chapitre. Après le Temple Neuf, Saint-Thomas et Saint-Nicolas, elle devient la quatrième paroisse de la confession d'Augsbourg à Strasbourg. Son premier pasteur est Symphorien Pollion, qui avait d'abord prêché le protestantisme à la cathédrale, mais il est déchu de ses fonctions, et c'est Martin Bucer qui est élu prédicateur de l'église en 1524.
La vie des paroisses protestantes strasbourgeoises commence à être mieux connue à partir du milieu du XVIe siècle lorsque les registres baptismaux y sont introduits. C'est ainsi que pour l'église Sainte-Aurélie ces registres sont conservés aux Archives municipales de Strasbourg depuis l'année 1550.
Au XVIIIe siècle la toiture menace de s'effondrer et la construction d'une nouvelle église s'avère nécessaire. Elle est confiée aux maîtres d'œuvre Michel Hatzung et Georges Frédéric Hüttner. La première pierre est posée le 18 juillet 1763, les travaux progressent assez rapidement et la nouvelle église est inaugurée le 28 mai 1765. À l'exception de la sacristie de la cathédrale, plus petite, en 1744, et l'église des Récollets, détruite depuis, c'est le seul édifice cultuel important construit à Strasbourg au cours du siècle.
En 1805, après Austerlitz, des prisonniers et des blessés russes et autrichiens sont hébergés dans l'église.
Le 5 mai 1988 l'église est classée par les Monuments historiques.
Ameublement intérieur
Autel et chaire à prêcher
L'autel à colonnettes tournées, peint en blanc et or, tient à la fois de la table à quatre pieds et de l'autel-armoire. Il date de 1669. Placé devant la chaire à prêcher, il occupe le côté sud de la nef.
Comme l'autel dont elle est contemporaine, également peinte en blanc et or, la chaire suspendue de 1670 provient de la nef précédente. De style cartilage, la cuve est entourée de niches abritant les quatre Évangélistes. Comme à l'église Saint-Guillaume de Strasbourg, elle est portée par un pélican nourrissant ses petits de son propre sang, conformément à l'iconographie chrétienne occidentale symbolisant le sacrifice du Christ.
L'autel et la chaire à prêcher ont été classés au titre d'objet par les Monuments historiques le 28 mars 1979.

La chaire à prêcher |
Orgues
L'orgue principal fut construit en 1718 par Andreas Silbermann. À l'origine il était doté de deux claviers et dix-sept jeux. Dans l'intervalle l'instrument a fait l'objet de nombreuses transformations. De la réalisation de Silbermann il ne subsiste que le buffet et sept de ses jeux. L'orgue actuel est d'Ernest Muhleisen (1952). La partie instrumentale a été classée Monument historique en 2000. Afin de l'harmoniser avec l'autel et la chaire, le buffet a été peint à son tour en blanc et or en 1790, tandis qu'un décor de feuillages rehaussé d'or souligne tous les éléments sculptés. Dans l'Alsace du XVIIIe siècle, un tel buffet peint reste exceptionnel.
C'est sur cet instrument qu'Albert Schweitzer a enregistré des œuvres de Jean-Sébastien Bach et César Franck pour Columbia Records en 1936.
Un petit orgue de chœur a été construit par le facteur Alfred Wild en 2001. Il est placé à la droite de l'autel.
Panneaux peints
Vingt-trois scènes bibliques exécutées en 1767 par le peintre et doreur strasbourgeois Pierre Joseph Noël ornent la tribune. Celles illustrant l'Ancien Testament se trouvent sous l'orgue, tandis que le Nouveau testament est évoqué sur le côté droit.
Plaques
L'ameublement intérieur comporte également quelques tableaux et plaques de bronze. Le réformateur Martin Bucer y est particulièrement à l'honneur, avec notamment un médaillon à son effigie apposé à droite de la chaire, identique à celui de l'église Saint-Thomas de Strasbourg, réalisé par Johannes Riegger à partir d'une médaille frappée par Frédéric Hagenauer en 1543. À gauche de la chaire, une plaque de bronze exécutée en 1929 par le sculpteur strasbourgeois Albert Schultz (1871-1953) montre Martin Bucer prêchant devant ses fidèles.