Yves Citton - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Portées de certaines de ses œuvres
Impuissances. Défaillances masculines et pouvoir politique de Montaigne à Stendhal
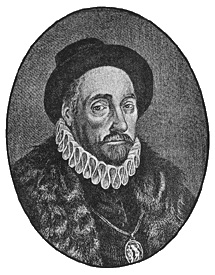
Le point du départ de ce livre est l’interrogation des discours (émis en France) sur l’impuissance sexuelle et cela dès le début de l’époque moderne jusqu’en 1830. À son point d’arrivée, Yves Citton présente une mise en perspective du sentiment d’impuissance politique qui obsède les sociétés occidentales en cette fin du XXe siècle. Des défaillances (individuelles) du passé à la paralysie du présent, le chemin proposé met en lumière le « complexe d’impuissance » qui concerne de multiples niveaux de l’existence de chacun.
Ainsi, après avoir analysé l’angoisse spécifiquement masculine qui impose la narration ainsi que l’explication des fiascos sexuels (comme un moyen de s’en défaire), Yves Citton se penche sur trois corpus littéraires ayant un trait commun qui n’est que le fait de faire entrer la défaillance virile en résonance intime avec un sentiment de dépossession affectant la noblesse de l’époque. On remarque que, de Montaigne à Crébillon fils et à Stendhal, l’impuissance réfléchit (tel un miroir), et fait apparaître trois portraits illustrant parfaitement le cheminement de la conscience de soi nobiliaire. Et bien au delà des archétypes historiques assidûment reconstitués, Yves Citton raconte une réflexion éthique directement liée aux « apories » de notre présent : pour l’homme d’aujourd’hui, comme pour les marquis d’hier, l’impossibilité d’agir à sa source dans une incapacité à gérer le privilège dont on est destiné à jouir. C’est ainsi que l’impuissance atteste à la fois et contredit le privilège.
« Derrière ce geste de libération qui n’ébauche que pour se figer aussitôt, derrière cette insuffisance qui se nourrit de sa déploration, on retrouve – au terme de notre parcours – cette parole qui se perpétue à répéter qu’au commencement était l’action. C’est en voulant sortir de soi que la littérature est au plus proche d’elle-même. »
— ()
Portrait de l’économiste en physiocrate. Critique littéraire de l’économie politique

C’est parce que l’économie a un rôle prépondérant dans l’imaginaire politique de notre siècle, qu'Yves Citton cherche dans ce livre à saisir son fonctionnement. Comprendre ce rôle exige qu’on le resitue dans le contexte historique de sa naissance. Les seize brefs chapitres, qui constituent cet ouvrage, présentent ainsi aux lecteurs les débats émanant de l’émergence du concept d'économie politique dans la France des années 1760-1780. Cette œuvre est traversée par deux dialogues : le premier confronte la construction théorique étayée par les physiocrates aux critiques suscitées dès l’époque par les tendances « despotiques » de leur méthode. Quant au deuxième, il fait ressortir les résonances des querelles du XVIIIe siècle à la lumière des rixes qui font actuellement rage autour du « tout marché », de la « pensée unique » et de la mondialisation. La singularité de l’approche choisie par l’auteur, consistant à esquisser une critique littéraire de l’économie politique, éclaire l’interprétation de la rhétorique du discours économique qui est aujourd’hui aussi importante que l’analyse de son contenu « scientifique ».
Ce livre est un ouvrage de vulgarisation qui, au-delà des historiens des Lumières et des spécialistes de la pensée économique, s’adresse à toute personne qui désire réfléchir sur le fonctionnement de nos sociétés (qui visent à la fois la compétitivité et la justesse).
« De Paris à Pittsburgh, en passant par Bornéo, la fable de l’économiste débouche-t-elle sur une morale autre que ce vide central autour duquel s’affairent de plus en plus frénétiquement nos sociétés de consommation ? Faut-il incriminer la mauvaise foi du marchand si les biens qu’il nous prodigue échouent à satisfaire notre soif de sens ? Faut-il voir en la logique économiste l’imposture centrale de la modernité, ou au contraire l’accomplissement de sa rationalité la plus avancée ? Les deux à la fois. »
— ()
L’Envers de la liberté. L’invention d’un imaginaire spinoziste dans la France des Lumières
Cet ouvrage (récompensé du Prix Rhône-Alpes du Livre dans la collection « essais » en 2007) pose la question de savoir ce qu’est cette liberté à laquelle nos sociétés modernes – « libérales » – font si souvent référence. Que penser des « préférences » des électeurs et des consommateurs, dans un monde baigné de conditionnements publicitaires et médiatiques ? Le livre invite à réévaluer de telles questions à partir d’un double décalage. Un décalage conceptuel, qui approche la liberté à partir de son envers : le déterminisme. Un décalage temporel, qui recadre les problématiques « libérales » dans le contexte de leur émergence historique à l’époque des Lumières. Pour définir les bases d’une liberté qui ne s’aveugle pas aux conditionnements naturels et sociaux, l’ouvrage se propose d’explorer la tradition de pensée qui a été tenue pour l’ennemi le plus radical du libre arbitre, le spinozisme, tel qu’il s’est développé en France entre 1670 et 1790.
D’où une seconde ligne de questionnement, parallèle à la première : qu’est-ce donc que ce spinozisme des Lumières qu’évoquent tant d’études dix-huitiémistes sans véritablement préciser à quelle réalité elles font référence ? Le livre pose le problème non en termes d’influence de Spinoza sur les philosophes, mais en termes de réinventions permanentes, que les découvertes scientifiques, les urgences politiques, le goût du scandale ou le génie singulier des écrivains font résonner avec le cadre général posé par l’Éthique.
Les quinze chapitres de l'ouvrage proposent une reconstruction méthodique de l’ensemble du système spinoziste, depuis ses fondements métaphysiques jusqu’à ses conséquences esthétiques, en passant par ses implications épistémologiques, psychologiques, éthiques et politiques — le livre constituant une introduction très accessible à la pensée de Spinoza, traduite de son latin géométrique dans le beau français des salons.
« La fin des sociétés politiques apparaît bien comme une libération non seulement de la crainte (d'être tué, d'avoir faim), mais aussi de la monotonie mécanique de la vie moutonnière (des bestia) ou de la prédictibilité mécanique (des automata). [...] Aux yeux des spinozistes modernes – contemporains de la socialité raffinée des salons, de l'engouement de plus en plus intense et de plus en plus répandu pour le roman, le théâtre ou la musique, contemporains aussi de Baumgarten – la finalité des sociétés politiques relève non seulement de la liberté qu'apporte la raison, mais aussi (voire surtout) de la production d'affects et de percepts dont participe l'expérience esthétique. »
— ()
« Professeur de littérature française du XVIIIe siècle à l’université Stendhal de Grenoble, Yves Citton vient de signer sur Spinoza une étude d’une ampleur qui étonnera bien des philosophes chevronnés. »
— ()
Lire, interpréter, actualiser. Pourquoi les études littéraires ?
Cette réflexion part de la réfutation d’une déclaration du candidat-président français Nicolas Sarkozy et se confronte à cette interrogation de savoir « Pourquoi étudier aujourd’hui des textes littéraires rédigés il y a plusieurs siècles ? Pour quoi faire ? »
Le livre répond à cette question en proposant un plaidoyer pour les lectures actualisantes, qui cherchent dans les textes d’hier de quoi faire réfléchir sur les problèmes d’aujourd’hui et de demain. Ce plaidoyer se compose en réalité de cinq livres tissés en un seul : une théorisation des méthodes, des enjeux et des limites du geste actualisateur ; un essai d’ontologie herméneutique, qui fait de l’activité de lecture le modèle de constitution de notre réalité humaine et sociale ; une cartographie de quelques changements sociétaux en cours, destinée à situer le rôle nouveau que sont appelées à jouer les activités d’interprétation ; une prise de position politique dénonçant les angles morts et les perspectives étriquées du néo-travaillisme dominant ; un ouvrage de vulgarisation, visant à faciliter l’accès aux problématiques actuelles de la théorie littéraire, de la réflexion herméneutique et des multiples nœuds qui unissent biopolitique, capitalisme cognitif et économie des affects.
Cette démonstration, articulée en 14 chapitres et scandée par 58 thèses succinctes, invite son lecteur à considérer que, loin d’être condamnées à rester une discipline poussiéreuse, les études littéraires peuvent devenir le lieu d’une indiscipline exaltante, en plein centre des débats les plus brûlants de notre actualité : tout au contraire d’un exutoire parasitaire, le jeu de la lettre relève d’un travail, qui se trouve être à la fois plaisamment ludique, toujours quelque peu hypocrite, mais néanmoins essentiellement productif. L’expérience littéraire, telle que l’envisagent les lectures actualisantes, apparaît comme la mieux à même de nous apprendre à vivre-ensemble au sein d’une société multiculturelle nourrie de ses diversités, en même temps qu’elle nous sensibilise à ce que l’auteur présente comme l’impératif catégorique de notre époque : « agis en toutes circonstances de façon à ne pas devenir ton propre exploiteur ni ton propre oppresseur ! »
« En nous frottant à des maîtres-artificiers de l'expression langagière, la pratique de l'interprétation textuelle produit en nous des étincelles créatives qui nous mettent non seulement en position de revendiquer une partie prise de l'éclat de ce qui brille dans le texte, mais qui nous donnent surtout l'expérience la plus authentique de la vie humaine, en tant que celle-ci n'est qu'un fragile (et finalement vain) feu d'artifice des plus éphémères. S'enfermer avec un texte, pour apprendre à vivre enfermé avec autrui dont on doit apprendre à négocier la différence au sein d'un espace clos, n'a pas donc seulement une vertu socialisante, nécessaire à la poursuite de la collaboration entre les individus et des cultures dont on veut cultiver la diversité. S'enfermer avec un texte, pour apprendre à devenir soi par l'imitation critique d'autrui, c'est d'abord « collecter une moisson cognitive et tactile » qui nous fait gagner plus, par sa vertu propre, qu'aucun travail salarié. Telle est du moins la conviction que ce livre, à travers ses con-dictions éclectiques, a essayé de faire partager à propos de la condition littéraire contemporaine. Sans espoir vraiment ferme, mais sans pessimisme non plus. »
— ()
« Enfin, à chaque page, on entend un amour de la littérature, prise dans sa version vivante et dynamique, et un bonheur à partager. L’auteur reprend dans sa conclusion la belle phrase de Stanley Fish : « l’interprétation littéraire, comme la vertu, est sa propre récompense ». A lire donc, absolument, pour le bonheur, pour la connaissance (tous les étudiants des études littéraires devraient l’avoir comme livre de chevet), pour la pensée, pour la vie.. »
— ()
Spinoza et les sciences sociales : de la puissance de la multitude à l’économie politique des affects
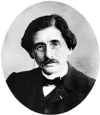
Dans sa contribution à Spinoza et les sciences sociales : de la puissance de la multitude à l’économie politique des affects, qu’il a co-édité avec Frédéric Lordon, Yves Citton tente de poser les bases d’une économie politique des affects. Comment repenser les phénomènes sociologiques et politiques contemporains en y reconnaissant le rôle central que jouent les « affects ». À partir d’une lecture croisée de Spinoza et du sociologue Gabriel Tarde, cette longue contribution essaie tout à la fois de proposer des outils d’analyse dont pourraient se servir des chercheurs en sciences sociales, et de proposer un cadre de réflexion générale pour penser la politique comme relevant de flux d’affects, de circulations de croyance et de phénomènes de « modes » plutôt que de rationalité communicative ou d’idéologies substantielles.
« En luttant activement contre l'invasion d'images et d'affects anti-rationnels occupant actuellement la médiasphère, il s'agirait donc d'ouvrir un espace capable d'accueillir les images et les affects pré-rationnels qui émanent constamment de la rationalité pratique des multitudes que nous formons, dès lors que nos automatismes mentaux ne sont pas empêchés de suivre leurs cours par diverses armes de distraction massive. Autant dire que concevoir une telle logique relevant de phénomènes de modes impliquerait à la fois une meilleure compréhension et une acceptation de l'importance centrale qu'est appelée à jouer l'économie des affects dans le développement de nos formes sociales. »
— ()
Éclairage sur ses idées remarquables
« Idiolecte » utile à la compréhension de l'idée de « Lectures actualisantes » :
La lecture actualisante est « une lecture d'un texte passé peut être dite ACTUALISANTE dès lors que (a) elle s'attache à exploiter les *virtualités *connotatives des signes de ce texte, (b) afin d'en tirer une *modélisation capable de *reconfigurer un problème propre à la situation historique de l'interprète, (c) sans viser à correspondre à la réalité historique de l'auteur, mais (d) en exploitant, lorsque cela est possible, la différence entre les deux époques pour apporter un éclairage dépaysant sur le présent. »
Bref arrêt sur son style
Dans sa critique et sa présentation du livre L’Envers de la liberté. L’invention d’un imaginaire spinoziste dans la France des Lumières, Daniel Bougnoux décrypte ainsi le style de l'essayiste et philosophe Yves Citton :
« Cette liberté est rendue palpable, et contagieuse, dans la passion d’écrire d’Yves Citton, docteur en oxymores, en passages secrets, en étymologies baroques et en objets biscornus, statues élastiques, harpes éoliennes… Ainsi déployé, le scandaleux spinozisme, ce corps de doctrine dont son auteur lui-même mesura mal toute la portée (car nous ne savons pas a priori “ce que peut un corps”), cascade, rebondit, infiltre notre modernité ; il est désormais partout. »
— ()



















































