Bartonella - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Introduction
| Bartonella | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
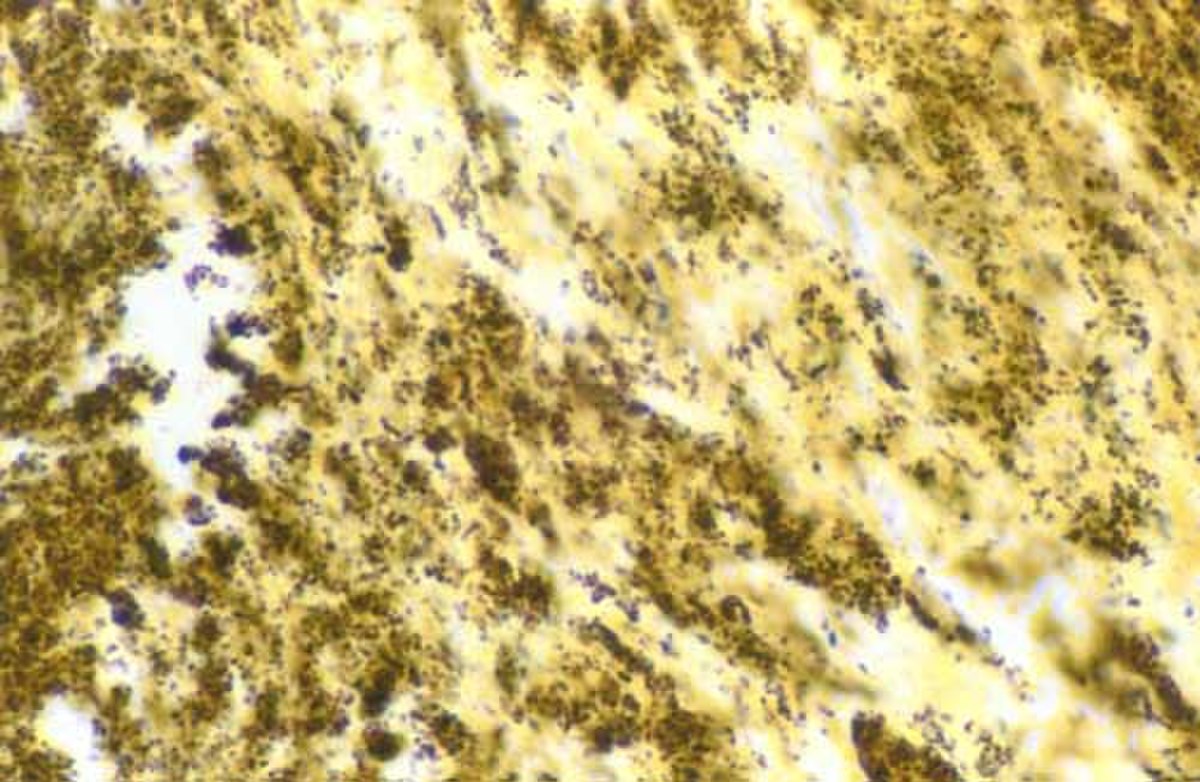
| |||||||||
| Classification | |||||||||
| Règne | Bacteria | ||||||||
| Embranchement | Proteobacteria | ||||||||
| Classe | Alpha Proteobacteria | ||||||||
| Ordre | Rhizobiales | ||||||||
| Famille | Bartonellaceae | ||||||||
| Genre | |||||||||
| Bartonella R.P.Strong, E.E.Tyzzer & A.W.Sellards , 1915 | |||||||||

| |||||||||
| Espèces de rang inférieur | |||||||||
| B. alsatica B. bacilliformis | |||||||||
| | |||||||||
Les espèces du genre Bartonella sont des bactéries Gram négatif. Les différentes maladies causées par des Bartonella sont dites bartonelloses. Elles sont parfois difficiles à diagnostiquer et ont même parfois semblé ne pas répondre aux postulats de Koch, notamment en cas de co-infections.
La Bartonella a été nommé en référence au docteur Alberto Leopoldo Barton Thompson, un microbiologiste argentin qui travaillait au Pérou.
Cycle d'infection
Le modèle couramment accepté est que généralement les vecteurs de transmission des bartonelles sont les arthropodes suceurs de sang et que les hôtes réservoirs de la bactérie sont des animaux (mammifères, dont chiens et surtout chats).
Immédiatement après l'infection, la bactérie colonise une première niche, l'endothélium.
Tous les 5 jours, une partie des bactéries est libérée dans le sang où elles infectent les érythrocytes.
Co-infections possibles
Diverses études ont montré de fréquentes coinfections des tiques par Bartonella henselae et d'autres « maladies à tiques » parfois susceptibles de doublement toucher le système nerveux. Les coinfections perturbent souvent le diagnostic des deux maladies en en modifiant les symptômes respectifs.
Des synergies infectieuses, au moins avec deux autres bactéries ; Babesia et Borrélia, pourraient contribuer à l'aggravation et à la chronicité de la maladie.
Chez l'Homme
Le risque de bartonellose semble avoir été sous-estimé.
Chiens et chats en sont souvent porteurs. Le chien semble rarement porteur sain mais le chat est souvent malade et présente alors en début d'infection par B. henselae ou de B. clarridgeiae des taux sanguins de bactéries très élevés (jusqu'à plus de 106 bactéries par millilitre de sang).
Bien que cette possibilité ait été initialement contestée, certaines tiques semblent pouvoir véhiculer la maladie d'animal à animal, ou de l'animal à l'Homme. C'est le cas d'Ixodes ricinus qui a par exemple été trouvée porteuse en Allemagne d' Ehrlichia, de Borrelia burgdorferi (sensu lato) et de Bartonella, avec donc de possibles coinfections)
On connaît 19 espèces de Bartonella, une dizaine étant pathogène pour l'homme, parfois de manière persistante, chez des immunodéprimés, mais aussi chez des patients en bonne santé (immunocompétents), les trois plus fréquentes étant
- Bartonella henselae,
- Bartonella quintana et
- Bartonella bacilliformis.
- On a plusieurs fois récemment montré que des bartonella antérieurement réputées ne pas infecter l'homme, étaient finalement aussi des pathogènes pour l'Homme ; c'est le cas par exemple d' Ehrlichia ewingii et de Bartonella clarridgeiae
- Saisonnalité : 60 % des cas de « maladie des griffes du chat » sont diagnostiquées de
septembre à janvier, quand les chats domestiques sont les plus proches de leurs maîtres.
- La maladie peut être associée à un purpura de Henoch-Schönlein.
- La maladie est parfois confondue avec une mononucléose infectieuse.
- Des co-infections sont possibles, notamment avec la maladie de Lyme
- L'œil peut être atteint, avec, éventuellement, une neurorétinite pouvant être causée par plusieurs bartonella dont Bartonella grahamii. Remarque : certaines borrélies susceptibles de co-infecter l'organisme avec des bartonella peuvent aussi infecter l'œil.
Bartonella bacilliformis
Ce germe est le premier du genre à avoir été reconnu. Il serait le plus souvent (ou toujours ?) transmis par une mouche spécifique, Lutzomyia verrucarum, présente uniquement au niveau de la cordillère des Andes.
- Il provoque la maladie de Carrión, la fièvre d'Oroya, la verruga du Pérou.
Bartonella quintana
Cette bartonelle provoque essentiellement la fièvre des tranchées, décrite durant la Première Guerre mondiale. La maladie ne sévit actuellement qu'en conditions de déficit en hygiène.
Rarement, elle peut provoquer une endocardite. Elle cause l' angiomatose bacillaire qui peut aussi être induite par Bartonella henselae, caractérisée par une prolifération de petits vaisseaux sous la peau, mais également dans d'autres organes.
- Zone d'endémie : monde entier
Bartonella henselae
L'hôte servant de réservoir principal du bacille est réputé être le chat (domestique ou errant). Cette bactérie provoque :
-
- la Maladie des griffes du chat (voir aussi paragraphe suivant) : cette maladie au nom facile à retenir est aussi appelée lymphoréticulose bénigne d’inoculation ou lymphogranulome bénin. Il s'agit du principal responsable de cette maladie.
- Bacille angiomatosis, Bacille peliosis
- des Endocardites
- une Bacteremia avec fièvre
- une neurorétinite
- Zone d'endémie : monde entier
Bartonella clarridgeiae
- Hôte servant de réservoir pour le bacille : Le chat a d'abord été considéré comme vecteur principal, mais des piqures d'Arthropode ont été soupçonnées car 72 % des cas apparaissent de juin à décembre, et de fréquentes co-infection Borrélia-Bartonella font penser que les tiques puissent être un vecteur vers l'homme plus fréquent que les griffures de chat.
- Cette bactérie provoque la maladie dite « maladie des griffes du chat »
Bartonella koehlerae
- Hôte servant de réservoir pour le bacille : chat
Bartonella elizabethae
- Hôte servant de réservoir pour le bacille : rat
Bartonella vinsonii
- Hôte servant de réservoir pour le bacille : souris et chien (avec co-infections possibles, avec Ehrlichiose notamment). Elle peut causer une endocardite chez l'homme
Bartonella grahamii
- Hôte servant de réservoir pour le bacille : souris
- Cette bactérie provoque : endocardite
Bartonella washoensis
- Hôte servant de réservoir pour le bacille : écureuil
- Cette bactérie provoque : myocardite
Bartonella rochalimae
Il a été décrit pour la première fois en 2007 chez un patient fébrile de retour du Pérou.

















































