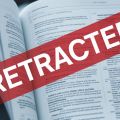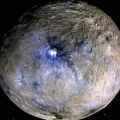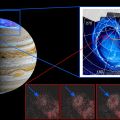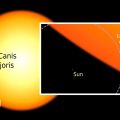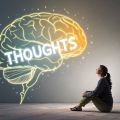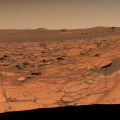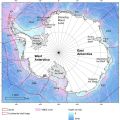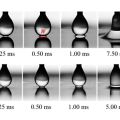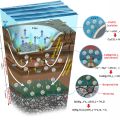Élixir d'or - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
La formule modifiée de Bestoujev et son rachat par Catherine II
Lorsque le comte Bestoujev compare la teinture de La Motte avec la sienne, il constate que l'élixir du général contient du fer : « II la trouva, quant à l'essentiel, de la même nature, mais la saveur plus âpre. Il vit aussi qu'elle déposait un peu d'oxyde de fer, parce que Lembke n'avait pu probablement donner toutes les manipulations à observer, ou parce que le général Lamotte avait voulu abréger le procédé ». Tombé en disgrâce, il décide, à partir de 1748, de confier la préparation et la distribution d'une teinture ressemblant à celle de La Motte, sous le nom de « gouttes jaunes et blanches de Bestuchef », à un pharmacien nommé Model. Après la mort de Bestoujev en 1768 et celle de Model en 1775, la formule de la teinture est rachetée, en 1779 aux ayant-droits par l'impératrice Catherine II qui la remet au Collège de Médecine en ordonnant sa publication.
La teinture d'or du général La Motte

Un commerce fructueux
Antoine Duru de La Motte , que certains qualifient d'aventurier[réf. souhaitée], a été général d'artillerie au service de Léopold Ragotzky, prince de Transylvanie. De retour à Paris, il s'installe à l'Hôtel des Invalides pour y produire sa teinture, qu'il prétend être de son invention et qu'il vend sous le nom de « gouttes d'or du général Lamotte » ou « élixir d'or et blanc » au prix d'un louis le flacon d'une demi-once.
Le couteux remède de La Motte connait bientôt un succès considérable auprès des patients fortunés, notamment à la cour de Versailles, tout comme l'élixir de Garus ou l'eau de mélisse. Comme marque de considération, Louis XV en offre deux cents flacons au pape souffrant de la goutte. Ayant vendu son secret au roi contre une rente annuelle de 4 000 livres et obtenu l'exclusivité de la vente de son remède, le général La Motte fait rapidement fortune et se voit élever au grade de major-général. À sa mort, sa veuve, née Marie-Simone Dorcet[réf. souhaitée] et mieux connue sous le nom de « Madame la Générale de La Motte » se remarie avec Jean-Antoine de' Calzabigi, le frère cadet de l'homme de lettres et librettiste Ranieri de' Calzabigi, devenant ainsi « Mme Calsabigi ». Ayant récupéré, par une lettre patente du 3 mai 1742, le privilège d'exclusivité de son défunt mari, elle reprend la commercialisation des gouttes d'or à l'Hôtel de Longueville et continue à faire fructifier l'affaire en exportant l'élixir en province et à l'étranger, notamment en Russie et en Allemagne. Lorsque l'ex-générale la Motte, Mme Calsabigi, meurt à son tour, le procédé de fabrication de l'élixir et son privilège de vente sont transmis à un certain Hiesme Paulian, après quoi le remède ne tarde pas à tomber dans l'oubli.
Indications et mode d'emploi des « gouttes d'or »
Les gouttes d'or du général Lamotte se présentaient sous deux formes de couleurs différentes, les gouttes jaunes (ou élixir d'or ) et les gouttes blanches (ou élixir blanc). Leurs indications thérapeutiques extrêmement larges comprenaient notamment diverses affections appartenant aux domaines de la neurologie et de la rhumatologie, selon la terminologie moderne.
- Les gouttes jaunes étaient administrées en cas de paralysie, de « vapeurs » », d'épilepsie, On les utilisait aussi dans les troubles provoqués par « l'épaississement du sang ou l'obstruction des vaisseaux ou l'âcreté des humeurs ». Elles étaient aussi censées agir comme fortifiant général : « L'élixir d'or ranime les forces perdues par la maladie ou par l'âge ».
- Les gouttes blanches étaient recommandées dans les rhumatismes, la goutte, les « humeurs », le « sang scorbutique », mais aussi dans les maladies vénériennes, et des troubles neuro-psychiatriques tels que paralysies, crampes, épilepsie, hypocondrie etc.. .
« L'Elixir de M. le Général de la Motte continue d'opérer les effets les plus heureux , principalement dans l'apoplexie, la paralysie, la goutte, les pleurésies, la petite vérole, la rougeole, les fièvres malignes & les fluxions de poitrine. L'expérience autorisée par nombre de certificats prouve qu'il est très souverain dans les maladies de lait répandu, les indigestions, les obstructions, la dysenterie et rétention d'urine & les mois, les pertes de sang, lajaunisse & les vapeurs de toutes sortes... Plusieurs personnes incommodées d'asthme sont parfaitement bien trouvés de l'usage qu'elles en ont fait. »
— Mercure de France , 1750
On les prenait mélangées à du vin, de l' Eau de fleur d'oranger, du bouillon, de six à trente gouttes par jour etc...