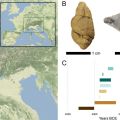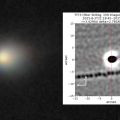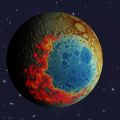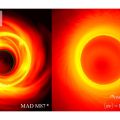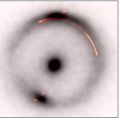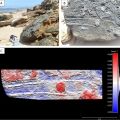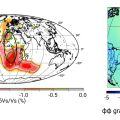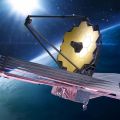Établissement public de santé - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Missions
Un établissement public de santé a vocation à assurer des missions connues traditionnellement sous l'expression de service public hospitalier (SPH), même si cette dernière n'apparaît plus dans le code de la santé publique tel que modifié par la loi de 2009. Ces missions de service public peuvent être regroupées en quatre domaines :
Soin
La mission première s'ordonne autour des soins (curatifs et palliatifs). Le soin peut s'accompagner d'un hébergement (hospitalisation) mais ce n'est pas systématiquement le cas.
Contrairement aux établissements privés, le patient est un « usager » de l'établissement public qui demeure responsable des actes médicaux pratiqués par les médecins hospitaliers qui sont salariés par l'établissement.
Le patient n'est pas « usager » d'un établissement privé. Le rapport est contractuel entre le patient et le médecin libéral qui a pris en charge le patient. Celui-ci demeure responsable médicalement du patient tout au long de son hospitalisation.
Prévention
Au-delà de sa fonction réparatrice, l'établissement joue un rôle important dans la prévention sanitaire, seul ou en collaboration avec certains partenaires de santé publics ou privés, notamment en matière de lutte contre le tabagisme, contre l'alcoolisme ou contre la tuberculose. Il occupe une place privilégiée dans le domaine du dépistage de certaines maladies, en particulier le cancer et le sida.
Enseignement et formation professionnelle
Un EPS est un centre de formation important au bénéfice des étudiants en médecine comme des étudiants inscrits à l'Institut de formation en soins infirmiers qui prépare aux métiers d'infirmier et d'aide-soignant. Les différents services reçoivent également très régulièrement des étudiants et des stagiaires dans divers domaines d'activité sanitaire et sociale. Les centres hospitaliers universitaires (CHU) sont plus particulièrement impliqués dans ces activités.
Recherche scientifique et médicale
Les EPS participent à la recherche clinique dans un certain nombre de ses services médicaux.
Activité
En 2006, près de 8,4 millions de personnes ont été hospitalisées dans les établissements publics de santé, soit 260 000 hospitalisations de plus qu'en 2004.
Parallèlement, 3,5 millions de personnes ont été hospitalisées en secteur privé à but lucratif et 1,2 million dans le secteur privé à but non lucratif.
Financement
Le financement des établissements publics de santé et des établissements privés exerçant des missions de service public est essentiellement assuré par la tarification à l'activité (T2A), à hauteur de 50% en 2007 et de 100% à partir de 2008, ainsi que par la dotation annuelle complémentaire (DAC). Ces crédits sont essentiellement versés par l'assurance maladie (ce qui représente 90% de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses), le solde correspondant à ce qui est versé par les malades et leurs mutuelles.
Organisation administrative
Organes de l'établissement
Le directeur est le représentant légal de l'établissement public de santé, il dispose de prérogatives importantes et est chargé de sa gestion courante sous le contrôle du conseil de surveillance. Il est nommé :
- par décret en France pris sur le rapport du ministre de la Santé pour les établissements à ressort régional, interrégional ou national ; pour les centres hospitaliers universitaires, le décret est pris également sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur) ;
- par arrêté du président du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière dans les autres cas.
Présidé par le directeur, le directoire comprend sept membres, neuf dans le cas des CHU. Le président de la commission médicale d'établissement est vice-président du directoire. Dans les CHU, il existe deux autres vice-présidents, un vice-président doyen, directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, et un vice-président chargé de la recherche. Le directoire comprend en outre le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique. Le directeur complète le directoire de membres qu'il choisit parmi le personnel d'encadrement de l'établissement, de sorte que les membres des professions médicales soient majoritaires. Le directoire conseille le directeur et doit être consulté sur certaines décisions.
Le conseil de surveillance contrôle l'activité de l'établissement et adopte certaines décisions. Le conseil de surveillance comprend neuf membres dans la plupart des hôpitaux à ressort communal, quinze dans les hôpitaux à ressort communal les plus importants et dans tous les autres. Il se compose à parité de représentants des collectivités territoriales, de représentants du personnel, et de personnalités qualifiées dont des représentants des usagers. La présidence du conseil de surveillance est attribuée à une personne élue par lui choisie parmi les élus locaux ou parmi les personnalités qualifiées.
La commission médicale d'établissement est l'organe de représentation du personnel médical et pharmaceutique de l'établissement. Elle est consultée sur les principaux projets de l'établissement et joue un rôle d'évaluation. Membre du directoire, le président élu de la commission médicale d'établissement dispose de compétences propres.
La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, qui a remplacé en 2005 la commission du service des soins infirmiers est un organe consultatif chargé de donner son avis sur l'organisation des soins infirmiers et l'accompagnement des patients, ainsi que sur la formation du personnel infirmier et de rééducation. Elle est aussi consultée sur le projet d'établissement.
Le comité technique d'établissement est l'organe de représentation du personnel non médical. Il est consulté sur les questions stratégiques et sur ce qui concerne le personnel (conditions de travail, politique sociale...). Il peut émettre des vœux.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail joue le même rôle que dans les entreprises privées.
Organisation interne
Les établissements publics de santé, sauf les hôpitaux locaux, sont divisés, depuis 2005, en pôles d'activité. Ces pôles ont soit une activité clinique, soit une activité médico-technique. Chaque pôle est placé sous l'autorité d'un chef de pôle (responsable de pôle avant 2010) choisi si possible parmi les praticiens titulaires, qui est assisté, pour les pôles d'activité clinique, d'une part d'un cadre de santé ou d'une sage-femme, d'autre part d'un cadre administratif.
Un pôle peut être divisé en structures internes. Un conseil de pôle était consulté sur toutes les questions intéressant le pôle, mais la loi Hôpital, patients, santé et territoire a supprimé ces conseils de pôles.