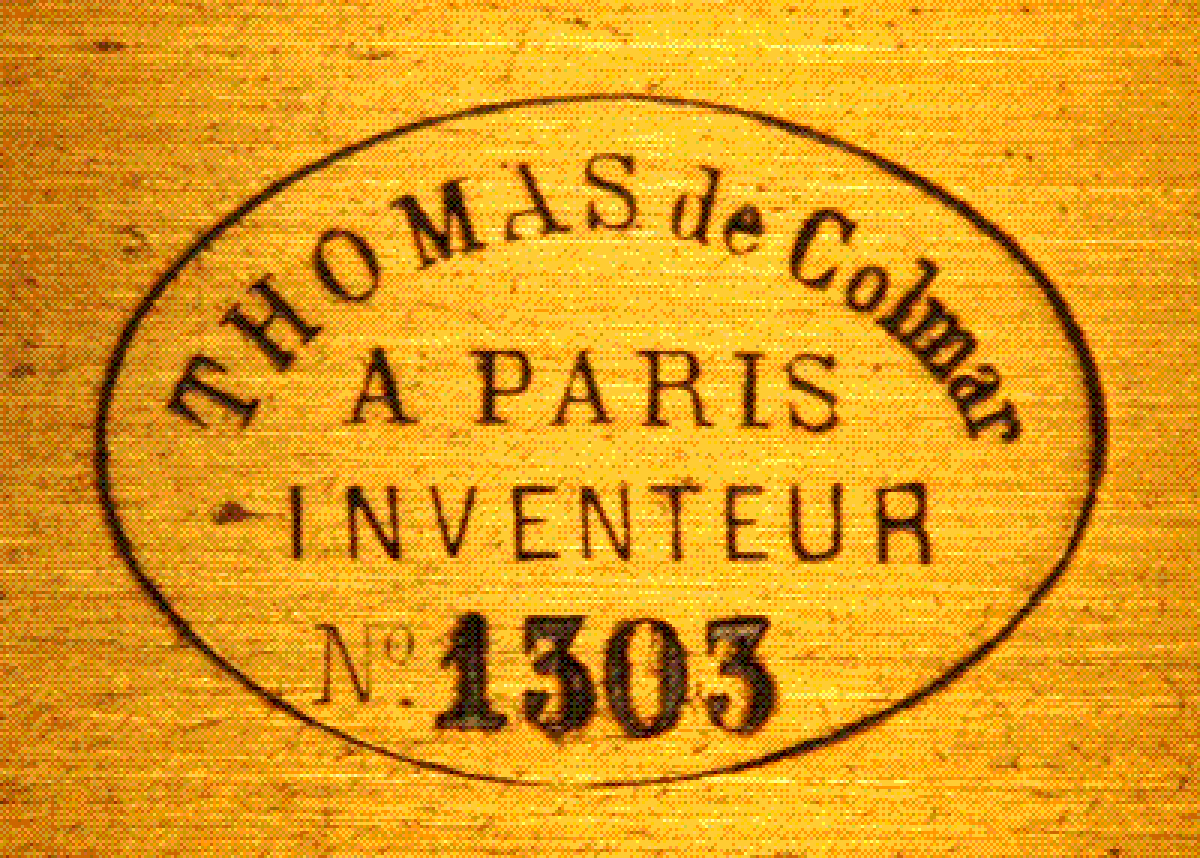Arithmomètre - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Historique
Origines
Thomas eu l'idée de sa machine durant son service dans l'armée française, car il était responsable de l'approvisionnement et donc avait beaucoup de calculs à faire. Il s'inspira principalement des machines de Leibniz et de Blaise Pascal. Il déposa son premier brevet le 18 novembre 1820.
Avec ce premier arithmomètre il suffit de tirer sur un ruban pour multiplier un nombre inscrit sur les curseurs par un chiffre multiplicateur et, comme sur la Pascaline, un changement de lucarnes faisant apparaitre le complément à neuf du résultat est utilisé pour les opérations de soustractions. Ces deux caractéristiques ne seront plus présentes dans les machines commercialisées en 1851.
Première machine
La fabrication du premier modèle, commencée en 1820, pris à peu près un an car il n'existait pas d'artisans spécialisés dans la confection de telles pièces. C'est Devrine, un horloger parisien, qui construisit ce premier prototype et le délivra à la Société d’encouragement pour l’industrie nationale qui en fit les éloges dans un rapport du 26 décembre 1821. Connu sous le nom de machine de 1822, ce premier modèle n'était qu'un prototype mais il fonctionnait parfaitement et comportait déjà les parties essentielles des Arithmomètres qui allaient être produits en série. La seule machine connue de cette époque est aux USA, dans la ville de Washington, au musée du Smithsonian.
Production
La production de série commença en 1851 et se termina vers 1915. A peu près 5 500 machines furent fabriqués pendant cette période; 40% de la production était vendue en France et le reste était destiné à l'exportation.
La production des Arithmomètres fut sous la responsabilité de:
- Thomas de Colmar jusqu'à son décès en 1870, puis de son fils, Thomas de Bojano jusqu'en 1881, et le fils de celui-ci, Mr. de Rancy jusqu'en 1887. Messieurs Devrine (1820), Piolaine (1848), Hoart (1850) et Payen (vers 1875) en furent les principaux constructeurs. Toutes ces machines ont le logo Thomas de Colmar.
- Louis Payen, leurs dernier ingénieur constructeur, qui acheta l'affaire en 1887 et continua la fabrication jusqu'en 1902, Toutes ces machines ont le logo L. Payen.
- Veuve Louis Payen qui reprit l'affaire à la mort de son mari et continua jusqu'au début de la première guerre mondiale avec les logo L. Payen, Veuve L. Payen et V.L.P.. Alphonse Darras en fut le principal constructeur.
- Alphonse Darras qui acheta l'entreprise en 1915 et construisit les dernières machines (il ajouta un logo avec les lettres A et D entrelacées).
Au début de la production, Thomas différencie les machines par leurs capacités et c'est ainsi que l'ont trouve le même numéro de série pour des machines de capacités différentes. Il corrige ceci en 1865 et commence une nouvelle numérotation unique, indépendante de la capacité de la machine, avec 500 comme premier numéro. C'est ainsi qu'il n'y a pas de machine avec un numéro de série entre 200 et 500.
De 1865 à 1907 les numéros de série furent consécutifs (de 500 à 4 000) puis Veuve L. Payen, après avoir déposé un nouveau brevet en 1907, commença une nouvelle numérotation en ajoutant son nom au logo des machines et en utilisant 500 comme numéro de série de départ (le nombre de machines qu'elle avait construit sous le nom L. Payen) et elle continuera jusqu'au numéro 1 700 en 1914. Alphonse Darras repris l'ancienne numérotation en 1915, en tenant compte approximativement des machines construites par Veuve L. Payen, avec un numéro de série de 5 500.
Modéles
Les modèles avaient une capacité de 10, 12, 16 et 20 chiffres au totalisateur ce qui permettait de travailler sur des nombres allant de dix milliards (moins un) à cent milliards de milliards (moins un). Seulement deux machines furent construites avec des capacités différentes:
La machine de 1822 qui avait 6 chiffres au totalisateur (bien que le brevet de 1820 décrive une machine de 8 chiffres).
Une machine de 30 chiffres, ressemblant à un piano, construite exclusivement pour l'exposition universelle de 1855 et qui fait maintenant partie de la collection IBM. Ce piano a dû impressionné Jules Verne car dans Paris au xxe siècle, quand il parle de machines à calculer, après avoir cité Pascal et Thomas de Colmar, il décrit des instruments ressemblants à de vastes pianos avec des claviers à touches et qui délivraient les réponses instantanément à toute personne qui savait en jouer!
Les différents modèles ne variaient qu'en longueur avec une largeur de 18 cm et une hauteur de 10 à 15 cm. La longueur d'une machine de 20 chiffres était de 70 cm et celle d'une machine de 10 chiffres était aux alentours de 45 cm.
Prix
Le prix d'un arithmomètre en 1853 était de 300 francs, trente fois le prix d'une table de logarithmes de l'époque. Mais, à l'encontre des tables de logarithmes, un arithmomètre était assez simple pour être utilisé des heures durant par une personne sans qualifications spéciales.