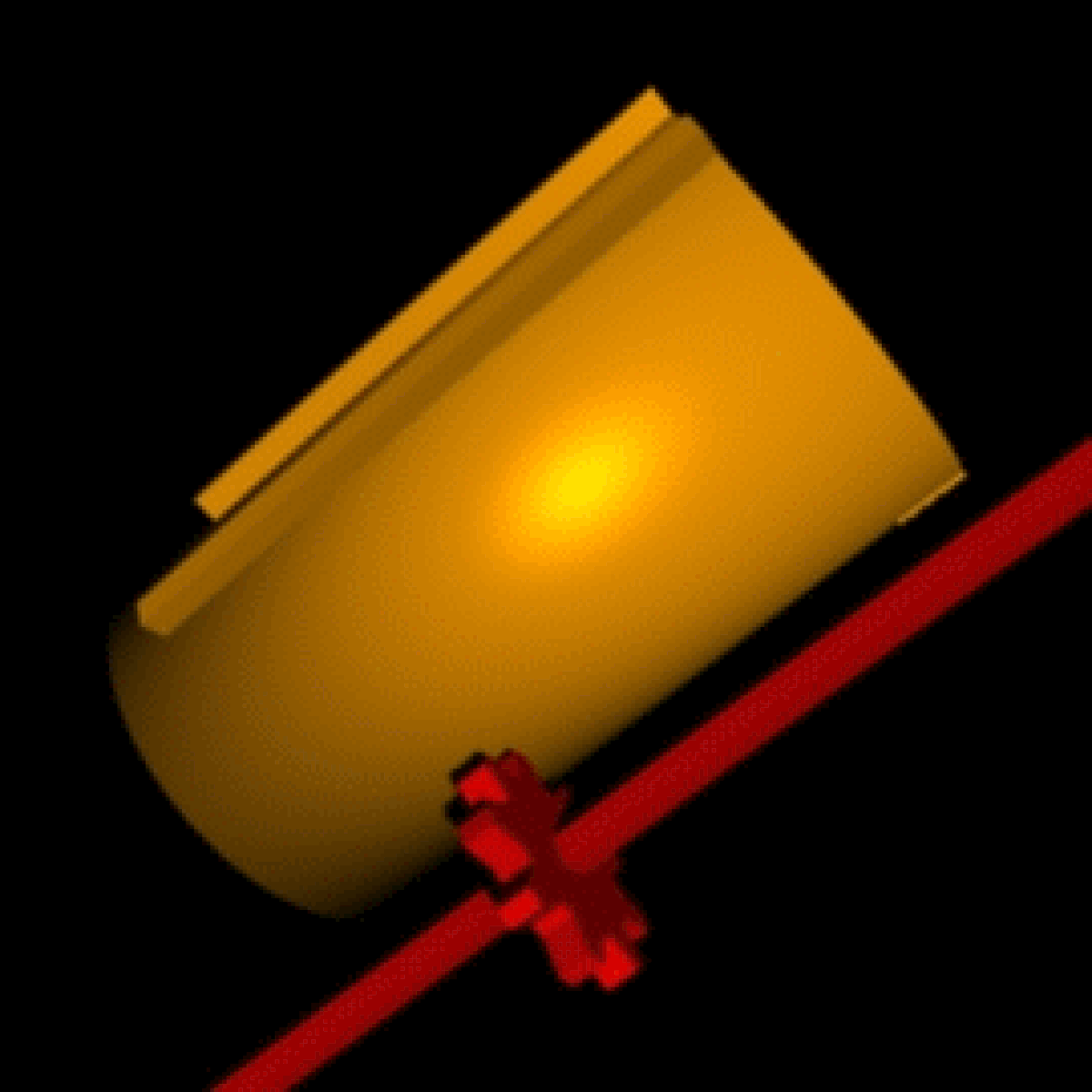Arithmomètre - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Composants
L'Arithmomètre est un instrument en bronze contenu dans une boite en bois souvent de chêne ou d'acajou mais aussi, pour les plus anciennes, d'ébène ou plaquée ébène. La partie mécanique est composée de deux organes en bronze:

Partie fixe: entrées - contrôle - exécution
La partie inférieure, fixe, est composée d'une unité de contrôle, en général un levier, qui permet de choisir entre addition/multiplication et soustraction/division, d'un organe d'entrée des données qui se fait grâce à des curseurs que l'ont peux déplacer devant des échelles numérotées de 0 à 9 et d'un organe d'exécution qui, à chaque tour de manivelle, exécute l'opération désignée par le levier de contrôle. Il est à noter que la manivelle ne se tourne que dans le sens des aiguilles d'une montre.
Platine mobile: affichage - accumulateur
La partie supérieure, mobile, sert à l'affichage des résultats mais c'est aussi un accumulateur pour les opérations en cours. Cette accumulateur est indexé grâce au mouvement latéral de ce chariot. Chaque commande ajoute ou soustrait le nombre inscrit sur les organes d'entrée à la partie de l'accumulateur qui se trouve immédiatement au-dessus. Les machines d'après 1858 ont aussi un compteur d'opérations qui se trouve en dessous de l'affichage principal. Ce compteur affiche le multiplicateur à la fin d'une multiplication et le quotient à la fin d'une division.
Les deux organes d'affichage ont chacun un bouton de remise à zéro; ils sont situés aux extrémités de la platine mobile et ils servent aussi à lever la platine mobile. Chaque lucarne possède une mollette qui permet de la modifier individuellement (celles-ci sont optionnelles pour le compteur d'opérations). Un bouton portatif en ivoire, ou en métal, sert à indiquer le nombre des chiffres décimaux; il se met dans le petit trou de la platine qui existe entre chaque lucarne, et remplace ainsi la virgule qu'on emploie dans les opérations écrites.
Cylindre de Leibniz
Un cylindre de Leibniz est un cylindre dont les dents sont de longueurs inégales. Il fut inventé par l'allemand Gottfried Wilhelm Leibniz vers 1673. Leibniz construisit deux prototypes de machines à calculer qui utilisaient ces cylindres, mais c'est Thomas de Colmar qui fut le premier à l'incorporer à une machine de production un siècle et demi plus tard.
En accouplant un cylindre de Leibniz à une roue dentée, montée sur un axe parallèle au sien, de manière à ce qu'elle puisse coulisser d'une extrémité à l'autre de celui-ci, on peut changer le nombre de dents qui affectent cette roue durant la rotation du cylindre. Si on lie cette roue à un compteur, chaque rotation complète du cylindre ajoute ou soustrait un nombre allant de zéro au maximum de dents présentes à ce compteur.
L'organe de calcul de l'arithmomètre est composé d'un ensemble de cylindres de Leibniz accouplés à une manivelle. Chaque tour complet de la manivelle donne un tour complet aux cylindres. Chaque cylindre possède son propre curseur qui sert à positionner une roue liée à un compteur. Tous les compteurs sont reliés par une système de progression de retenue.
L'animation de la figure de droite montre un cylindre de Leibniz à neuf dents qui est accouplé à une roue de compteur montée sur un axe parallèle (tous les deux de couleur rouge). Cette roue est positionnée de manière à ne toucher que les trois premières dents du cylindre et donc chaque rotation ajoute ou retranche trois au compteur.