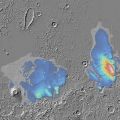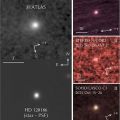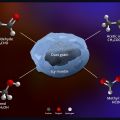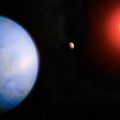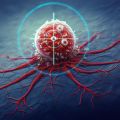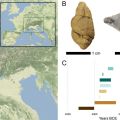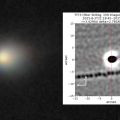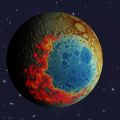Architecture lombarde - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Chronologie
Succession chronologique des travaux de construction des principaux ouvrages de l'architecture lombarde dont nous avons conservé des vestiges ou sur lesquels nous avons des informations. Dans de nombreux cas, toutefois, il ne s'agit pas de constructions ex novo, mais de restaurations, de réfections et de restructurations, parfois radicales, d'édifices préexistants et remontant à l'architecture paléochrétienne ou à l'architecture romaine. Les dates indiquées sont celles que la tradition associe aux divers édifices, ou bien elles font référence à la période pendant laquelle a régné le souverain qui, d'après les sources dont nous disposons, a fait exécuter les travaux.
VIème siècle

- vers 585- Basilica Autarena (Fara Gera d'Adda)
- vers 595- Palazzo Reale (Monza)
- vers 595- Basilique de Saint-Jean-Baptiste (Monza)
- Autres édifices remontant au VIème siècle, mais dont on ne connaît pas les dates exactes de construction :
- Mura di Benevento, début de construction
VIIème siècle
- vers 610- Complexe de Saint-Jean-Baptiste (Turin)
- vers 635- Basilique de Saint-Jean-Baptiste (Pavie)
- vers 650- Église Sant'Eusebio (Pavie)
- 657 - Monastère du Saint-Sauveur (Pavie)
- 677 - Église de Santa Maria in Pertica (Pavie)
- vers 680- Palazzo Reale (Pavie), agrandissement du Pertarito (Porta Palatina)
- Autres édifices remontant au VIIème siècle, mais dont on ne connaît pas les dates exactes de construction :
- Baptistère de Saint-Jean ad Fontes (Lomello)
- Basilique de Saint-Jean l'Évangéliste (Castelseprio), reconstruction
- Église de Saint-Étienne le premier martyr (Rogno)
- Rocca dei Rettori (Bénévent)
- Sanctuaire de Saint-Miachel-Archange (Monte Sant'Angelo), reconstruction
- Tempietto del Clitunno (Campello sul Clitunno)
VIIIème siècle
- vers 730-740- basilique San Pietro in Ciel d'Oro (Pavie)
- vers 730-740- Palazzo Reale (Pavie), agrandissement de Liutprand (chapelle palatine)
- vers 740- Complexe épiscopal du patriarche Callixto (Cividale del Friuli)
- vers 750- Tempietto longobardo (Cividale del Friuli)
- 753 - Monastère Sainte-Julie avec l'église Saint-Sauveur (Brescia)
- 758 - Badia Leonense (Leno)
- 760 - Église Sainte-Sophie (Benevento)
- 760-770 - Mura di Benevento, agrandissement par Arigis II de Bénévent
- vers 774- Complexe monumental de Sainte-Sophie (Bénévent)
- Autres édifices remontant au VIIIème siècle, mais dont on ne connaît pas les dates exactes de construction :
- Monastère de Torba (Castelseprio), cripta e ristrutturazione del Torrione
- Basilique Santa Maria (Cubulteria)
- Église du Saint-Sauveur (Spolète)
IXème siècle
- vers 830-840- Église Santa Maria foris portas (Castelseprio)
Caractéristiques

Les bâtiments les plus anciens construits pendant l'ère des Lombards en Italie, en particulier à Pavie, la capitale du royaume, ont été en grande partie détruits ou fortement remaniés aux époques suivantes ; il est possible cependant de distinguer une tendance au développement dans une direction anti-classique à travers les rares vestiges encore visibles et quelques reconstitutions graphiques. L'église de Pavie, aujourd'hui détruite, de Santa Maria in Pertica montrait, par exemple, un plan typiquement roman – octogonal avec déambulatoires et un cercle de colonnes à l'intérieur - mais le bâtiment central très élevé constituait une structure complètement inédite. De même, le Baptistère de Saint-Jean à Fontes de Lomello a marqué la séparation d'avec la compacité paléochrétienne grâce au verticalisme de l'octogone central. Malgré la perte de la plupart des bâtiments construits entre le VIe et VIIe siècles, les traces qui subsistent suffisent pour confirmer l'activité architecturale sous les Lombards qui, dans la construction de bâtiments de prestige civils et religieux, voyaient, comme les Romains avant eux, un moyen d'affirmer et de légitimer leur autorité
Tout au long des VIIe et VIIIe siècles, l'architecture lombarde évolua dans une direction originale : il se produisit un regain d'intérêt pour l'art classique, comme en témoignent de nombreuses références à des expressions artistiques de l'aire méditerranéenne. La combinaison de différents modèles, parfois d'ailleurs de manière contradictoire, et le développement de nouvelles techniques de construction atteignirent leur apogée dans les édifices construits sous le règne de Liutprand (712-744), en particulier à Cividale del Friuli. Avec le temps les Lombards améliorèrent leurs relations avec leurs sujets romains et manifestèrent une tendance à une renaissance culturelle ; dans le domaine architectural, divers édifices de cette période lombarde, du Tempietto longobardo de Cividale au monastère du Saint-Sauveur à Brescia, ont montré des échos en provenance de Ravenne. Cette époque donna une impulsion particulière à la fondation de monastères, soit pour manifester la foi de ceux qui ordonnaient leur construction, soit pour créer des lieux de refuges pour les biens et, parfois, pour les personnes elles-mêmes qui décidaient de les fonder. Le roi Didier (756-774), imité par de nombreux ducs, donna une impulsion considérable à cette tendance en favorisant des entreprises architecturales ambitieuses, qui ne trouvaient pas leurs pareilles dans l'Europe de l'époque.
Si, en Langobardia Maior, le développement autonome de l'art lombard connut une rupture en 774, après la défaite de Didier devant les Francs de Charlemagne, suivie de l'incorporation du royaume lombard à l'empire carolingien, en Langobardia Minor le parcours artistiques du modèle lombard put continuer son développement pendant des siècles, jusqu'à l'arrivée des Normands (XIe siècle). L'unité substantielle de l'architecture lombarde, cependant, est témoignée par le plus important édifice lombard en Italie méridionale, l'église de Santa Sofia à Bénévent : construite au VIIIe siècle, elle suit clairement le modèle avec corps svelte central élancé de Santa Maria in Pertica, mais en intégrant des éléments byzantins comme l'articulation des volumes, ce qui est le signe d'une relation dialectique plutôt que d'un simple refus avec des modèles culturels variés, et la même structure de base qui la relie à la basilique homonyme de Constantinople.
Dépourvus d'une tradition architecturale propre, les Lombards se tournèrent vers la main-d'œuvre locale chez laquelle il existait une industrie de la construction déjà organisée en corporations, avec des compétences et capable de garantir un niveau élevé dans l'exécution. Pour cette raison, l'uniformité artistique générale des complexes monumentaux décidés par les Lombards s'accompagne d'une certaine variété dans la mise en œuvre, avec des références différentes : en Neustria lombarde les caractéristiques d'origine mérovingienne furent plus marquées, alors qu'il y eut dans le Frioul une influence byzantine plus grande, accompagnée cependant de tout un réseau de références et d'influences réciproques communes à toute l'Italie.