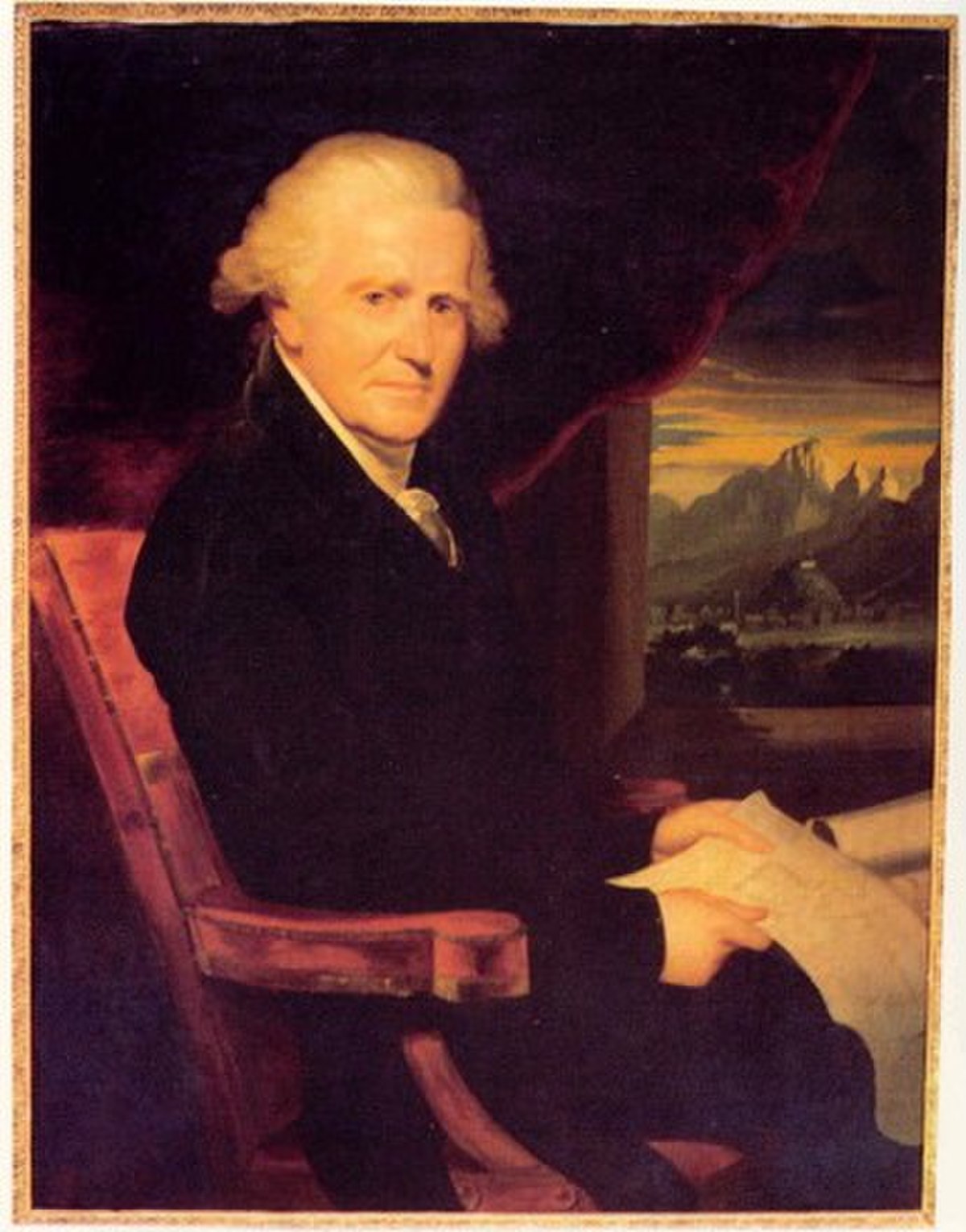Corse - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Politique
Les partis nationalistes, opposés à une économie uniquement axée sur le tourisme, ont réalisé une percée historique aux dernières élections régionales de mars 2010.
Histoire
Préhistoire
- à partir de -10000, fréquentation humaine de l'île
- vers -6500, présence humaine sur l'ensemble de l'île qui a laissé des traces, de Bonifacio au cap corse Petra curbara.
- -5000 : début de la civilisation proto-corse, issue probablement de populations venues de la péninsule ibérique (Ibères), d'Afrique du Nord (Libyques) et de la péninsule italienne (Ligures)
- -1500/-1300 : début de la civilisation Torréenne ; construction de statues-menhirs et de tours par les Torréens
Antiquité
Chronologie
- -565 : les Phocéens fondent Alalia, la cité du sel (actuelle Aléria)
- -535 : après une longue bataille navale où les Phocéens perdent environ soixante de leurs navires, les Étrusques de Toscane alliés aux Carthaginois chassent les Grecs ; cette bataille marque l'effondrement de la thalassocratie phocéenne
- -453 : les Syracusains de Sicile menés par Gélon chassent les Étrusques. Apelles, amiral de Syracuse, fonde Syracusenus Portus (actuelle Porto-Vecchio)
- -384 : Denys (Dionysos) Ier, tyran de Syracuse et successeur de Gélon, décide d'anéantir les prétentions puniques sur toute la mer Thyrrénienne. Pour cela il occupe les petites îles, les points forts de la côte orientale et fait de Syracusenus Portus une base avancée dont il se sert pour surveiller les régions alentour
- -280 : les Carthaginois, appuyés par des mercenaires torréens servant déjà dans les rangs de l'armée depuis le Ve siècle av. J.-C., chassent les Syracusains
- -259 : à la suite d'une décision prise cinq ans plus tôt au début de la Première guerre punique, les Romains entreprennent la conquête de la Corse. À la tête d'une importante flotte, Lucius Cornelius Scipio, dit Scipion l'Africain, surprend Alalia de nuit. À l'époque, il semblerait que la cité était libre, peuplée à la fois d'Étrusques et de Carthaginois. Scipion la brûle et la rebaptise Aleria
- -238 : seconde expédition romaine menée par Tiberius Gracchus. La Corse est réunie à la Sardaigne et devient la province romaine de Corse-Sardaigne
- -235 : cinquième expédition de Rome en Corse dirigée par Spurius Carvilius Maximus
- -232 : les Annales romaines citent un jeune Romain nommé Cristino comme étant celui qui a donné la victoire à Carvilius
- -227 : à la suite d'une nouvelle révolte, Rome accorde à la Corse un régime provincial ainsi que les « droits des peuples latins »
- -162 : début de la « paix romaine » après un siècle de guerre et une douzaine d'expéditions
- -105 : fondation de Mariana (au sud de l'actuelle Bastia)
Sources
Lorsqu'ils évoquent la Corse, les écrivains antiques sont unanimes à y représenter l'homme - à l'image de la nature qui l'environne - comme hostile :
"L'île de Cyrnos est connue des Romains sous le nom de Corsica. La vie y est partout misérable, la terre n'est que rocs, la plus grande partie du pays totalement impénétrable. Aussi les bandits qui occupent ses montagnes et vivent de rapines sont-ils plus sauvages que des bêtes fauves. Parfois les généraux romains y font des incursions, et après les avoir vaincus ramènent de très nombreux esclaves, et Rome voit alors avec stupéfaction à quel point ils tiennent du fauve et de la bête d'élevage. En effet, ils se laissent mourir par dégoût de la vie, ou excèdent à tel point leur propriétaire par leur apathie et leur insensibilité qu'ils lui font regretter son achat, si peu qu'il ait dépensé. Il y a cependant certaines portions de l'île qui sont, à la rigueur, habitables, et où l'on trouve même quelque petites villes, telles que Blésinon, Charax, Eniconiae et Vapanes".
Haut Moyen Âge
- 455 : fin de l'occupation romaine et invasion par des Vandales du roi Genséric, qui a conquis l'Africa romana. Premières épidémies de malaria
- 534 : les troupes byzantines du général Bélisaire, conquérant du royaume vandale d'Afrique, chasse les Vandales
- 550 : les Goths d'Italie du roi Totila, en guerre contre Byzance, font plusieurs incursions dans l'île
- 590 : intervention du pape Grégoire le Grand en raison des exactions byzantines
- 704 : première incursion des pirates sarrasins
- 725 : invasion par des Lombards d'Italie du roi Liutprand
- 771 : légende du prince romain Ugo Colonna, envoyé sur l'île par le pape Étienne III avec 1000 fantassins et 200 cavaliers, qui expulse les Sarrasins du « roi Negolone » après trente ans de lutte
- 774 : Le roi des Francs Charlemagne, devenu roi des Lombards, cède la Corse à la Papauté
- 806 : nouvelle incursion sarrasine : les envahisseurs sont chassés par une flotte envoyée par le roi Pépin d'Italie, l'un des fils de Charlemagne, devenu en 800, empereur d'Occident
- 807 : incursion de musulmans venus d’Espagne; ils sont délogés par un certain Burchard, un connétable envoyé par Charlemagne. Une bataille navale a lieu aux alentours de Porto-Vecchio coûtant treize navires et des milliers de morts aux envahisseurs
- 809 : l’Annaliste de Saint Bertin écrit que les « Maures, partis d’Espagne, envahissent la Corse, et le samedi de Pâques détruisent une cité où ils ne laissent survivre que son évêque et quelques vieillards et infirmes ». Cette cité pourrait être Aléria
- 825 : l’empereur d’Occident Louis le Pieux, l'un des fils de Charlemagne, envoie en Corse son fils Lothaire, puis en 828, le comte Boniface II de Toscane, pour en chasser les Maures. Ce dernier, après avoir reconquis la quasi-totalité de l’île, pourchasse les Maures jusqu’en Afrique. C’est lui qui fondera Bonifacio en 830
- 1014 : dernière incursion sarrasine du roi (ou chef) Abu Hosein Mogehid, battu par une flotte pisano-gênoise
Domination de Pise, d'Aragon et de Gênes
- 1077 : Grégoire VII confie l'administration de la Corse à l'évêque de Pise
- 1133 : les évêchés sont séparés en deux groupes (1 pour Gênes et 1 pour Pise)
- 1195 : installation de Gênes à Bonifacio
- 1268 : installation de Gênes à Calvi
- 1284 : bataille navale de Meloria ; Gênes défait Pise
- 1284 : la Corse devient la propriété de Gênes qui devient dominante en Méditerranée ; Pise est évincée
- 1297 : le pape Boniface VIII crée le royaume de Sardaigne et de Corse, concédé en zone féodée à la couronne d'Aragon
- 1363 : persécution et extermination des Ghjuvannali, confrérie prônant la non-violence. 20 000 personnes excommuniées et massacrées.
- 1383 : fondation de Bastia par Gênes
- 1401 : Mort du comte de Corse Arrigo della Rocca. Son fils passe dans le camp de Gênes
- 1405 : Vincentello d'Istria, soutenu par l'Aragon, est élu comte de Corse à Biguglia
- 1418 : Victoire décisive de Vincentello d'Istria contre l'armée génoise à Biguglia. Il est nommé vice-roi par l'Aragon
- 1420 : Intervention, avec sa flotte, du roi Alphonse V d'Aragon. Siège de Bonifacio
- 1434 : Le comte et vice-roi de Corse Vincentello d'Istria est décapité à Gênes
- 1511 : Mort du dernier seigneur souverain de la Rocca, Rinuccio della Rocca. Toute l'île passe sous le pouvoir direct de Gênes
- 1515 : Mort en exil à Rome du dernier comte de Corse, Giovan Paolo de Leca
- 1526 : début d'une période d'épidémie de peste qui dure 4 ans
- 1551 : Sampiero Corso occupe la Corse avec les Turcs pour le compte de la France
- 1559 : traité du Cateau-Cambrésis. La Corse est rendue à Gênes
- 1594 : parution de la première histoire de la Corse
- 1725 : naissance de Pascal Paoli
- 1729 : soulèvement des Corses à la suite de mauvaises récoltes et de nouvelles taxes
- 1730 : en décembre, consulte de Saint-Pancrace ; la Corse déclare son indépendance
- 1731 : les troupes impériales arrivent en Corse à la demande de Gênes
- 1732 : paix de Corte qui ne sera pas respectée
Le Gouvernement de Pascal Paoli (1735-1769)
- 1735 : 30 janvier, déclaration d'indépendance par la consulta d'Orezza
- 1735 : première Constitution corse
- 1736 : un aventurier, Théodore de Neuhoff devient roi des Corses
- 1737 : convention de Versailles entre la France et Gênes
- 1738 : première intervention française
- 1747 : seconde intervention française
- 1755 : 14 juillet, Pascal Paoli est proclamé général de la Nation par la consulte de Sant'Antone di a Casabianca, c'est le début de l'indépendance.
- 1755 : seconde Constitution corse. Pascal Paoli y définit « le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ».
- 1765 : ouverture de l'Université de Corse Pascal-Paoli.
La Corse française
- 1768 : 15 mai, par le traité de Versailles Gênes cède la Corse à la France.
- 1768 : 9 octobre, les troupes paolistes mettent en déroute l'armée française à Borgo.
- 1769 : 8 mai, les troupes de Pascal Paoli perdent la bataille de Ponte Novu, la Corse devient française.
- 1769 : 13 juin, Pascal Paoli quitte la Corse pour la Grande-Bretagne.
- 1769 : 15 août, naissance de Napoléon Bonaparte à Ajaccio.
- 1769 : fermeture de l'Université de Corte par Louis XV.
- 1789 : l'Assemblée nationale décrète que « la Corse fait partie de la France ».
- 1790 : création du département de Corse avec pour capitale Bastia.
- 1793 : séparation de la Corse en deux départements, le Liamone et le Golo.
- 1794 : mise en place du Royaume Anglo-Corse.
- 1796 : les troupes françaises reprennent l'île qui a été évacuée par les Britanniques.
- 1796 : la Corse compte 150 000 habitants.
- 1805 : décret de surséance qui accorde un délai pour l'emploi de la langue française dans les actes publics en Corse, région de langue italienne jusqu'en 1858.
- 1807 : mort de Pascal Paoli.
- 1811 : restauration du département de Corse mais avec Ajaccio pour chef-lieu.
- 1821 : Napoléon Bonaparte meurt sur l'Île Sainte-Hélène.
- 1840 : voyage de Prosper Mérimée dans l'île.
- 1849 : 10 août : Nomination du premier « Monsieur Corse » de l'histoire.
Louis Napoléon Bonaparte alors Président de la République donne mission à Jacques Pierre Abbatucci (futur garde des Sceaux) de faire un rapport sur les besoins de la Corse, et le charge du suivi des dossiers relatifs à l'Île auprès des différents ministères concernés.
Le coup d'État du 2 décembre 1851 de Napoléon III est largement soutenu en Corse, département catholique, conservateur et monarchiste ; elle fait même partie des quatre départements où aucun opposant n'est arrêté.
- 1858 : 4 août : la langue française devient la langue employée en Corse (Cour de cassation : nullité de tout acte rédigé en italien, langue la plus diffusée dans l'île).
- 1881 : la Corse compte 273 000 habitants.
- 1890 : en l'espace d'un siècle la population de l'île a presque doublé.
- 1905 : naissance de l'équipe de football bastiaise.
- 1907 : naissance à Ajaccio du célèbre chanteur corse Tino Rossi, né Constantin Rossi.
- 1908 : naissance de l'équipe de football cortenaise.
- 1910 : naissance de l'équipe de football ajaccienne (l'Athletic Club d'Ajaccio).
- 1918 : avec 11 300 morts au bout de quatre années de guerre, la Corse est l'un des départements qui paye, proportionnellement à sa population, le plus lourd tribut en vies humaines.
- 1939 : interdiction du journal A Muvra, considéré comme pro-italien.
La Seconde Guerre mondiale
- 1941: À la demande de l'Italie, l'armée allemande regroupe les prisonniers de guerre corses dans des camps spéciaux: le Stalag VB et l'Oflag VC.
- 1942 (novembre) - 1943 (septembre), les troupes italo-allemandes envahissent l'île. Elle sera occupée par les troupes italiennes.
- mars 1943, suicide de Fred Scamaroni, prisonnier à la Citadelle d'Ajaccio
- août 1943 : exécution de Jean Nicoli à Bastia
- 8 septembre 1943 : à la suite de la chute du régime fasciste à Rome, les troupes allemandes occupent l'île.
- 9 septembre 1943 au 5 octobre 1943 : les italiens (80 000 soldats), des partisans locaux (1 000) et environ 4 000 soldats français (indigènes pour la plupart) combattent la Wehrmacht. Plus de 700 soldats italiens auront été tués, mais les troupes italiennes laissent à l'armée française l'honneur d'entrer en premier à Bastia. Le 8 octobre 1943, le général de Gaulle proclame à Ajaccio : « La Corse, premier morceau libéré de la France. »
- 1944 : l'île devient une base - le « porte-avion » - pour la poursuite des opérations en Italie puis pour le débarquement en Provence (août 1944).
- 1945 : procès contre les irrédentistes. Condamnation de Petru Rocca à 15 ans de prison pour collaborationnisme.
La Corse contemporaine
- 1957 : arrivée massive de rapatriés d'Algérie (jusqu'en 1965)
- 1958 : création de la Somivac (Société pour la mise en valeur agricole de la Corse). 90 % des terres ayant été promises auparavant aux paysans corses seront réservées aux rapatriés d’Algérie.
- 1960 : en avril, le gouvernement Debré décide de créer un centre d’expérimentations nucléaires souterraines dans les mines désaffectées de l’Argentella, au sud de Calvi : manifestation de protestation unanime.
- 1960 : la population de l'île est retombée à 160 000 habitants
- de 1965 à mi-1970 : radicalisation des revendications d'abord régionalistes puis autonomistes et enfin nationalistes. L'île est dans un état d'isolement et de retards techniques considérables : peu de routes, des communications difficiles et coûteuses avec le continent, des installations sanitaires médiocres, une carte scolaire déplorable, pas d'université...
- 1972 : « affaire des boues rouges » de la Montedison, déversements de produits toxiques au large du Cap Corse. Après diverses manifestations, un commando clandestin dynamitera le navire pollueur.
- 1975, 21 août : « affaire d'Aléria » : une douzaine d'hommes armés de fusils de chasse, représentée par le docteur Edmond Simeoni, occupe la ferme d'un viticulteur rapatrié accusé d'être mêlé à un scandale financier. 1 200 gendarmes et CRS cernent les bâtiments. Bilan : deux gardes mobiles tués et un militant gravement blessé.
- 1975 : suite à cette affaire, entre le 23 et le 26 août, d'importantes émeutes nocturnes ont lieu à Bastia. Michel Poniatowski, ministre de l'intérieur, envoie les blindés sur Bastia.
- 1976 : le 5 mai, au cours d'une nuit bleue création du FLNC réclamant la reconnaissance des droits nationaux du peuple corse, le droit à l’autodétermination et un pouvoir populaire démocratique en Corse.
- 1976 : mise en place de la « bidépartementalisation » : l'île est organisée en deux départements, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud
- 1981 : « réouverture » de l'université de Corse à Corte
- 1982 : les lois du 2 mars et 30 juillet donnent un statut particulier à la région Corse et la première assemblée de Corse est élue au suffrage universel direct le 8 août.
- 1983 : décès du célèbre chanteur corse Tino Rossi
- 1991 : statut Pierre Joxe voté, l'assemblée de Corse dispose de compétences élargies
- 1992 : aux élections territoriales, les nationalistes (toutes tendances confondues : Corsica Nazione, MPA...) dépassent 25 % des voix.
- 1995 : Les deux principales branches issues du FLNC, de l'époque, le FLNC Canal Historique et le FLNC-Canal Habituel se livrent à des règlements de comptes « fratricides » qui font plus d'une quinzaine de morts.
- 1998 : assassinat du préfet Claude Érignac.
- 1999 : affaire des paillotes. La paillote (construite illégalement) « chez Francis » est incendiée (tout aussi illégalement) par les gendarmes du GPS au cours d'une action clandestine sur ordre du préfet Bernard Bonnet.
- 2000 : en août, le premier ministre Lionel Jospin propose un nouveau statut pour la Corse connu sous le nom de processus de Matignon qui est voté par l'Assemblée Nationale le 4 décembre
- 2002 : loi élargissant à nouveau les compétences de la collectivité territoriale de Corse et lui confiant notamment de nouvelles responsabilités dans des domaines tels la gestion des ports et aéroports, la carte des formations ou la préservation des monuments historiques.
- 2003 : 6 juillet : rejet par une majorité d'électeurs habitant sur l'île du projet de collectivité unique. Marquant une victoire des républicains conduits par Émile Zuccarelli, ce référendum est, pour ces derniers, un tournant décisif dans l'histoire politique récente avec l'arrêt des réformes institutionnelles.
- 2008 : 12 janvier: à la suite d'une manifestation nationaliste, ceux-ci, qui devaient initialement se diriger vers la préfecture, occupent l'Assemblée Territoriale Corse pendant près de trois heures (s'en suit un incendie qui ravage des bureaux dont celui du président de l'Assemblée)
Aux élections présidentielles, la Corse est l'une des régions de France qui votent le plus massivement en faveur de Nicolas Sarkozy (plus de 61 % des voix), candidat élu.
- 2009 : Le PADDUC (le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse) initié par la majorité UMP de l'Assemblée de Corse suscite la polémique sur l'île. Accusé, entre autres, d'être basé sur le tout-tourisme et de ne pas respecter assez l'environnement, le projet rencontre une vive opposition. Il est finalement repoussé, et figure parmi les enjeux des élections territoriales de 2010.
- 2010 : La gauche, menée par Paul Giacobbi, remporte pour la première fois depuis 24 ans les élections territoriales. Les nationalistes, toute tendances confondues (Femu a Corsica et Corsica Libera), réalisent quant à eux un score historique en dépassant les 35 % des voix.