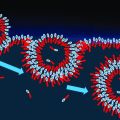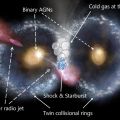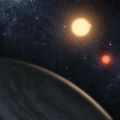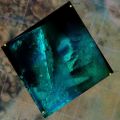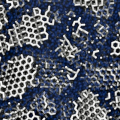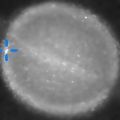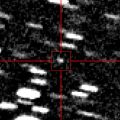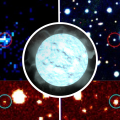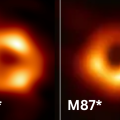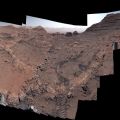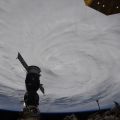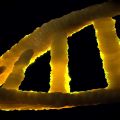École des officiers du commissariat de la marine - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Histoire

La première organisation administrative durable de la marine française émerge en 1294 lorsque Philippe le Bel fonde à Rouen le Clos des Galées. À la tête de ce premier arsenal est placé le Garde du Clos, directeur technique, administratif et financier avant l’heure. Le corps des commissaires se constitue ensuite progressivement sous Richelieu puis Colbert. Il conçoit dès le début du XVIIIe siècle un premier système de formation pour ses futurs officiers.
1716 : mise en place d’une formation pratique pour les commissaires
En 1716, des "petits commissaires", recrutés d'après leur noblesse ou les services rendus par leur famille, sont placés en stage dans les détails » des ports, aujourd’hui les services de soutien, pour se former à l’administration. Voués d’office à des emplois élevés, ces « petits commissaires » accèdent ensuite directement au grade de commissaire. L’initiation professionnelle est alors exclusivement basée sur l’exercice du métier.
Cette volonté de formation professionnelle perdure avec la création en 1765 par le duc de Choiseul-Stainville des élèves-commissaires, qui remplacent les « petits commissaires ». On exige des élèves-commissaires qu’ils connaissent l’arithmétique, qu’ils écrivent correctement et qu’ils soient de bonne famille. Répartis entre Brest, Rochefort et Toulon, ils sont toujours affectés aux différents « détails » et embarquent également pour suivre d’autres stages pratiques que sanctionne au bout de trois années un examen passé devant l’intendant. Ils sont alors déclarés admissibles au grade de sous-commissaire ou congédiés.
Les élèves commissaires laissent la place aux élèves d’administration créés en l’an XII. Ceux-ci doivent accomplir trois ans de service, dont six mois à la mer, avant de concourir pour le grade de sous-commissaire. Réunis en stage à Brest, un commissaire est chargé de les suivre et de rendre compte au préfet maritime de leurs résultats et de leur conduite. Ce système jugé trop aristocratique est supprimé en 1830. En 1847, il est enfin prévu que les commissaires soient recrutés parmi les élèves sortant de l’Ecole polytechnique et de l’Ecole navale.
A défaut d’un cours d’administration proprement dit, la formation reste essentiellement basée sur la pratique de terrain dans les « détails ». Toutefois, les intendants ont été amenés à mettre sur pied de véritables écoles d’administration dans leurs ports, dès le début du XVIIIème siècle, au profit des écrivains de marine et des commis. Il s’agit de leur faire suivre une formation théorique relative à l’administration navale. Ecrivains et commis de marine étaient chargés principalement de la tenue des écritures comptables et de la paie sous les ordres des commissaires placés à la direction des services.
1863 : création du premier cours d’administration des élèves commissaires
Le décret impérial du 7 octobre 1863 est à l’origine de l’institution assurant la formation des jeunes commissaires de la marine. En effet, ce texte réorganise le corps du commissariat et crée le cours d’administration des élèves commissaires.
Le recrutement s’opère désormais parmi les licenciés en droit parce que, précise le décret de 1863, les commissaires « auront à appliquer les règles prescrites par nos lois civiles et administratives. » Le décret prévoit également que deux places d’aide-commissaire sont offertes chaque année à des élèves sortant de l’École polytechnique, l’admission étant faite dans le garde de commissaire de troisième classe. Enfin, un recrutement par changement de corps est organisé en faveur des officiers de marine : les enseignes de vaisseau peuvent être nommés aide-commissaire alors que les lieutenants de vaisseau peuvent prétendre au grade de sous-commissaire. Le décret de 1863 s’inscrit dans la tradition de l’an XII, de 1765 et même de 1716. L’institution d’un cours d’administration introduit davantage de théorie dans la formation des élèves commissaires, sans toutefois abandonner la pratique. Ce cours est d’abord partagé en 1867 entre Brest et Toulon, puis réuni à Brest en 1871, partagé à nouveau en 1875-76 entre Lorient, Cherbourg et Brest.
| L’ordonnance du 3 janvier 1835 précise la hiérarchie du corps des commissaires de la marine : |
|---|
| commissaire général (2 classes), |
| commissaire (2 classes), |
| aide-commissaire, |
| commis principal, |
| commis ordinaire (3 classes) |
Ce partage est la conséquence de la priorité encore accordée à la formation pratique, les stages dans chaque « détail » ne pouvant être fructueux que si les élèves ne sont pas trop nombreux. Les stages embarqués permettent aussi aux élèves de s’initier au service courant des bâtiments. En revanche, les cours théoriques ne pouvant se permettre une dispersion, un regroupement définitif du cours d’administration est opéré à Brest en 1885. Le commissariat recouvre alors l’administration tout entière de la marine, de l’inscription maritime, de la marine marchande, des troupes de marine et des colonies.
1910 : constitution de l’Ecole du commissariat de la marine
Avec le temps, le cours d’administration des élèves-commissaires se transforme en une véritable école. En 1910, l’École du commissariat de la marine (ECM) ouvre ses portes rue Louis-Pasteur à Brest et succède au cours d’administration dans un contexte renouvelé.
En effet, les cours se recentrent sur l’organisation de la marine, le fonctionnement de son commissariat et les statuts des différents personnels, le commissariat colonial s’étant séparé du commissariat de la marine en 1889 pour devenir l’intendance des troupes coloniales en 1902. La même année est créée le corps de l’inscription maritime, intégralement constitué à l’origine de commissaires et dont les élèves administrateurs demeurent formés conjointement avec les élèves commissaires jusqu’en 1910. Du fait de ces évolutions, le cours de « service à la mer » qui traite de l’administration des bâtiments de la marine et correspondant au premier métier qui suit la sortie de l’école, est l’objet d’une attention de plus en plus prononcée.
En matière d’encadrement, le professeur et le professeur suppléant du cours d’administration deviennent en 1910 directeur et sous-directeur. En 1913, un autre commissaire leur est adjoint, chargé plus spécialement du cours de « service à la mer ». Plus tard, un second professeur de « service à la mer » est affecté afin de concilier les nécessités de l’enseignement à l’école avec celles de l’encadrement d’une promotion lors de son école d’application sur la Jeanne-d’Arc. Après avoir libéré au printemps 1940 la promotion d’élèves commissaires de l’automne 1939 qui a suivi une formation accélérée, l’Ecole du commissariat de la marine ne rouvre ses portes à une nouvelle promotion qu’en 1941 à Toulon. Dès lors, l’école est amenée à vivre dans le provisoire. Evacuée en 1943 à Annecy, puis à Menthon Saint-Bernard, la division des forces françaises conduit à la création parallèle de deux autres écoles ou cours de façon temporaire. A Londres d’abord où de mars 1942 à août 1943, une école des FNFL tient trois sessions. À Casablanca ensuite, où une école de commissaires de réserve forme une promotion début 1944. En septembre 1946, l’École du commissariat de la marine se réinstalle sous les voûtes de l’ancienne corderie royale édifiée au XVIIe siècle, l’un des bâtiments les plus anciens de Toulon.
1991 – 2005 : du GECM à l’EOCM
Le Groupe des écoles du commissariat de la marine (GECM) se constitue en 1991 lorsque l’École d’administration de la marine (EAM) rejoint l’École du commissariat de la marine à Toulon. L’EAM a été fondée en 1919 à Rochefort puis s’est s’installée à Cherbourg en 1927. Elle a déjà côtoyé l’ECM en 1944 lorsqu’elle a été transférée temporairement à Menthon-Saint-Bernard, avant de retourner à Cherbourg en 1945.
L’ECM centre la formation des élèves commissaires, dont l’origine est universitaire, sur leur premier métier de commissaire embarqué sur bâtiment de combat, tout en les préparant à leurs futures fonctions d’officiers chargés de l’administration générale de la marine. L’EAM, au sein du GECM, apporte aux officiers élèves du corps technique et administratif de la marine issu des équipages, une formation générale d’officier et de cadre administratif. Aux élèves d’active, il faut ajouter les élèves officiers de réserve des deux corps, les officiers spécialisés de la marine des branches administration, restauration collective et directeur de foyer en stage de spécialité ainsi que les stagiaires étrangers en provenance de l’Afrique francophone, tous également formés au GECM.
En septembre 2005, le GECM est transféré de Toulon à Lanvéoc-Poulmic dans le Finistère, sur le site de l’École navale, pour devenir l’École des officiers du commissariat de la marine (EOCM). L’ECM et l’EAM n’existent donc plus en tant que telles car regroupées au sein d’une seule entité, l’EOCM. L’évolution de la formation maritime des élèves commissaires est l’une des raisons qui ont conduit au déménagement de l’école. Dans la perspective des futures frégates multi-missions à équipage optimisé, il est en effet apparu indispensable que les commissaires soient chefs de quart en passerelle. La marine ayant adopté la norme internationale STCW pour la formation de ses chefs de quart, l’École navale, au titre de son expertise maritime et de ses moyens (simulateur de navigation, bâtiments-écoles, etc.), est la mieux à même de former les élèves commissaires dans le domaine de la formation de l’officier naviguant. Le rapprochement de l’EOCM vers l’Ecole navale permet également de nombreuses synergies dans la formation humaine et militaire ou la formation pratique au commandement.
Ce transfert permet de manière plus générale de concentrer sur un campus unique toutes les formations initiales d’élèves officiers de la marine en favorisant de nombreux rapprochements. L’EOCM fait également partie depuis le 1er janvier 2008 du Réseau des Écoles du Service Public (RESP) au même titre que l’ENA, l’école de la magistrature ou que celle des officiers de gendarmerie.