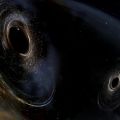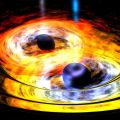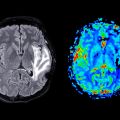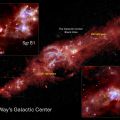École nationale des chartes - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Cursus
Concours d'accès
Les élèves français sont recrutés sur concours préparés dans certaines classes préparatoires littéraires. Depuis 1991, il est divisé en deux sections :
- Section A, dite « classique », dont le programme comporte entre autres matières de l'histoire médiévale et moderne et du latin ;
- Section B, dite « moderne », dont le programme comporte entre autres matières de l'histoire moderne et contemporaine et des langues vivantes.
Le concours est préparé dans les classes préparatoires à l'École des chartes (« hypochartes » puis « chartes »). Selon les lycées, les élèves préparant les concours A et B sont soit réunis dans une seule division avec des options distinctes, soit répartis dans deux sections différentes. Ceux qui préparent l'option B peuvent être regroupés dans des khâgnes avec des options supplémentaires.
En outre, un concours d'accès direct en deuxième année est ouvert aux candidats justifiant du niveau minimum de la licence en théorie ; en pratique, ce concours s'adresse à des candidats déjà engagés dans un parcours de recherche avancée ; l'École porte son attention par exemple sur des lauréats du concours d'agrégation ou des doctorants.
Le nombre de places aux concours est très limité (environ 25 par an pour le total des trois concours) et bien inférieur au nombre de postes vacants dans les établissements publics d'archives.
Une réforme du concours d'entrée est envisagée pour 2009 afin de rapprocher le concours de ceux des Écoles normales supérieures, avec certaines épreuves communes.
Statut des élèves
Les élèves recrutés par ces concours peuvent bénéficier du statut de fonctionnaires-stagiaires et sont donc rémunérés (environ 1 200 euros par mois). Des élèves étrangers recrutés également par concours ou sur titres suivent le même cursus sans être rémunérés mais bénéficient de bourses d'études à peu près équivalentes au traitement de base des élèves fonctionnaires.
La scolarité dure trois ans et neuf mois. À l'issue de leur scolarité, les chartistes doivent rédiger une thèse d'établissement, donnant droit au diplôme d'archiviste paléographe.
Les fonctionnaires ayant rempli les obligations de troisième année peuvent postuler l'entrée de deux écoles d'applications, l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (Enssib, concours réservé) et l'Institut national du patrimoine (, concours ouvert). La direction de l'École nationale des chartes insiste tout particulièrement pour que les élèves s'orientent vers ces deux écoles, le législateur ayant considéré qu'elles constituent le complément indispensable à leur formation initiale afin qu'ils puissent continuer à occuper des postes de bibliothécaires et d'archivistes. Après leur scolarité dans ces écoles considérées pour eux comme des écoles d'application, ils deviennent respectivement conservateurs des bibliothèques et conservateurs du patrimoine. Chaque année, un certain nombre d'élèves passent l'agrégation (lettres, histoire, etc.) et s'orientent vers la recherche ou l'enseignement.
Formation et enseignements
L'enseignement est découpé en six semestres. Les enseignements sont constitués d'un tronc commun et d'options choisies par chaque élève en fonction de son projet scientifique et professionnel. Ces options sont conçues en collaboration avec un établissement universitaire.
Ainsi, les élèves suivent notamment des enseignements de :
- paléographie latine et française (autres langues au cours de séminaires)
- archivistique, diplomatique et histoire des institutions ayant produit ces archives (médiéval, moderne, contemporain)
- histoire du droit civil et canon
- philologie romane
- latin médiéval
- histoire de l'art (médiéval, époques moderne et contemporaine)
- archéologie médiévale
- édition de texte
- bibliographie
- histoire du livre
- critique de l'image documentaire
- manuscrit et textes littéraires médiévaux
- statistiques et cartographie appliquées à l'histoire
- langues vivantes et informatique.
Des crédits ECTS sont alloués aux divers enseignements, ce qui permet à des élèves d'universités ou d'autres grandes écoles de suivre et valider certains de ces cours. Les enseignements dispensés à l'École des chartes peuvent donc s'inscrire dans les composantes des masters ; cela est rendu possible par le nouveau cadre de la réforme LMD. Les cours sont également ouverts sous condition à des auditeurs libres.
Master
Depuis 2006, l'École des chartes a ouvert un master recherche, mention « Nouvelles technologies appliquées à l’histoire », formant vingt élèves par an. En première année, la scolarité s'organise autour d'un socle commun et de cinq options (archives médiévales ; archives modernes et contemporaines ; manuscrits et littérature du Moyen Âge ; histoire du livre et des médias (XVIe-XXIe siècles) ; histoire de l'art et archéologie). En seconde année, deux parcours sont proposés, l'un tourné vers la recherche et l'autre, plus professionnel, vers le patrimoine et la diffusion des connaissances. Le master reprend pour une grande part les enseignements des élèves de l'école.
Classe préparatoire intégrée à l'Institut national du patrimoine
L'école des chartes assure une partie de la préparation au concours de conservateur du patrimoine, spécialité archives, des étudiants retenus dans la classe préparatoire intégrée de l'INP. Ces étudiants sont sélectionnés sur critères sociaux et académiques.