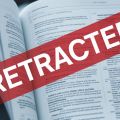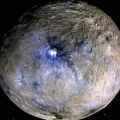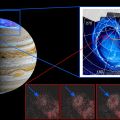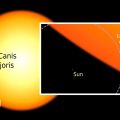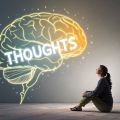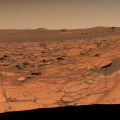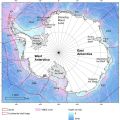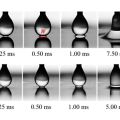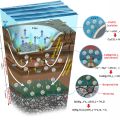Église des Chartreux (Marseille) - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Construction du monastère
La chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon aida régulièrement cette nouvelle fondation. Des dons de familles aristocratiques (Antoine de Valbelle, Gaspard de Foresta, Jean Garnier, Louis de Paulo) permirent d’édifier les premières cellules des moines ainsi que le petit cloître qui fut terminé en 1651 et béni le 16 avril 1652 par l’évêque de Marseille, Étienne de Puget. Le couvent s’équipe en livres précieux, vases et vêtements sacrés grâce aux dons de la chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon.
En 1666 Dom Jean-Baptiste Berger est nommé prieur de la Chartreuse de Marseille. Il se révéla bon administrateur mais fit surtout preuve de réels talents d’architecte ; il réalisa le projet d’ensemble des bâtiments du monastère et de l’église. La construction de l’église débuta en 1680, mais, des difficultés financières étant apparues, elle ne fut consacrée par l’évêque de Marseille, Charles de Vintimille du Luc, que le 11 décembre 1702.
L’apogée du monastère sera atteint à la fin de ce XVIIe siècle grâce notamment au prestige de ses prieurs, en particulier Dom Berger (prieur de 1666 à 1675 et de 1700 à 1702). Celui-ci était parvenu presque au sommet de la hiérarchie cartusienne. En 1686, il fut prieur de Rome et procureur général de l’ordre des Chartreux. Après avoir obtenu d'être relevé de ses charges, il fut rappelé pour être prieur de Villeneuve-Lès-Avignon puis de Marseille. A peine l’église achevée, il se retira définitivement et mourut comme simple religieux à Marseille le 2 janvier 1719.
De 1703 jusqu’à la Révolution, la communauté mena dans ses bâtiments neufs une existence paisible.
L’église actuelle
L’église des chartreux bien que située en dehors des circuits traditionnels touristiques, mérite une visite car elle est la plus belle réalisation religieuse du XVIIe siècle marseillais avec la chapelle de la Vieille Charité.
L’extérieur
La façade de l’église d’une hauteur de 31 m. est précédé d’un péristyle de 28.60 m. de largeur soutenu par huit colonnes ioniques hautes de 10.60 m. et de 1.95 m. de diamètre. L’entablement porte l’inscription : Cartusia villae novae hanc massiliensem fundavit anno MDCXXXIII (La chartreuse de Villeneuve a fondé cette maison à Marseille en 1633). Au-dessus des colonnes, huit socles devaient porter des statues qui, faute de financement, n’ont jamais été mises en place. L’ordre supérieur, en retrait de cinq mètres, ne correspond qu’à la nef centrale. Il est décoré de quatre pilastres corinthiens avec au centre une grande verrière. Un fronton surmonté de la croix couronne le tout.
Les épais ventaux de la porte en noyer sont l’œuvre de maîtres menuisiers : Olivier Guignat et Jean-Baptiste Onillon (1700). Deux médaillons ont été ajoutés en 1956 représentant Saint Bruno et Sainte Marie Madeleine, sculptés par Alfred Lang.
L’intérieur
La grande nef mesure 46.90 m. de long, 10.20 m. de large et 25.60m. de haut. Sa décoration principale est une remarquable corniche. Dans cette grande nef se trouvent le grand orgue de la maison Cavaillé-Coll (1912), une chaire monumentale en bois de chêne, de style flamand, provenant des ateliers des frères Goyer de Louvain (1862), le maître autel de Dupoux (1893), un christ taillé dans un tronc de la Sainte Baume par Chauval, artiste de passage, et sous la coupole l’emblème des chartreux à savoir un globe crucifère entouré de sept étoiles.
Les collatéraux abritaient les chapelles destinées aux messes lues des pères chartreux.
- Collatéral gauche : Dans la première travée on remarque la chapelle des fonts baptismaux avec une statue en marbre Notre Dame du rosaire qui avait été enfouie dans les anciens jardins du monastère par les derniers occupants du couvent afin de la soustraire à la destruction révolutionnaire. Dans la cinquième travée se trouve une statue de Saint Joseph à l’enfant Jésus. Dans la dernière travée on remarque la chapelle de la Vierge.
- Collatéral droit : dans la première travée statue de Sainte Thérèse de l’enfant Jésus, dans la deuxième tombeau de Dom Joseph Martinet surmonté de son masque mortuaire, dans la cinquième statue de Saint Antoine de Padoue par Louis Botinelly (1956), dans la sixième statue de Saint Bruno également par Louis Botinelly. Au fond chapelle de Sainte Marie Madeleine avec sa statue par Botinelly, un autel tabulaire de Lang et une reproduction du projet initial de la Chartreuse par Dom Berger.
De nouveaux vitraux remplacent ceux de 1870 brisés à la suite d’une explosion survenue le 3 septembre 1952 dans les locaux d’une usine voisine et qui fit 17 morts.