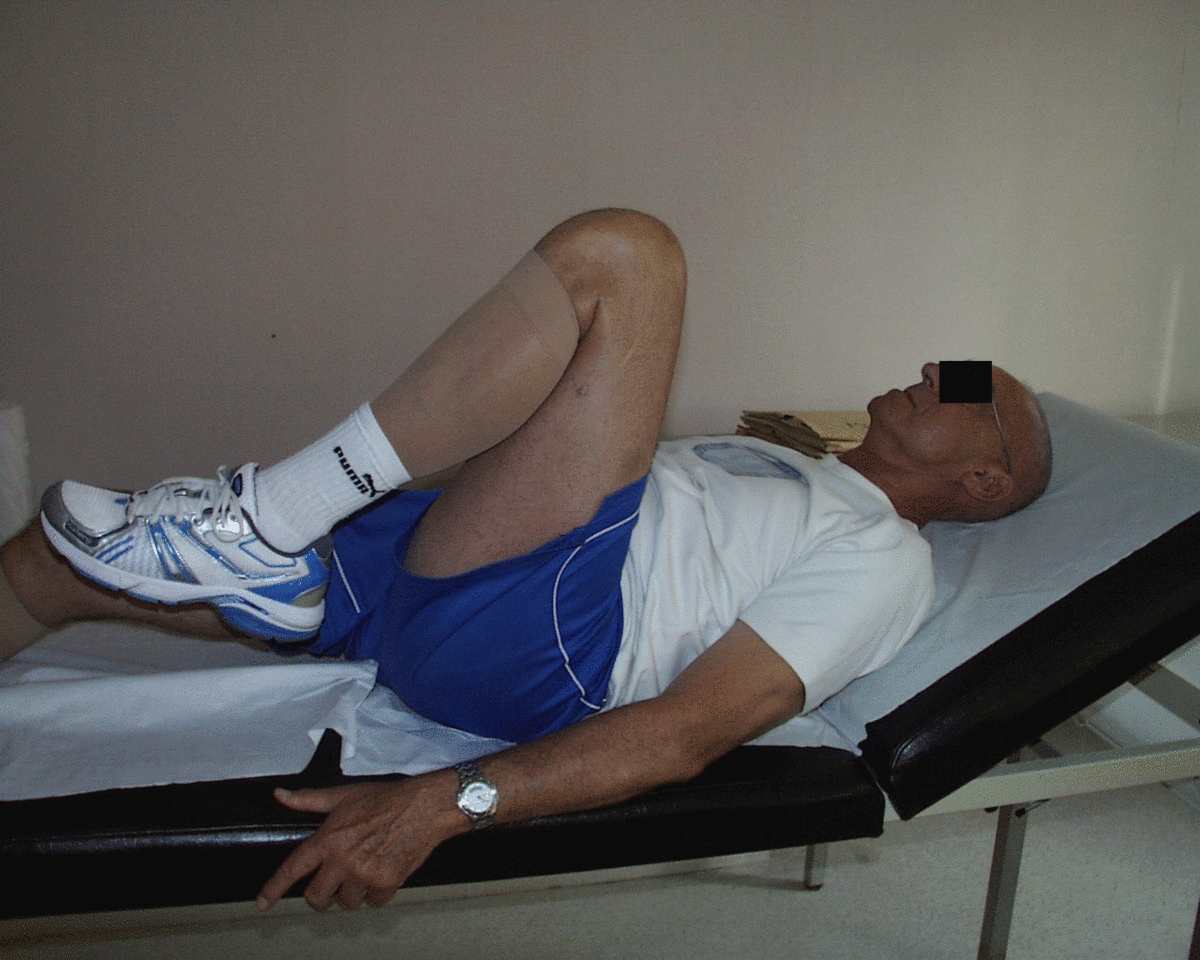Prothèse totale de hanche: techniques mini invasives et Rapid Recovery - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Suites opératoires et Rapid Recovery
Les programmes dits Rapid Recovery (« rétablissement rapide »), destinés à accélérer la récupération fonctionnelle des patients reposent sur des années d'expérience et de progrès. Cela a permis de cerner les facteurs majeurs qui conduisent à une récupération rapide.
Les personnes porteuses d’une coxarthrose ne sont pas des malades. Dans l’intérêt du patient ; l’alitement, l’immobilisation et l’hospitalisation après une intervention pour prothèse doivent être réduits au strict minimum.
La population des opérés est beaucoup moins homogène que dans les années 1980. À cette époque, la plupart des patients étaient dans la tranche d’âge 65-75 ans. Actuellement, si ce groupe reste majoritaire, les indications se sont étendues vers des patients bien plus jeunes et aussi des patients bien plus âgés. Or ces personnes, qui aujourd’hui quittent l’hôpital entre le 3e et 5e jour, sortent plus en forme que leurs devancières après 15 jours. Une des raisons principales s’appelle l’hospitalisme. Une personne hospitalisée a hâte de rentrer chez elle dans les premiers jours, car elle se sent moins bien à l’hôpital que chez elle. Le départ est vécu comme le retour à la normale. Mais après un délai de 7 à 8 jours, elle s’accoutume à sa situation nouvelle et s’installe dans les habitudes du monde de l’hôpital. Le départ est alors vécu de façon plus ou moins angoissante comme une rupture avec ces nouvelles habitudes.
Tous les travaux de suivi des infections nosocomiales prouvent que leur survenue est corrélée avec l’augmentation de la durée d’hospitalisation, que ce soit en service de médecine, de chirurgie ou de soins de suite. Cela plaide pour un séjour bref en chirurgie et pour un retour à domicile, sauf nécessité. Le programme Rapid Recovery s’inscrit dans cette évolution.
Il est basé sur :
- une meilleure information du patient ;
- la mise en contact de plusieurs personnes opérées dans la même période, avant et pendant le séjour ;
- une dynamisation par le groupe : intervention, rééducation, repas, etc.
Avant l'opération
Après avoir consulté le chirurgien, quand le patient a pris sa décision de se faire opérer, il va convenir de la date opératoire avec le secrétariat. Une consultation avec le médecin anesthésiste sera fixée, environ 4 semaines avant la date d'intervention. Habituellement plusieurs opérés par la technique ASIA seront programmées pour être opérées le même jour et le jour suivant.
Le programme Rapid Recovery va alors débuter, par une réunion d'information. Les futurs opérés des mêmes dates y sont conviés, avec l'accompagnant de leur choix, pour se voir expliquer la prothèse, l'intervention, l'anesthésie, l'hospitalisation, la rééducation. Ils vont faire connaissance avec les autres personnes qui formeront avec eux un groupe de séjour, réuni par la même intervention. Ils vont se retrouver pendant l'hospitalisation, surtout au cours de la rééducation.
Successivement le chirurgien, l'anesthésiste, le surveillant de l'unité de soin, le kinésithérapeute expliquent le déroulement prévisible et répondent aux interrogations des patients. Cela permet une information dans un contexte plus calme que celui de la consultation et donc mieux comprise.
À l'admission
Le patient se verra rappeler des informations données lors de la réunion. Il ne s'étonnera pas que plusieurs personnes posent la même question, notamment sur son identité et le côté à opérer. Cela fait partie des mesures qui augmentent la sécurité de prise en charge. La préparation commencera dans cette phase, avec la dépilation du champ opératoire (effectué à la tondeuse ou avec une crème), puis une douche au savon antiseptique. Une seconde douche aura lieu le matin, avant de descendre au bloc opératoire. Il retrouve des personnes dont il a fait la connaissance lors de la réunion d'information.
Après l'intervention
Avant de remonter dans sa chambre, l'opéré restera en salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI) au moins une partie de l'après midi et souvent jusqu'au matin suivant. Cela permet une surveillance étroite.
Le principe est de revenir le plus vite possible dans un fonctionnement ordinaire. Le fait de s'habiller plutôt que rester en pyjama, de se raser ou se maquiller, manifeste clairement cette volonté de retour à la normale. Une préparation par des séances de rééducation préopératoire améliore la confiance des patients et accélère leur reprise fonctionnelle..
- La rééducation
Le patient se rééduque sous la surveillance du kinésithérapeute. Le premier jour, le kinésithérapeute va superviser le premier lever. Le patient fait quelques pas dans la chambre. S'il est particulièrement en forme, toujours avec le kiné, il fera aussi le couloir, voire même les escaliers.
Dès le deuxième jour, il va marcher dans le couloir avec les cannes et éventuellement commencer à monter et descendre les escaliers.
Le petit groupe d'opérés va se retrouver ensuite pour des exercices en commun, expliqués et supervisés par le kinésithérapeute. Idéalement ces activités s'effectuent dans une salle dédiée, où le groupe partage aussi le repas de midi. L'objectif est de créer des relations chaleureuses et stimulantes entre les opérés. C'est ainsi que la plupart des opérés pourront sortir de l'hôpital au 3e ou au 4e jour post-opératoire.
- Le retour à domicile
Il devrait être la règle après une PTH, sauf conditions sociales défavorables ou pour des personnes très âgées ou malades par ailleurs. Ces cas particuliers concernent les personnes seules ou trop mal entourées ou celles qui ont un logement vraiment inadapté (nombreux étages sans ascenseur, maison isolée, accès au domicile difficile). D'ailleurs en France, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie a publié un texte stipulant qu'au dessous de 79 ans, le retour à domicile devait être le mode de suite habituel.
Toutes les études démontrent clairement :
- que le risque infectieux augmente avec la durée de séjour en milieu hospitalier ;
- qu'il n'y a pas de différence de résultat sur les capacités fonctionnelles selon que la rééducation a été faite en ambulatoire ou en centre de rééducation.
Cela ressort de la comparaison des séries américaines et françaises : la rééducation en centre est rare aux États-Unis - à cause de son coût élevé - mais les scores fonctionnels des patients sont similaires des deux côtés de l'Atlantique. Cependant, il n'est pas recommandé de pousser le raisonnement à l'extrême : il a été essayé de réaliser des prothèses de hanche comme intervention ambulatoire, c'est à dire avec retour à domicile le jour même. Le taux de complications observé a fait reculer les praticiens.
Les patients les plus performants et de loin, lors de la consultation de contrôle à deux mois, sont ceux qui sont rentrés chez eux. Ce retour a domicile manifeste leur dynamisme et leur volonté de rejoindre vite la vie normale. La marche représente à elle seule 90% de la rééducation : elle est indispensable pour une bonne récupération. C'est elle qui va restaurer la confiance, l'équilibre, la qualité des muscles stabilisateurs du bassin. C'est un exercice simple, totalement physiologique, favorable à toutes les fonctions fondamentales de notre corps.