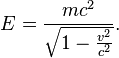Vitesse supraluminique - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
En physique des particules
Effet Čerenkov
Très familier pour le personnel des centrales nucléaires, c'est l'effet visuel qui se produit lorsque certaines particules atomiques dépassent le mur de Tcherenkov, c’est-à-dire, la vitesse de la lumière dans un milieu donné autre que le vide.
Pour les centrales nucléaires, il s'agit de l'eau. En effet, dans un tel milieu, la vitesse de propagation de la lumière est de 230 600 km/s (contre presque 300 000 km/s dans le vide), tandis que celle des électrons est de 257 370 km/s dans le même milieu. L'effet Tcherenkov lors du dépassement de la lumière est alors analogue à l'effet Mach lorsqu'on dépasse le mur du son ; mais « lumineux » et non « sonore » : l'onde de choc est un flash lumineux qui poursuit la particule chargée. Cet effet est la cause du rayonnement de lumière bleue qui émane des piscines de refroidissement des réacteurs nucléaires.
Ici la relativité n'est pas mise en défaut dans la mesure où seule la vitesse de la lumière dans le vide constitue une limite théorique. La lumière se propageant moins vite dans un milieu matériel ; il est ainsi possible de se déplacer plus vite que la lumière, mais toujours moins vite que c.
Ces situations sont à l'origine de quiproquos sur l'idée que les neutrinos iraient "plus vite que la lumière". En fait, c'est exact, mais pas plus vite que la lumière dans le vide, qui se propage alors à cette valeur limite.
Effet STL
Inspirés par l'effet Tcherenkov, de nombreux scientifiques ont expérimenté les applications du ralentissement de la vitesse de la lumière. Or selon la relativité générale, matière et lumière peuvent l'un et l'autre courber l'espace-temps. L'étude la plus éloquente (reposant donc à la fois sur l’emploi du ralentissement de lumière et sur la courbure de l'espace-temps) est l'expérimentation d'un dispositif créant un faisceau lumineux circulaire dans un cristal photonique pliant la trajectoire de la lumière en la ralentissant [2]. L'effet STL ("Space-time Twisted by Light") consiste à envoyer un neutron dans l'espace au centre du faisceau. Deux faisceaux dans ce modèle, avec la lumière voyageant dans des directions opposées, tordraient l'espace-temps à l'intérieur de la boucle. Le spin du neutron serait alors affecté par cet espace-temps ainsi déformé. Le neutron se déplaçant à une vitesse supérieure à la lumière circulaire ralentie, il en résulterait une reconstruction du neutron avant sa désintégration dans le dispositif. Le docteur Ronald Mallett de l'université du Connecticut a mis au point ce dispositif qui ralentit considérablement la lumière et pourrait (contrairement à l'effet Tcherenkov) influer sur la causalité[3]. Il souligne toutefois les difficultés matérielles d’une telle entreprise et rappelle que le ralentissement de la lumière exige des températures proches du zéro absolu. Cependant, les premières mesures sont tout à fait probantes et soutenues par l'université du Connecticut, le rapport public est d'ailleurs sorti en novembre 2006. Mais d'une part, même si cette expérience marche à l'échelle d'un neutron, l'on peut s'attendre à un phénomène de décohérence à l'échelle macroscopique. Par ailleurs, à la manière de l'effet Tcherenkov, la lumière se propageant moins vite dans ce milieu matériel il est possible de se déplacer plus vite que cette lumière, mais une fois de plus moins vite que c.
Catégories hypothétiques de particules supraluminiques
Tachyons
Seraient supraluminiques aussi les éventuels tachyons, permis formellement par les équations de la relativité. Ces particules ne pourraient jamais voir leur vitesse diminuer en dessous de la vitesse limite. La masse au repos d'un tachyon est un nombre imaginaire.
En physique, un tachyon ne correspond jamais à une particule ayant une réalité matérielle mais est une indication que la théorie dans laquelle ils apparaissent possède une forme d'instabilité. Dans ce cas c'est un signe que la théorie a été formulée en faisant un mauvais choix de variables. Lorsqu'on formule la théorie en prenant de bonnes variables les tachyons disparaissent.
Superbradyons
Il s'agit de particules avec masse et énergie réelles et positives, et avec une vitesse critique dans le vide très supérieure à celle de la lumière. Les superbradyons pourraient être les constituants ultimes de la matière. Les particules du modèle standard seraient des excitations d'un "vide" formé à partir de la matière superbradyonique.
La différence de vitesse critique dans le vide entre les superbradyons et la matière conventionnelle serait alors analogue à celle qui existe entre la vitesse de la lumière et celle du son. L'analogie est basée, notamment, sur le fait que la cinématique des phonons dans un solide possède sa propre invariance de type Lorentz dans la limite des faibles impulsions, avec la vitesse du son à la place de c.