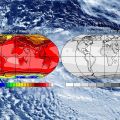Délétion de la spermatogenèse - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
En France
Les spermogrammes de 1351 donneurs de spermes du CECOS parisien (tous déjà père d'au moins un enfant au moment du don), montrent qu'en 20 ans (de 1973 à 1992) le volume de sperme est resté stable, mais sa concentration moyenne en spermatozoïde a par contre fortement diminué (- 2,1 %/an, chutant de 89×106 /ml de sperme 1973 à 60×106 par ml en 1992.
Le pourcentage de spermatozoïdes normalement mobile a aussi chuté (de 0,6 % par an), et celui des spermatozoïdes de forme normale a diminué (- 0,5 %/an).
Après ajustement prenant en compte l'âge et la durée de l'abstinence sexuelle, sur ces 20 ans, chaque nouvelle génération (par année civile de naissance) a perdu 2,6 % des spermatozoïdes de la cohorte née l'année précédente, et le taux de spermatozoïdes mobiles a diminué de 0,3 % par an, et celui des spermatozoïdes de forme normale a diminué de 0,7 %/an.
La France a lancé en 2005 un programme national de recherche sur des perturbateurs endocriniens (PNRPE) et a ouvert un volet « Atteintes de la reproduction » dans son Plan National Santé Environnement et son Plan Santé au Travail. Le groupe ECRIN cherche à articuler les réflexions du privé (dont industrie) et du public (Recherche en particulier).
La ministre de la santé a annoncé fin novembre 2009 prévoir la publication de recommandations aux femmes enceintes (comme au Danemark, ou aux USA concernant les taux de mercure de certains aliments), mais une étude américaine publiée en 2008, ayant porté sur 511 femmes enceintes a montré que de telles mesures n'ont pas été efficaces concernant l'usage des pesticides (insecticides) dans la maison durant la grossesse. Et après l'interdiction des organophosphorés pour ce type d'usage aux USA, les ménagères ont simplement changé de produits. De 2002 à 2006, au moins 85 % des femmes enceintes interrogées ont déclaré utiliser des pesticides, et du Diazinon et du chlorpyrifos ont été trouvés dans plus de 98 % des échantillons d'air des maisons (avant et après l'interdiction aux USA) et 18 à 75 % des échantillons de l'air respiré par les futures mères contenaient au moins 1 pesticide de "remplacement".
Controverse sur la gravité de la situation
De fortes différences géographiques (ou selon le métier) de santé reproductive masculine semblent maintenant bien établies. De même chez la faune sauvage quand elle présente des problèmes a priori similaires. L'« exception finlandaise » interroge toujours les chercheurs. Une nouvelle piste explicative est apparue en 2009, suite à une étude du Pr Skakkebaek montrant que l'exposition des Finlandais et des Danois à certains perturbateurs endocriniens (dont pesticides) est très différente (démontrée via l'analyse du taux de ces produits dans le lait des femmes allaitantes). Cette étude suggère en outre un lien entre certains produits chimiques présents dans le lait maternel et le cancer du testicule.
On ne peut rétrospectivement vérifier l’évolution séculaire ou éventuellement multiséculaire de la fertilité masculine, d'abord par manque de spermogrammes si l'on remonte à avant 1940 et ensuite parce que les paramètres spermatiques des spermogrammes (concentration, mobilité, morphologie..) ne suffisent pas à évaluer la capacité fécondante du sperme.
Des phénomènes comme ceux induits par l'exposition in utero au distilbène sont transmissibles (aujourd'hui observés sur la troisième génération). Ceci invite à poser la question de l'éventuelle persistance du déclin de la spermatogenèse même si certains produits suspectés étaient interdits ou cessaient d'être utilisés. La réponse à cette question nécessite une meilleure compréhension des mécanismes en cause ; y a-t-il mutation induite de l'ADN ? et si oui ; est-elle reproductible de génération en génération, Est-elle courante ? Et est-elle dominante ou récessive ? Si au contraire il n'y a pas de mutation, mais une action directe de perturbateurs endocriniens, quelle est leur biodisponibilité et leur persistance dans l'environnement ?
Enfin, l'homme moyen produisant encore des milliards de spermatozoïdes au cours de sa vie, la question se pose de savoir si la fertilité d'un couple est réellement affectée par un nombre de spermatozoïde divisée par deux ou par trois.
Plusieurs chercheurs ont nié la validité des spermogrammes comme preuve suffisante d'une baisse de fertilité masculine, surtout dans un contexte où le contrôle de la natalité est devenu commun. Certains ont proposé un autre indicateur qu'ils jugent plus sensible et représentatif de la fertilité effective, qui est le temps de gestation (le délai d'attente de la grossesse ou « délai nécessaire à concevoir » (DNC ; ou Time to pregnancy ou TTP pour les anglophones), soit le nombre de mois de rapports sexuels non protégés avant la conception, mais cet indicateur, outre qu'il ne prend pas en compte le nombre et la date des rapports sexuels, peut aussi être critiqué par le fait que ce temps dépend autant de la fertilité de la femme que de celle de l'homme, et que dans le cas de couples peu fertiles du fait de l'homme, il peut être fortement raccourci par d'autres facteurs externes incluant un bien meilleur suivi médical, voire une relation « extra-conjugale » de la femme.
- Une étude a comparé sur cette base la fécondité de couples anglais et finlandais. La Finlande a été choisie pour l'« exception finlandaise » caractérisée par un nombre de spermatozoïdes apparemment resté normal dans ce pays (le double de la moyenne des autres études), associé à un faible taux de cancer du testicule. L'étude a comparé 1891 grossesses en Finlande et 1201 au Royaume-Uni, concluant à fécondité significativement meilleure en Finlande.
- D'autres données ont été obtenues pour 197 grossesses de Finlandaises exposées à des solvants organiques, et des valeurs de TTP ont été analysées pour 14223 femmes d'une cohorte de 1958 suivie en Grande-Bretagne... Conclusion : même en tenant compte des différences méthodologiques entre les études, la fertilité est meilleure chez les femmes finlandaises qu'anglaises, ce qui suggère aussi que les numérations de spermatozoïdes, différentes dans les deux pays, ne sont pas un artefact induit par le « facteur humain » qui pourrait expliquer au moins une part des variations de numérations dans l'espace et dans le temps.
Les auteurs estiment qu'il n'y a pas de biais méthodologique dans ces études, mais ils jugent « peu probable » l'hypothèse d'une perturbation endocrinienne à ce point plus importante en Angleterre qu'en Finlande. Un moindre tabagisme féminin en Finlande est une hypothèse explicative qu'ils ont proposé, mais en reconnaissant qu'elle manquait de preuves convaincantes ( Human evidence from prior studies for the smoking hypothesis is unclear).
- Rien ne démontre cependant que la TTP soit un indicateur pertinent dans ce cas ; d'autant que les valeurs fiables de DNC (délai nécessaire à concevoir) ne sont pas non plus disponibles pour le passé avant les années 1940-50 et qu'elle dépend en outre de nombreux facteurs inconnus de l'enquêteur (nombre et dates des rapports sexuels en particulier).
- Une étude rétrospective chez des jumeaux danois nés de 1953 à 1976 n’a pas montré de tendance (sur ces 24 années) à la diminution de la probabilité de grossesse.
- Une autre étude n'a pas trouvé de lien entre sex ratio et TTP.
- Non seulement, le nombre de spermatozoïdes des Finlandais est plus élevé que celui des Danois (Jørgensen et al., 2002), mais l'incidence de la cryptorchidie et l'hypospadias est 3 à 4 fois plus élevé au Danemark qu'en Finlande. En outre les nouveau-nés mâles finlandais en bonne santé ont en moyenne des testicules plus grands que ceux des Danois, et des taux plus élevés d'inhibine B, un marqueur des cellules de Sertoli des testicules.
- En 2008, une étude a montré que les Finlandais émigrés au Danemark voient - dès la seconde génération - leur risque de développer un cancer des testicules augmenter, au même niveau que celui de la population du pays-hôte. Ceci laisse penser à un cancer induit in utero et faisant suite à des facteurs environnementaux plutôt que génétiques.
Prospective
- Si on prend les tendances dégagées de dizaines d'études utilisées par les Danois (tendances confirmées par des experts américains reconnus, dont la Professeure Shanna Swan, interviewée dans le reportage d'Arte de novembre 2008) et reprises par F. Veillerette dans son livre "Pesticides, le piège se referme", le déclin correspondrait à une division par deux du nombre moyen de spermatozoïdes en 50 ans (dans les pays de ces études - et on ne sait pas quel était le nombre moyen de spermatozoïdes par ml de sperme à la préhistoire ou il y a 200 ans). - Une extrapolation linéaire de la tendance dans le futur proche n'a pas de valeur scientifique en termes de prédictibilité, mais c'est un outil de prospective indicatrice… Les prospectivistes en épidémiologie, au Canada, estiment aussi qu'« Il est assez probable que l'incidence du cancer des testicules continuera d'augmenter ("Nous ne savons pas pourquoi" précisent-ils) et que l'incidence du mésothéliome et de la mortalité qui y est associée ne cesseront de croître ».
De plus, si à partir de la régression moyenne observée de 1940 à 1995 on "prolonge" la tendance, on arrive - vers 2070 ! – C'est-à-dire qu'en 2070 (dans un peu plus de 60 ans), les hommes (dans les pays des études citées et si la tendance se prolonge au rythme des 50 dernières années) ne devraient plus être capables de produire aucun spermatozoïdes... - Pour les tenants du « développement durable » cette donnée semble de première importance. Le spermatozoïde humain et de certaines espèces parapluie pourrait ainsi compter parmi les futurs indicateurs du développement durable.