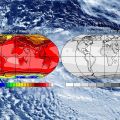Économétrie - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
« Prix Nobel » d'économie
Le Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel (« prix Nobel » d'économie) a été décerné à plusieurs reprises pour des travaux économétriques:
- Jan Tinbergen et Ragnar Frisch ont reçu le premier « prix Nobel » d'économie décerné en 1969 (macroéconométrie) ;
- Lawrence Klein a reçu le prix en 1980 ;
- Trygve Haavelmo récompensé en 1989, a contribué à l'économétrie à travers l'article « The Probability Approach in Econometrics » (L'approche probabiliste en économétrie) publié en 1944 dans la revue Econometrica.
- Daniel McFadden et James Heckman partagent le prix en 2000 pour leurs travaux en microéconométrie ;
- Robert Engle et Clive Granger ont reçu le prix en 2003 pour leurs analyses économiques des séries temporelles. Engle est un pionner de la méthode ARCH et Granger a développé la méthode de cointégration.
Problèmes épistémologiques de l'économétrie
C'est au départ dans le but de faire coïncider les théories économiques avec les données, que les économistes ont mis en place tout un ensemble de techniques économétriques. Leur objectif était de déterminer quels modèles économiques pouvaient être considérés comme les plus vraisemblables. Ainsi, en s'appuyant sur un processus de sélection des modèles de type poppérien (les modèles les moins vraisemblables devant être progressivement éliminés), ils espéraient pouvoir approcher au mieux la réalité économique sans avoir à intervenir sur elle. Toutefois, cette amélioration fut loin d'être systématique. Ceci, malgré une perfection croissante des techniques économétriques. La haute technicité mathématique en économétrie ne doit donc pas masquer le fait que l'économie ne peut prétendre devenir : d'une part une science expérimentale au même titre que la physique, la chimie, la biologie ou la psychologie expérimentale, et d'autre part une science d'observation aussi précise et « neutre » que la cosmologie ou la démographie.
Sans prétendre à l'exhaustivité, on peut y voir plusieurs raisons :
- Des raisons d'ordre éthique
Au niveau macroéconomique, une expérience de grande ampleur pourrait plonger un pays dans la récession et engager ainsi la vie de millions de personnes. Au niveau microéconomique, toute intervention concurrencerait les agents déjà impliqués sur le terrain. D'une manière générale, toute forme d'expérimentation qui implique des personnes humaines pose d'évidents problèmes éthiques.
- Des raisons qui concernent la spécificité des agents économiques
Certaines théories et prédictions économiques ne peuvent être directement testées par l'expérimentation, car il n'est pas possible de répliquer tous les phénomènes économiques dans des conditions de laboratoire, notamment quand l'objet d'étude est trop vaste (de la taille d'une nation ou plus). D'autre part, dès qu'ils prennent connaissance des lois économiques, les agents peuvent modifier leurs comportements (l'exemple typique est la prophétie auto-réalisatrice). En outre, les comportements sociaux sont complexes et toujours soumis à une forte part d'aléas, d'irrationalité, et de libre-arbitre. Qui plus est, la réalité économique est souvent très changeante. Il est alors difficile de comparer les variables économiques sur de longues périodes, car les conditions économiques peuvent varier du tout au tout. Enfin, derrière les choix économiques se cachent très souvent un choix politique sous-jacent qui se produit à l'intérieur d'un environnement social spécifique ; ce qui ne manque pas de soulever le problème de savoir si les lois économiques sont des lois naturelles, ou si elles sont le résultat de l'intervention volontaire des agents économiques.
- Des raisons épistémologiques
Les variables retenues pour cerner l'objet économique peuvent être plus ou moins orientées en fonction de certaines finalités propres à l'observateur (celui-ci ne montrera qu'un aspect partiel et partial de la réalité économique). Autre point, différents tests peuvent conduire à la validation d'hypothèses antagonistes, car la variabilité des techniques économétriques, des configurations historiques, des données disponibles, et les incertitudes théoriques, ne permettent pas toujours de trancher entre différents modèles. Et enfin, le rejet d'un modèle n'implique pas nécessairement que ce modèle soit irréaliste. Il indique seulement, que sous certaines conditions, qui ne se reproduiront pas nécessairement, un modèle a une forte probabilité d'être irréaliste ou faux. Dernier point, sur le plan méthodologique, le recours aux mathématiques en économie est sujet à caution pour de nombreuses raisons (variabilité du comportement, complexité de l'objet d'étude, fluctuations erratiques des prix, corrélations peu robustes entre les variables, etc.)
Bref, l'économétrie est bien loin d'être une « science dure ». Cependant, si on fait abstraction de ces nombreuses difficultés, il faut admettre qu'elle a fait preuve d'une certaine efficacité pour mesurer l'impact des politiques macro-économiques. La partie « validation des théories » faisant quant à elle l'objet d'interminables controverses.
D'autre part, on remarquera que le succès de l'économétrie ne fait pas forcément l'unanimité chez les économistes. Certains penseurs de l'école autrichienne comme Ludwig von Mises, contestent l'intérêt de la formalisation du comportement économique. De plus, comme John Kenneth Galbraith l'avait noté, l'économie professionnelle est organisée hiérarchiquement : économie hétérodoxe à la base, économie néo-libérale au sommet et les formes les plus mathématiques de l'économie néo-libérale à la pointe. On se doute bien que ce classement hiérarchique crée des dissensions au sein de la communauté des économistes, dont certains membres refusent d'adopter un formalisme mathématique jugé parfois excessif et superflu.
Il faut aussi noter que récemment, l'économie expérimentale, nouvelle branche de l'économie consistant à effectuer des expériences de laboratoire pour tester les modèles micro-économiques, est venue concurrencer l'économétrie sur le terrain de la validation des théories. Les résultats qui émanent de cette nouvelle discipline sont souvent en contradiction flagrante avec les hypothèses qui sous-tendent les modèles économétriques fondés sur des modèles d'équilibre général, ce qui tend à réduire la portée heuristique de la micro-économétrie.