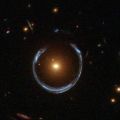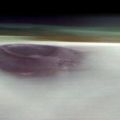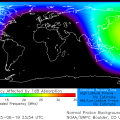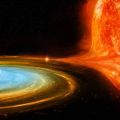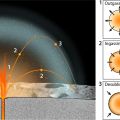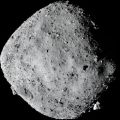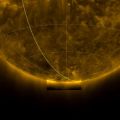Église Notre-Dame-de-la-Gloriette - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Mobilier
De nombreux éléments de mobilier liturgique, dont la plupart sont classés monument historique au titre d'objet, sont entreposés dans l'église depuis le Consulat. Certains sont entrés dans les collections du musée des Beaux-Arts de Caen, d'autres sont restés dans l'église.
Le maître-autel

Dans l'abside, s'élève un maître-autel provenant de l'abbaye aux Dames et entreposé à Notre-Dame-de-la-Gloriette après la fermeture du monastère en 1790.
L'autel est en marbre blanc. La partie inférieure date de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, à moins qu'elle ait été réalisée après la reprise du culte en 1802. Elle est ornée d'un bas-relief représentant le buste de la Vierge inscrit dans un médaillon encadré de part et d'autre par des guirlandes de fleurs disposées symétriquement. De chaque côté du panneau central, trois balustres sont reliés par une tablette à hauteur d'appui. Dans la partie supérieure de l'autel, le tabernacle, réalisé dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, est enchâssé dans un gradin. La porte en plein cintre en bronze doré est finement ciselée et encadré par des palmiers.
Derrière l'autel, un groupe de statues dorées posé sur un socle en marbre de Vieux représente l'Enfant Jésus entouré à sa droite par saint Joseph et à sa gauche par la Vierge. Jésus est représenté nu dans un lit de paille devant lequel sont agenouillés ses parents. Cet ensemble datant de la première partie du XVIIIe siècle est librement inspiré de la crèche réalisée par Michel Anguier pour l'église du Val-de-Grâce et aujourd'hui exposée dans l'église Saint-Roch de Paris.
L'autel est surmonté d'un baldaquin commandé en 1707 par Françoise Froulay de Tessé, abbesse de l'abbaye aux Dames, au moine architecte Guillaume de La Tremblaye. Ce dernier s'est très fortement inspiré du maître-autel de l'abbatiale de Saint-Germain-des-Prés réalisé quatre ans plus tôt par Gilles-Marie Oppenord. La réalisation de l'autel est attribuée à un Brodon, Guillaume Brodon ou ses fils André et Michel, architectes ayant participé à la construction. Il est formé d'une coiffe reposant sur six colonnes monolithes lisses corinthiennes. Les colonnes en marbre de Vieux reposent sur des socles en pierre de Caen sur lesquels on a appliqué du marbre vert. Les chapiteaux et la base des colonnes sont dorés. La coiffe en elle-même est composée de six branches en bois doré reposant sur un entablement en fer à cheval peint pour imiter le marbre et se rejoignant pour former une couronne surmontée d'un globe sur lequel est fixé d'une croix. La partie vide de l'entablement est occupée par une guirlande nuageuse sur laquelle reposent trois personnages : deux chérubins tiennent du raisin et des épis, alors qu'au milieu un ange presque grandeur nature et paraissant planer au-dessus de l'autel tient une banderole sur laquelle il est écrit IN EXCELSIS DEO (gloire à Dieu).
Cet ensemble, classé monument historique au titre d'objet depuis le 16 décembre 1907, est aujourd'hui en mauvais état, les parties en bois, notamment le bras droit de l'ange, nécessitant d'être consolidées et redorées.
Les autres autels et la chaire
D'autres autels en bois taillé, peint et doré sont exposés dans l'église et classés depuis le 8 juillet 1980 :
- l'autel de sainte Anne (premier quart du XIXe siècle) avec une statue en pierre représentant l'Éducation de la Vierge ;
- l'autel de la Vierge avec une statue en pierre de la Vierge à l'enfant ;
- l'autel des fonts baptismaux (XVIIIe siècle) avec une toile représentant le Baptême du Christ, peinte entre 1623 et 1641 par Côme Duhey et offerte par Jacques Gervaise à l'origine pour orner une chapelle ;
- l'autel de saint Laurent (XVIIIe siècle) avec un tableau représentant le Martyre de saint Laurent ;
- l'autel de saint Charles Borromée (XVIIIe siècle) avec un tableau représentant saint Charles Borromée transporté au ciel ;
- l'autel de Notre-Dame de Pitié (XVIIIe siècle) avec un tableau représentant la Déploration .
Dans les croisillons du transept, les deux autels secondaires qui se font face ont été classés le 30 avril 1909. Leur forme légèrement concave qui épouse le plan de l'édifice rend probable l'hypothèse selon laquelle ces autels auraient été conçus dès l'origine pour l'église des Jésuites. Ils sont composés d'un retable en bois avec des toiles d'Étienne Jeaurat, surmontées d'une gloire et encadrées par deux séries de deux pilastres ioniques cannelés et rudentés. Au-dessus de l'entablement, quatre volutes se rejoignent pour former un dais qui porte une croix. À l'origine, le bois était polychrome, mais il a été décapé et vernis au XIXe siècle. Dans le transept nord, le tableau, inspiré d'une œuvre de François Lemoyne, représente l'Annonciation : l'archange Gabriel surplombe la Vierge agenouillé qui méditait sur la Bible ; de son index, il pointe vers le ciel et vers la gloire dans laquelle est sculptée la colombe du Saint-Esprit. Le même dispositif est employé dans la composition du retable du transept sud : Marie-Madeleine est au pied du Christ dont le doigt indique cette fois-ci le IHS gravé dans la gloire.
Enfin une chaire, également classée depuis le 16 décembre 1907, a été remontée sur le pilier oriental séparant le chœur du transept. Selon Bouet, il daterait des années 1735-1750 et proviendrait du monastère des Bénédictins. Il est en bois sculpté et un panier fleuri est gravé sur le devant.

Baptême du Christ, Côme Duhey | 
Annonciation, Étienne Jeaurat | 
Apparition du Christ à la Madeleine, Étienne Jeaurat |
La décoration du chœur
La partie inférieure des murs du chœur sont ornés par un ensemble de décor, datant de la fin du XVIIe siècle ou du début du XVIIIe siècle, classé le 16 décembre 1907. Il est constitué de lambris en bois peints surmontés d'un entablement sur lesquels reposent des statues d'ange et des reliquaires. Les panneaux, orné d'entrelacs dorés, devaient être à l'origine gris, mais ont été repeints en marron au XIXe siècle. Comme le maître-autel, les cinq reliquaires en bois taillé et doré proviennent de l'abbaye aux Dames, sauf les deux qui se trouvent aux extrémités de l'abside qui étaient autrefois la propriété de l'église Notre-Dame-de-Froide-Rue. Ils offrent l'exemple de cinq types différents de reliquaire ; les deux coffrets centraux surmontent des bas-reliefs représentant pour l'un l'Annonciation et pour l'autre l'Adoration des Mages ; entre ces deux bas-reliefs, un troisième de plus grande dimension illustre la Purification. Chaque reliquaire est encadré par un ange d'un mètre de haut environ en terre cuite doré assis sur des lambrequins et portant des guirlandes de fleurs. Ces anges ont peut-être été transférés de l'abbaye aux Dames
Les ferronneries clôturant le chœur sont également classées depuis 8 juillet 1980. Ces grilles en fer forgé peint et doré datent de la fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe siècle.
L'orgue
En 1837, la paroisse a fait l'acquisition d'un orgue autrefois installé dans un château. Il a été repris par Charles Spackmann Barker qui travaillait pour la maison Verschneider. La partie instrumentale a ensuite été restaurée par Charles Mutin, Aristide Cavaillé-Coll et en 1932 par Victor Gonzalez. Enfin en 1959, la maison Rothinger a ajouté un positif de dos et a électrifié l'orgue. L'orgue néo-classique de transition a été classé en deux temps :
- le 13 mai 1976 pour le buffet,
- le 20 juin 1989 pour la partie instrumentale.
Le buffet est orné de nœud, d'instrument de musique et d'oiseau. Il repose à l'entrée de la nef sur les tribunes construites en 1846-1847 et dont les grilles du XVIIe siècle sont classées depuis le 16 décembre 1907.
La composition du clavier est :
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||