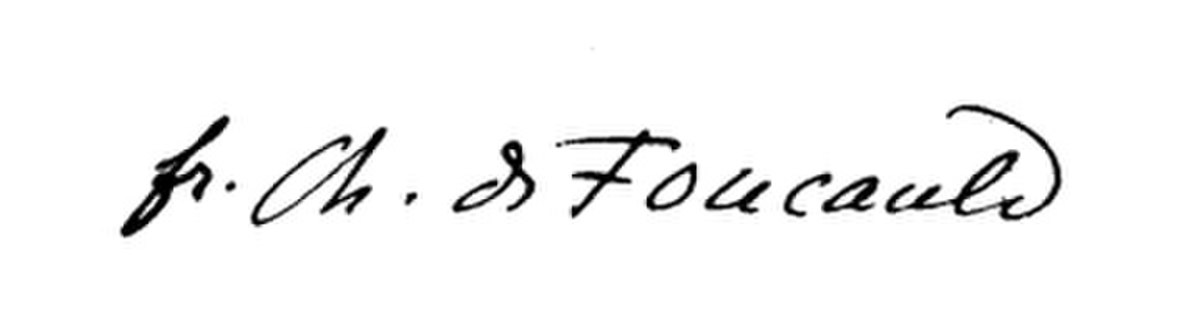Charles de Foucauld - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
Œuvres non spirituelles
Exploration du Maroc
Avant son exploration par Charles de Foucauld, le Maroc ne comptait que 700 km de pistes répertoriées. Charles de Foucauld relève plus de 2 690 km de pistes, et plus de 3 000 cotes d'altitudes. Il a corrigé le relevé du cours du Dra et rapporté des milliers d'observations, de cartes et des dessins qu'il publie dans son livre Reconnaissance au Maroc. Cet ouvrage, édité en 1888, lui vaut la médaille d'or de la Société de géographie. Les découvertes et travaux de Charles de Foucauld au Maroc sont loués par la communauté scientifique, et le discours du rapporteur lors de la remise de la médaille de Géographie montre leur impact : « En onze mois, un seul homme, M. le vicomte de Foucauld, a doublé pour le moins la longueur des itinéraires levés au Maroc. Il a repris, en les perfectionnant, 689 kilomètres de travaux de ses devanciers, et il y a ajouté 2 250 kilomètres nouveaux... C'est vraiment une ère nouvelle qui s'ouvre, grâce à M. de Foucauld, de la connaissance géographique du Maroc et on ne sait ce qu'il faut le plus admirer, de ces résultats si beaux et si utiles ou du dévouement, du courage et de l'abnégation ascétique grâce auxquels ce jeune officier français les a obtenus [...] Il a conquis des renseignements très nombreux, très précis, qui renouvellent littéralement la connaissance géographique et politique tout entière du Maroc ». La reconnaissance de la qualité des travaux de Charles de Foucauld est internationale : un membre de la Royal Geographical Society de Londres affirme qu'on « ne saurait estimer trop haut la contribution apportée par M. de Foucauld à notre connaissance du Maroc ».
Culture touarègue
Outre sa Reconnaissance au Maroc (1888), Charles de Foucauld a laissé de nombreux documents scientifiques. En 1951, l'Imprimerie nationale de France, avec le concours du Gouvernement général de l'Algérie, publie son dictionnaire touareg-français complet, en quatre volumes, issu de son important travail de recherche en vue de la connaissance des Touaregs et plus généralement des Berbères.
Charles de Foucauld est convaincu que l'évangélisation passe par le respect et la compréhension des cultures dans lesquelles il vit. À maintes reprises dans sa correspondance, il déplore la connaissance superficielle et l'irrespect manifesté envers le peuple touareg par des missionnaires et des membres de l'administration française. La méconnaissance de la langue est l'obstacle majeur à la compréhension des Touaregs. Charles de Foucauld travaille plus de douze ans à l'apprentissage de la culture touarègue. Dès 1907, Charles recueille les poèmes touarègues en contrepartie d'une petite rémunération. Toutes les poésies étant apprises par cœur par les Touaregs, Charles recopie celles qu'on lui dicte, passant des heures à écouter les femmes les réciter. En parallèle de ses travaux scientifiques, comme le lexique, des éléments de grammaire, un dictionnaire des noms de lieux, Foucauld s'emploie à traduire et développer des commentaires et analyses des poésies. Il finit ce travail sur l'œuvre poétique des Touaregs le 28 novembre 1916, deux jours avant sa mort. L'ensemble de ces travaux constitue une véritable encyclopédie du Hoggar et des Touaregs.
La majorité des travaux scientifiques de Charles de Foucauld a été très vite occultée au profit d'une vision hagiographique de sa vie, mettant plus l'accent sur son cheminement spirituel. En 1925 et 1930 André Basset a publié les deux volumes des Poésies touarègues, comprenant plus de 575 poèmes (soit 5670 vers). Ignorés jusqu'à aujourd'hui par les hagiographes et la quasi-totalité des biographes de Charles de Foucauld, ces travaux ont pourtant été connus et utilisés par les spécialistes dès leur parution. Certains d'entre eux ont bénéficié récemment de rééditions qui les ont mis à la portée d'un public un peu plus large : ré-édition en 1984 des textes en prose, puis ré-édition en 1997 d'une partie des poèmes. L'ensemble de l'œuvre scientifique de Charles de Foucauld reste « pour toute personne qui se spécialise dans l'étude du monde touareg une référence incontournable », d'autant qu'elle constitue une importante source pour l'analyse ethnographique.
Lutte contre l'esclavage dans le Hoggar
Dès l'occupation de l'Algérie en 1830, la France avait aboli l'esclavage, position officialisée lors du Décret d'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848, qui devait s'appliquer également dans les colonies. Cependant, afin de ménager les susceptibilités et les intérêts des chefs de tribu et des marabouts, l'esclavage est maintenu. En arrivant à Béni-Abbès, Charles de Foucauld réalise que l'esclavage existe encore. Très vite, il rachète la liberté d'un premier esclave, Joseph, le 9 janvier 1902, puis d'un deuxième le 4 juillet, afin de montrer son opposition à cette pratique, tout en laissant ces anciens esclaves libres de pratiquer leur foi.
Immédiatement, Charles de Foucauld dénonce la pratique de l'esclavage dans sa correspondance, tant auprès de Marie de Bondy que d'Henri de Castries et Mgr Guérin « La plus grande plaie de ce pays est l'esclavage. Je cause familièrement chaque jour, en particulier, hors de la présence des maîtres, avec beaucoup d'esclaves ». Charles de Foucauld apprend à Mgr Guérin que l'esclavage est maintenu sur ordre du général Risbourg, confirmé par le colonel Billet. Charles s'offusque de cette pratique dans sa correspondance : « C'est de l'hypocrisie de mettre sur les timbres et partout « liberté, égalité, fraternité, droits de l'homme », vous qui rivez le fer des esclaves, qui condamnez aux galères ceux qui falsifient vos billets de banque et qui permettez de voler des enfants à leurs parents et de les vendre publiquement, qui punissez le vol d'un poulet et permettez celui d'un homme ». Il demande à son ami Henri de Castries de tout faire afin d'agir en France. Il écrit à Mgr Livinhac le 8 février 1902 pour lui demander d'agir auprès des sénateurs catholiques : « Nous n'avons pas le droit d'être des chiens muets et des sentinelles muettes : il nous faut crier quand nous voyons le mal ». En attendant, Charles donne la priorité à l'œuvre des esclaves, installant un local pour leur accueil.
Néanmoins, Charles se voit tempéré dans ses revendications par Mgr Guérin, qui lui demande, au nom du réalisme politique, de ne pas agir politiquement. À plusieurs reprises, il lui demande d'arrêter l'achat de ses esclaves, parce que les chefs de tribus sont mécontents des initiatives du « marabout blanc ». De plus, le climat politique en France est marqué par une vague d'anticléricalisme avec les lois du gouvernement Waldeck-Rousseau. Mgr Guérin voit dans l'antiesclavagisme virulent de Charles de Foucauld une éventuelle difficulté pour le maintien des Pères blancs en Algérie et lui enjoint donc d'arrêter son activité publique contre l'esclavage le 17 septembre 1902. Charles de Foucauld écrit qu'il lui obéira, non sans être en désaccord avec lui : « Ces raisons ne me laissent pas — soit dit une dernière fois — sans regretter que les représentants de Jésus se contentent de défendre « à l'oreille » (et non « sur les toits ») une cause qui est celle de la justice et de la charité ».
Peu à peu, l'activisme et la proximité de Charles de Foucauld avec les autorités conduisent à un changement de la situation. Le 15 décembre 1904, Charles annonce à Henri de Castries que « d'un commun accord, les chefs d'annexe des oasis ont pris des mesures pour la suppression de l'esclavage. Non en un jour, ce qui ne serait pas sage, mais progressivement ». Les esclaves ne peuvent plus être vendus, ceux qui avaient un esclave peuvent le garder, mais il ne pourra plus changer de maître ; s'il est maltraité, le chef d'annexe l'affranchira.
Vision de la colonisation
La colonisation française est portée principalement par les idéalistes laïcs, comme Léon Gambetta ou Jules Ferry. Ce dernier affirme en 1885 : « Il faut dire ouvertement qu'en effet les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures... Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures ». Des entrepreneurs appuient aussi la colonisation avec par exemple le Canal de Suez, et les missionnaires chrétiens qui voient dans la colonisation une possibilité d'évangéliser. La colonisation est d'autant plus recherchée qu'elle constitue un remède provisoire dans laquelle « la génération de Charles de Foucauld trouvera un moyen d'exprimer son patriotisme ».
Charles de Foucauld soutient la colonisation française, cependant ce soutien est différent de la plupart des autres français : « Il s'est montré néanmoins plus lucide que la plupart des responsables coloniaux de sa génération, et ne s'est pas privé d'avertir ses compatriotes qu'ils perdraient leur empire africain faute d'une volonté politique de justice et de progrès ». Certains voient dans le soutien de Charles de Foucauld à la colonisation une dissociation entre sa pensée spirituelle et politique. Jean-François Six souligne quant à lui l'unité de sa pensée : Charles de Foucauld voit dans la colonisation une mission civilisatrice au bénéfice des populations colonisées, celle-ci apportant une ouverture de l'intelligence qui permet d'ouvrir à l'évangélisation.
Il croit au bienfait du progrès technique qu'il assimile à la civilisation. Il appuie l'arrivée de chaque progrès technique au Sahara, comme le projet de Transsaharien, la Transmission sans fil ou la construction de pistes automobiles. Ce progrès issu de la colonisation a pour vocation de faire des colonisés « non nos sujets, mais nos égaux, être partout sur le même pied que nous ». Il conçoit la colonisation de manière humaniste et fraternelle : « que ces frères cadets deviennent égaux à nous ».
Malgré son soutien à la colonisation française, Charles de Foucauld la considère, à de nombreuses reprises, de manière très sévère : il dénonce l'absence d'investissement et d'aide au développement « ... notre Algérie, on n'y fait rien pour les indigènes ; les civils ne cherchent la plupart qu'à augmenter les besoins des indigènes pour tirer d'eux plus de profit, ils cherchent leur intérêt personnel uniquement ; les militaires administrent les indigènes en les laissant dans leur voie, sans chercher sérieusement à leur faire faire des progrès ». Il critique vivement les exactions des militaires dans le Sahara, ainsi que les civils qui ne recherchent que leur intérêt et à développer leur profit, mais aussi l'absence de lutte contre l'esclavage par les autorités coloniales.
Les rapports qu'il entretient avec l'armée française seront nombreux. Il établit des relations amicales avec l'armée, ce qui lui sera reproché après sa mort. Cela ne l'empêche pas de critiquer les exactions et les abus commis par certains militaires dans le Hoggar, comme les réquisitions et les sous paiements d'indemnité. Il a un regard parfois très sévère sur certains officiers « Ce que je vois des officiers du Soudan m'attriste. Ils semblent des pillards, des bandits, des flibustiers. Je crains que ce grand empire colonial qui pourrait et devrait enfanter tant de bien ne soit présentement pour nous qu'une cause de honte, qu'il nous donne lieu de rougir devant les sauvages mêmes ; qu'il fasse maudire le nom français et hélas le nom chrétien, qu'il rende ces populations, déjà si misérables, plus misérables encore ». Charles néanmoins ne se croit pas le représentant de l'armée, d'ailleurs il se méfie de cette proximité, écrivant à Mgr Guérin : « Sauront-ils séparer entre les soldats et les prêtres, voir en nous les serviteurs de Dieu, ministres de paix et de charité, frères universels? Je ne sais... ».
Charles de Foucauld développe une analyse sur l'efficacité de la colonisation. Dans une lettre à René Bazin il affirme qu'il y a une incompatibilité profonde entre la religion musulmane et l'assimilation des populations musulmanes à la France. Non pas que les populations ne puissent pas progresser comme beaucoup de personnes le pensaient à son époque, et auxquelles Charles s'oppose, mais parce qu'il considère que les musulmans « regardent l'Islam comme une vraie patrie ». La politique d'assimilation des populations musulmanes lui semble impossible, d'autant qu'aucun effort pour l'éducation et l'exemple de vie n'est fait pour les populations. Il affirme ainsi dans sa lettre que « Si nous n'avons pas su faire des Français de ces peuples, ils nous chasseront. Le seul moyen qu'ils deviennent français est qu'ils deviennent chrétiens ».
Signature de Charles de Foucauld
Cette question mineure concerne les différents noms désignant Charles de Foucauld. « Charles de Foucauld de Ponbriand » est son nom complet. Cette dénomination est utilisée pour le désigner dans la période qui précède son entrée dans les ordres. « Père de Foucauld », désigne sa fonction à partir son ordination. « Frère Charles » a la préférence de sa famille spirituelle : pour les Petites Sœurs de Jésus, ce nom exprime mieux son idéal de fraternité et sa volonté de rester humble. On trouve aussi le nom de « petit frère universel ».
La façon dont Charles de Foucauld se désignait lui-même dans ses correspondances a varié au cours des années : après avoir signé ses lettres « Frère Marie-Albéric » à l'époque de la Trappe, « Frère Charles » après sa sortie de la Trappe, puis « Charles de Jésus » ou « Frère Charles de Jésus » à partir de 1899, il semble, après 1913 ou 1914, ne plus guère signer que « Charles de Foucauld » ou « Fr. Charles de Foucauld ».