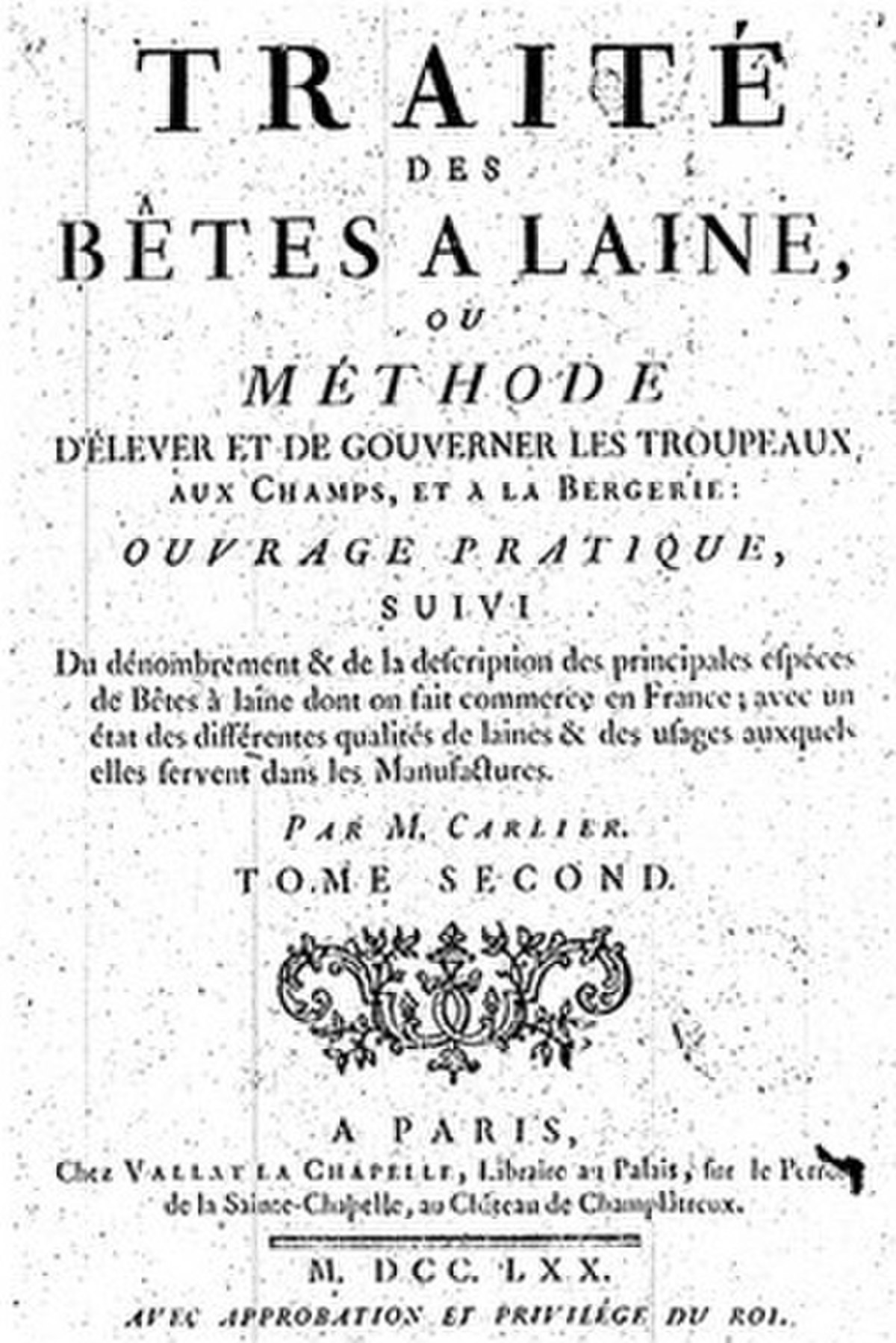Claude Carlier - Définition
La liste des auteurs de cet article est disponible ici.
L'agronome
Bon connaisseur de l'élevage ovin, Claude Carlier rédigea une série de mémoires sur ce sujet. D'abord enthousiaste sur les possibilités d'acclimatation des moutons anglais, espagnols ou flamands dans les terroirs français, il devint progressivement sceptique quant aux chances de réussite, et prôna l'amélioration des races locales existantes. Il appuyait sa démonstration sur l'expérience agronomique et sur l'érudition historique.
En 1754, l'Académie d'Amiens récompensa de nouveau Claude Carlier pour son Mémoires sur les laines, publié sous le nom de M. de Blancheville, qui marqua le point de départ de sa réputation d'agronome. Il répondait à une question mise au concours deux ans plus tôt : Quelles sont les différentes qualités de laines propres aux manufactures de France ? Si on ne pourrait point se passer des laines étrangères ? Comment on pourrait perfectionner la qualité et augmenter la qualité des laines en France ? Cette question avait été élaborée avec le ministère public, c'est-à-dire sans doute avec Daniel Trudaine, un proche de Vincent de Gournay et de Bertin. Cet ouvrage connut deux éditions revues et corrigées, publiées à Paris en 1755 et 1762. Puis, dans la même lignée, il publia des Considérations sur les moyens de rétablir en France les bonnes espèces de bêtes à laine.
A l’issue d’une mission en Flandre pour le compte du Contrôleur général des finances Bertin, Carlier publie une Instruction sur la manière d’élever et de perfectionner la bonne espèce des bêtes à laine de Flandre, publiée en 1763. Ce voyage a transformé ses conceptions agronomiques, l’amenant à réfuter toute possibilité d’amélioration exogène (c'est--dire, par croisement avec des reproducteurs importés d'un autre pays) au profit de l’amélioration endogène (c'est-à-dire, par une sélection rigoureuse au sein des troupeaux existants). Dès la publication de son livre, il met en garde les éleveurs qui voudraient se fier à son propre enthousiasme des Considérations. Il adopte le principe selon lequel « les qualités suivent les lieux » (eligendum pecus ad naturam, dit-il en Latin), allant jusqu’à recommander que l’on cesse tout importation de mouton flandrin vers d’autre province avant plus ample information.
Cette objection est liée à la conception de l’élevage dominante sous l’Ancien Régime, qui veut que l’animal soit le reflet du sol. Au XVIIIe siècle, le climat tend à se substituer au sol comme déterminant, mais le résultat est le même : l’acclimatation est tenue pour impossible, puisque les produits issus de ces croisements deviendraient rapidement semblables à la race locale. Cette idée s’appuie en partie sur un constat empirique : sans une attention constante à maintenir par de nouveaux croisements et une gestion rigoureuse de la reproduction, l’apport de reproducteurs importés ne donne guère de résultats.
A la demande du Contrôleur général des finances Bertin, il écrivit en 1762 un mémoire sur les différentes variétés de moutons du royaume. Pour le rédiger, il envoya un questionnaire aux intendants et aux sociétés d'agriculture, qui reçut plus de trois cents réponses, et il visita plusieurs provinces pour connaître la diversité de l'élevage ovin. Les résultats de cette vaste enquête furent publiées en 1770 dans les deux volumes du Traité des bêtes à laine, qui est donc une source essentielle pour la connaissance des racines ovines régionales sous l'ancien régime, avant la la généralisation du mérinos.